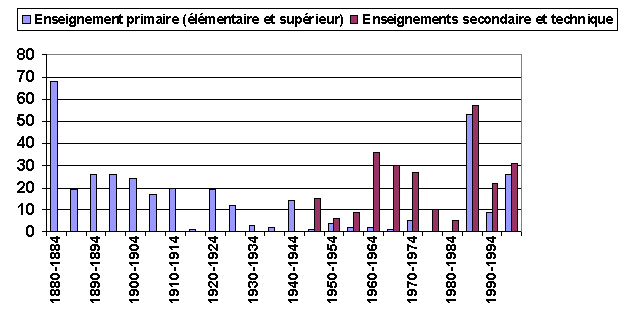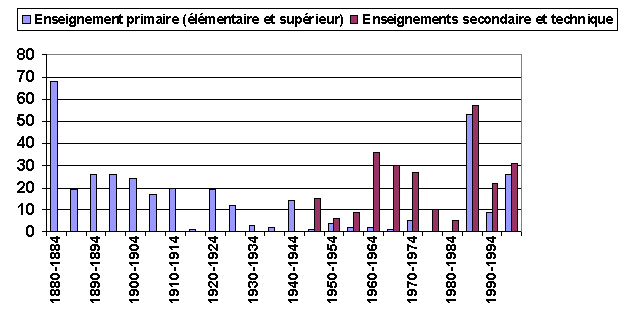
Les Manuels scolaires en France et la formation du citoyen
Alain Choppin
C’est dans la seconde moitié du XVIIIème siècle que se fait jour en France la nécessité de donner à la jeunesse une instruction civique. Dès 1752, l’article « citoyen » de l’Encyclopédie, en distinguant avec soin le statut de citoyen de celui de sujet, implique une éducation spécifique. Les nombreux traités d’éducation publiés à la fin de l’Ancien Régime insistent sur la nécessité de préparer les citoyens à servir l’Etat et certains cahiers de doléances rédigés au printemps 1789 présentent des revendications similaires : celui du Tiers de Riom demande ainsi « qu’on rédige et qu’on mette au nombre des livres classiques ceux qui contiendront les principes élémentaires de la morale et la constitution fondamentale du royaume ».
De 1792 à la fin du Directoire, tous les partis s’accordent à reconnaître la nécessité d’une instruction morale et civique ; aussi les assemblées révolutionnaires s’efforcent-elles de traduire ces principes d’action dans les faits en confiant à l’institution scolaire, c’est-à-dire, désormais, à l’École de la République, la mission d’assurer la formation des futurs citoyens. C’est le livre, garant de l’orthodoxie des contenus, qui constitue alors le support essentiel de cette catéchèse civique : « La Convention charge son Comité d’Instruction publique de lui présenter les livres élémentaires des connaissances absolument nécessaires pour former les citoyens et déclare que les premiers de ces livres seront les Droits de l’homme, la Constitution, le Tableau des actions héroïques et vertueuses ».
La Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen fait ainsi l’objet d’éditions adaptées à la jeunesse, comme La Déclaration des Droits par demandes et par réponses, pour en faciliter l’intelligence aux jeunes républicains dans les écoles primaires, surtout des campagnes, de Réat ou encore La Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen mise en vers, de Darnal. Mis en chantier dès le début de l’automne 1793, le Tableau des actions héroïques et vertueuses auquel le décret du 11 frimaire an II (1er décembre 1793) confère un caractère officiel, est une publication périodique. Cinq numéros paraissent sous le titre de Recueil des actions héroïques et civiques des républicains français entre décembre 1793 et juillet 1794 et sont distribués à plusieurs centaines de milliers d’exemplaires.
En confiant la rédaction des livres élémentaires à des personnalités politiquement sures ou en organisant des concours dont ils prennent soin de désigner les membres du jury, les parlementaires témoignent de leur souci constant de contrôler étroitement la composition des livres élémentaires. Il s’agit en effet de lutter contre les idées de l’Ancien Régime et de combattre la religion avec ses propres armes, comme en atteste le titre de nombreux ouvrages, tel le Catéchisme républicain, de La Chabeaussière ou les Epîtres et Evangiles du Républicain, de Henriquez, deux des manuels primés au concours organisé en l’an II.
On est alors bien loin des objectifs assignés par Condorcet à la formation des citoyens au début de la Révolution : « l’État a le devoir de former les citoyens », sans pour autant « créer une sorte de religion politique et voler sa liberté ». Le but n’est plus d’informer, mais de provoquer l’adhésion : « la volonté de dispenser une éducation l’emporte sur le désir de donner une instruction ». Est ainsi posée (et momentanément résolue) la question du rôle de l’École dans la formation du citoyen.
L’histoire de l’enseignement civique en France est celle d’une oscillation entre deux objectifs difficilement conciliables : doit-il façonner des individus conformes aux normes sociales ou leur donner une information qui leur permette d’exercer librement leur esprit critique dans la cité ? Le manuel, qui constitue la mise en œuvre concrète des objectifs d’apprentissage, fluctue nécessairement entre deux fonctions : véhiculer une idéologie, un système de valeurs ou bien exposer des connaissances objectives.
Mais la formation des citoyens ne constitue pas nécessairement une discipline scolaire spécifique, distincte, autonome : il n’en est même plus question sous le Premier Empire et sous la Restauration qui réintroduisent les devoirs du sujet et exaltent son attachement au souverain et à sa famille ; puis, pendant un demi-siècle, de la loi Guizot du 28 juin 1833 qui organise, sous la Monarchie de juillet, l’enseignement primaire à celle du 28 mars 1882 qui fonde l’école républicaine, les rares notions qui pourraient participer de la formation du citoyen se trouvent réparties, disséminées, diluées entre l’instruction morale et religieuse et l’histoire, avec des objectifs souvent éloignés des idéaux de 1789. Une tentative est bien menée par Hippolyte Carnot, sous l’éphémère Seconde République, pour renouer avec l’esprit de la Révolution et rétablir un enseignement spécifique, mais elle tourne rapidement court.
La renaissance d’un enseignement civique à part entière se produit en 1882, avec l’introduction officielle de « l’instruction morale et civique » dans les programmes de l’enseignement primaire. La nouvelle discipline se substitue à l’instruction morale et religieuse jusque-là dispensée dans les écoles publiques et elle occupe le premier rang dans la liste des matières d’enseignement, ce qui montre l’importance que lui accordent les tenants de la laïcité. Le vote du texte définitif a demandé quatorze mois de discussions et de débats émaillés de fréquents incidents et retournements de situation.
Le manuel va jouer un rôle essentiel dans la stratégie républicaine : « Celui qui est maître du livre est maître de l’éducation », déclarait déjà Jules Ferry le 5 mai 1879 devant les membres de la Commission des livres classiques. Conformément aux conclusions d’un rapport rédigé par le directeur de l’enseignement primaire, Ferdinand Buisson, le ministre signe, le 16 juin 1880, un arrêté qui fait largement appel à l’initiative des instituteurs pour ce qui est du choix de leurs outils de travail :
« Art. 1er : Il est dressé, chaque année et dans chaque département, une liste des livres reconnus propres à être mis en usage dans les écoles primaires publiques élémentaires et supérieures.
Art. 2 : A cet effet, instituteurs et institutrices titulaires de chaque canton munis du brevet, réunis en conférence spéciale, établissent, au plus tard dans la première quinzaine du mois de juillet, une liste des livres reconnus propres à être mis en usage dans les écoles primaires publiques.
Art. 3 : Toutes les listes ainsi dressées sont transmises à l’inspecteur d’Académie. Une commission siégeant au chef-lieu du département et composée des inspecteurs primaires, du directeur et de la directrice des écoles normales et des maîtres-adjoints de ces établissements, réunis sous la présidence de l’inspecteur d’Académie, révise les listes cantonales et arrête le catalogue pour le département. »
Dans une longue circulaire du 7 octobre suivant, Jules Ferry expose aux recteurs l’esprit de la nouvelle réglementation : « vous inspirez, vous guidez l’inspection et l’enseignement, vous prévenez les écarts, et finalement, sans avoir fait inscrire ni rayer d’autorité aucun nom, vous parvenez peu à peu à faire abandonner volontairement par les intéressés les […] mauvais livres ». Il précise en outre que la révision des listes pourrait notamment avoir lieu « si des omissions graves ou systématiques paraissaient s’être produites ». L’administration centrale n’impose plus, mais elle continue à orienter, à conseiller, voire parfois à sanctionner.
En confiant aux enseignants le libre choix de leurs instruments de travail – même s’il s’agit en réalité d’un régime de liberté surveillée – le ministère leur témoigne certes une réelle et récente considération, mais elle leur confère aussi des responsabilités nouvelles et les expose personnellement aux sollicitations comme aux critiques. Une « guerre des manuels » est ainsi provoquée par la mise à l’Index, le 15 décembre 1882, de plusieurs manuels d’instruction civique et morale en usage dans les écoles publiques, accusés d’avoir violé la neutralité religieuse garantie par la loi du 28 mars 1882. Après avoir un moment envisagé, devant l’agitation qui suit, de soumettre les ouvrages de cette nature à la formalité d’une autorisation spéciale, Jules Ferry met fin à la polémique en faisant parvenir à chaque enseignant une circulaire restée célèbre : « Ce qui importe, ce n’est pas l’action du livre, mais la vôtre. […] Le livre est fait pour vous et non vous pour le livre. […] Faites toujours bien comprendre que vous mettez votre amour-propre, ou plutôt votre honneur, non pas à faire adopter tel ou tel livre, mais à faire pénétrer profondément dans les jeunes générations l’enseignement pratique des bonnes règles et des bons sentiments. »
La nouvelle liberté accordée aux enseignants va de pair avec celle dont les éditeurs jouissent désormais pour publier leurs ouvrages : depuis 1875, ils ne sont plus soumis à l’obligation de solliciter et d’obtenir un agrément préalable de l’administration pour chacun des ouvrages qu’ils destinent aux classes des établissements d’instruction publique. Aussi, dans les années 1870, le nombre des publications classiques s’accroît-il de façon spectaculaire, passant, toutes disciplines et tous niveaux confondus, de 184 nouveaux titres en 1869 à 818 en 1881.
L’introduction dans les programmes des écoles normales primaires (décret du 22 janvier 1881), puis des écoles primaires élémentaires (arrêté du 27 juillet 1882) d’une discipline nouvelle, l’instruction civique, s’opère donc dans un contexte encore inédit, mais appelé à perdurer, qui allie la liberté de production, la liberté des choix et la liberté des usages.
Les programmes de 1882, repris sans changement dans le décret organique du 18 janvier 1887 prescrivent : au cours élémentaire, « des explications très familières, à propos de la lecture, des mots pouvant évoquer une idée nationale… » ; au cours moyen, « des notions très sommaires sur l’organisation de la France », essentiellement sur le citoyen, ses obligations et ses droits, sur le fonctionnement de la commune, du département et de l’Etat ; au cours supérieur, « des notions plus approfondies sur l’organisation politique, administrative
et judiciaire de la France », des « notions très élémentaires de droit pratique » et des « entretiens préparatoires à l’intelligence des notions les plus élémentaires d’économie politique ».
Les dépouillements bibliographiques effectués dans le cadre du programme de recherche Emmanuelle révèlent qu’au moins 267 nouveaux manuels d’instruction civique destinés à l’enseignement primaire élémentaire et/ou supérieur sont publiés entre 1880 et 1945, dont 200 avant la Première Guerre mondiale. La production des manuels d’instruction civique connaît, entre ces deux dates, une évolution sensiblement parallèle à celle de la production éditoriale scolaire dans son ensemble, mais elle est nettement plus contrastée : la forte charge symbolique de la discipline en fait, semble-t-il un marché particulièrement porteur et partant plus réactif aux moindres modifications de programme. C’est ainsi qu’en trois années, 1882, 1883 et 1884, soixante titres sont publiés à l’usage des trois niveaux de l’enseignement élémentaire. Puis la production chute brutalement en dessous de trois nouveautés en moyenne chaque année : le marché est alors, à l’évidence, saturé. La production est relancée au début de la décennie suivante sous l’influence d’au moins deux facteurs : l’obligation faite aux élèves du cours supérieur d’être muni d’un manuel d’instruction morale et civique (décret du 29 janvier 1890), l’introduction parmi les épreuves du certificat d’études d’une rédaction dont un des trois sujets porte sur l’instruction morale ou civique (arrêté du 29 décembre 1891). Une vingtaine de manuels sont publiés en 1892-1893, mais le chiffre annuel des nouveautés reste compris ensuite entre trois et huit et ce jusqu’aux premières années du siècle.
Ce regain de l’activité éditoriale traduit aussi le changement d’attitude que manifestent de nombreux enseignants vis-à-vis du patriotisme à la suite de la crise boulangiste (1885-1889). L’analyse et la comparaison des listes de manuels établies dans chaque département conformément à la réglementation en vigueur confortent cette hypothèse : d’abord le choix s’est considérablement étoffé : le nombre des manuels cités passe de 91 en 1883 à 237 en 1909 ; ensuite, plusieurs « best-sellers » en usage en 1883 ont bien résisté en 1909, comme les Eléments d’éducation civique et morale, de Gabriel Compayré ou la Morale et enseignement civique, de Louis Liard, tous deux présents dans sept départements sur dix ou encore la Première année d’instruction civique, de Pierre Laloi, qui a même amélioré son score de plus de 10% en un quart de siècle. En revanche, les manuels nationalistes et revanchards qui étaient largement répandus dans les classes au début des années 1880 ne sont cités que très épisodiquement. Cette défiance du corps enseignant envers le patriotisme s’accentue dans la dernière décennie du siècle, marquée par l’affaire Dreyfus, la montée du syndicalisme, la critique des institutions et l’émergence des idées internationalistes : « Dans l’enseignement primaire, l’histoire, l’instruction civique et l’étude de la langue française permettent de diffuser les idées pacifistes et antimilitaristes. » Cette évolution est également sensible dans le libellé même des titres : le mot patrie (ou l’un de ses dérivés, patriote, patriotisme ou patriotique) se rencontre dans treize titres publiés pour la première fois avant 1894 ; on le trouve encore à deux reprises en 1895 et une fois en 1897 ; il disparaît totalement ensuite.
Les programmes de 1882 s’appuyaient sur trois notions essentielles : le patriotisme, le civisme et la morale. Mais le reflux des convictions patriotiques profite davantage à l’éducation morale qu’à l’éducation civique : de nombreux auteurs insistent sur la difficulté pour les élèves les plus jeunes de comprendre la structure et le fonctionnement des institutions et celle pour les maîtres de tisser des liens avec d’autres disciplines et de concevoir des pratiques pédagogiques appropriées. L’instruction morale – une morale qui évacue l’esprit critique et se borne à inculquer une somme de règles nécessaires à une société rurale, commerçante, épargnante et démocratique – prend le pas sur l’instruction civique : déjà le décret du 26 juillet 1909 place l’instruction civique au deuxième rang (après la morale) des matières communes à toutes les sections des écoles primaires supérieures et des cours complémentaires ; l’arrêté du 23 février 1923 confirme cette évolution en repoussant l’instruction civique au niveau du cours supérieur (11-13 ans) : elle comprend « des notions sur l’organisation politique, administrative et judiciaire de la France » et sur « le citoyen, ses droits, ses devoirs ». En 1938, la prolongation de la scolarité obligatoire de treize à quatorze ans pose la question des contenus d’enseignement qui seront dispensés pendant cette année supplémentaire. Les programmes du 23 mars 1938 prévoient deux heures hebdomadaires de morale et d’initiation à la vie civique dans les classes de fin d’études, mais avec une forte implication de l’enseignement dans le pratique et le local : « La culture générale est la même pour tous les enfants de France. La culture pratique prend une couleur différente selon les milieux, rural ou urbain, industriel ou agricole et même selon les régions ». C’est l’histoire – et notamment l’histoire contemporaine – qui apparaît alors comme le support privilégié de l’enseignement civique.
Cette diminution de la part effective accordée à l’instruction civique dans les programmes officiels se traduit dans les chiffres de la production éditoriale : seuls 44 nouveaux ouvrages sont publiés dans l’entre-deux guerres dont plus de la moitié entre 1921 et 1925.
Quelques mois après l’invasion de la France par les troupes allemandes, l’arrêté du 23 novembre 1940 expose la conception que se fait le régime de Vichy de l’instruction civique : « Les maîtres devront remettre en honneur les sentiments et les idées dont la disparition ou même le simple affaiblissement dans les esprits et dans les cœurs est à considérer comme dangereux pour l’État et pour la Patrie. Dans le même esprit, les notions d’Instruction Civique sont simplifiées et réduites à l’essentiel ». En conséquence, l’instruction civique disparaît des programmes de toutes les classes de l’école élémentaire au profit d’un enseignement moral recentré autour des notions de travail, de famille et de patrie. Elle est reléguée dans la seconde année des écoles primaires supérieures et s’organise autour de thèmes tels que : « Rôle et fonction de l’État. Conditions indispensables à son bon fonctionnement : ordre, autorité, justice. La hiérarchie et les élites. Pourquoi elles sont nécessaires à un État bien ordonné. Fidélité à l’État, à son Chef, à ses lois, aux autorités. » Qu’un seul manuel d’instruction morale et civique, celui de E. Primaire, publié pour la première fois en 1902, figure sur les listes successives de manuels interdits par les autorités de Vichy, listes qui contiennent en revanche plusieurs dizaines de titres de manuels d’histoire, confirme la désaffection dont cette discipline est l’objet à la fin de la Troisième République. Mais, compte tenu de l’étroitesse du marché et des difficultés d’approvisionnement en papier, une petite dizaine de nouveaux manuels seront composés sous l’Occupation.
À la Libération, il apparaît nécessaire de renforcer la cohésion nationale et de rénover la démocratie. Inspirée des propositions du plan Langevin-Wallon conçu à Alger à la fin de la guerre, l’organisation de l’enseignement moral et civique que met en place à partir de 1945 l’inspecteur général Louis François marque une rupture avec les périodes précédentes. Jusque-là seuls les élèves qui fréquentaient les établissements d’enseignement primaire recevaient dans un cadre scolaire une formation morale et civique ; les élèves des catégories sociales les plus aisées qui poursuivaient l’ensemble de leur cursus scolaire dans les lycées s’en remettaient à leurs familles. L’instruction morale et civique est introduite dans le second degré, d’abord dans le premier cycle (11 à 16 ans en moyenne), par les arrêtés des 26 et 27 juin 1945 et la circulaire du 27 juin 1945, puis dans le second cycle (16 à 19 ans en moyenne) par l’arrêté du 27 mars 1948 et la circulaire du 10 mai 1948. Parallèlement, les arrêtés des 17 octobre 1945, 24 juillet 1947, puis du 23 novembre 1956 refondent les programmes du premier degré. Pour la première fois est dispensé en France un enseignement moral et civique cohérent et progressif qui touche l’ensemble de la population scolaire. Compte tenu du contingentement du papier, il faut attendre juin 1948 pour voir reprendre la production : à partir de cette date, c’est essentiellement en direction de l’enseignement secondaire et, à partir des années 1960, de l’enseignement technique, que va se situer l’offre éditoriale ; l’essor démographique, la démocratisation de l’enseignement et la prolongation de la scolarité obligatoire jusqu’à seize ans ouvrent alors aux éditeurs un marché conséquent. En quinze années, de 1962 à 1976, plus de cent nouveaux titres sont publiés. Un coup d’arrêt survient en 1976 : l’éducation civique est alors intégrée dans l’ensemble histoire-géographie-initiation économique qui ne laisse plus place, pour un temps, à l’élaboration de manuels spécifiques. En revanche, le retour de l’éducation civique en tant que discipline autonome sous le ministère de Jean-Pierre Chevènement en 1985 marque le retour à la tradition de la Troisième République et suscite la composition d’un nombre considérable de nouveaux ouvrages à l’usage des différents niveaux d’enseignement.
Mais l’éducation civique n’a pas seulement conquis ces cinquante dernières années de nouveaux publics scolaires, couvrant progressivement l’ensemble des niveaux et des types d’enseignement. Elle a intégré de nouveaux objectifs, connu – avec une éclipse d’une dizaine d’années, de 1975 à 1985 – un alourdissement de ses contenus et une extension de ses domaines d’application, depuis l’initiation au secourisme (1958) ou le code de la route (1959) jusqu’aux fondements d’une citoyenneté européenne, à la lutte contre les discriminations ou à la défense du cadre de vie et de l’environnement : « La formation du citoyen comprend une éducation à la civilité, une éducation à la vie en société, une éducation civique au sens politique qui désigne l’initiation aux formes de la vie politique, aux institutions et à leur fonctionnement. » Elle a renouvelé ses méthodes : les programmes de 1985, reprenant les approches antérieures, notamment celles des programmes de 1882, s’articulaient autour d’une progression qui allait des institutions locales aux institutions nationales et internationales ; ceux de 1995 et de1997 s’organisent autour de notions fondamentales – la personne humaine et le citoyen – selon une progression qui est censée prendre en considération l’âge et le niveau des élèves : « Les valeurs et les principes de la démocratie sont fondés sur les droits de l’homme. […] Ces valeurs et principes correspondent à des concepts clefs qui, avec les élèves, sont appréhendés et construits à partir d’études de cas. L’approfondissement de ces concepts jalonne l’itinéraire civique des élèves ». Parallèlement, des initiatives se font jour visant à inscrire les principes démocratiques dans la vie quotidienne des établissements (délégués de classe, conseils municipaux d’enfants, journaux lycéens,…).
Les débats que suscite le rôle que doit jouer l’institution scolaire dans la formation du citoyen sont aujourd’hui loin d’être clos : l’instruction civique suppose un consensus sur un certain nombre de valeurs ; la disparité des opinions politiques, des croyances religieuses et des comportements sociaux en font une discipline à risques et rendent délicate la position des enseignants. C’est assurément une des explications au décalage que l’historien constate entre les intentions affichées des responsables de l’institution et la pratique quotidienne des classes.
La mise en place d’un enseignement moral et civique au début de la Troisième République correspond à une période de militantisme : il s’agit pour les responsables du système éducatif, mais aussi pour la majorité des maîtres, de susciter l’adhésion aux principes fondateurs de la démocratie. C’est ainsi qu’en 1883 de nombreux instituteurs choisissent des manuels d’instruction civique en lieu et place du livre de lecture ; à l’inverse, on trouve des manuels de lecture portés dans la rubrique instruction morale et civique. Le discours civique (et moral) ne se confine pas en effet aux manuels de la discipline : il irradie l’ensemble de la production scolaire, souvent de façon implicite. Les livres de lecture regorgent de récits patriotiques, les énoncés des manuels d’arithmétique mettent en scène des situations propices à la connaissance des institutions et au développement des vertus civiques, les manuels d’histoire vantent les grands hommes de la Révolution ; les dictées, les exemples grammaticaux, les sujets de rédaction, le libellé des exercices participent du même objectif auquel l’iconographie, qui gagne alors le contenu des livres scolaires, confère une forte charge émotionnelle. La mise en scène de personnages enfantins entraîne un processus d’identification du lecteur au héros, comme dans le Petit Citoyen, de Jules Simon, ou les Enfants de Marcel, de Bruno dont le sous-titre, Instruction morale et civique en action. Livre de lecture courante, témoigne de l’imbrication volontaire des deux corpus disciplinaires.
Mais, dès la fin du siècle dernier, l’enthousiasme manifesté pour l’instruction civique cède le pas à une vision plus critique et la part que lui consacrent les instituteurs dans leur enseignement ne cesse de décroître, ce dont témoigne, entre autres, la production scolaire. L’extension de l’instruction civique – auquel se substitue en 1964 l’éducation civique – au programme des classes du second degré après la Seconde guerre mondiale manifeste les préoccupations de l’institution face à l’ignorance de la jeunesse française, mais elle ne répond pas aux attentes, comme le montrent de nombreuses enquêtes effectuées entre 1957 et 1974. L’enseignement civique pâtit non seulement de la modicité des horaires qui lui sont attribués, mais aussi du comportement des enseignants : confrontés à la crise des valeurs et des institutions, mais aussi à la lourdeur des programmes, notamment d’histoire et de géographie dans le secondaire, ils sont nombreux à ne pas lui consacrer le temps réglementaire, voire à s’abstenir de l’enseigner. D’une certaine façon, l’absorption de l’éducation civique dans les sciences sociales ou les disciplines d’éveil, dans le cadre de la réforme Haby de 1975, consacre cette attitude du corps enseignant.
La réforme Chevènement de 1985 marque certes une rupture. Mais peut-on avancer pour autant que, depuis cette date, l’éducation civique a gagné en efficacité ? Même si elle a un sens, car l’École n’est pas, loin s’en faut, le seul lieu où peut s’effectuer la formation du citoyen, la question reste délicate. L’offre éditoriale n’a jamais été si forte depuis plus d’un siècle, mais le marché des manuels d’éducation civique stagne : les éditeurs ont ainsi calculé qu’au niveau du collège, où l’État s’est engagé depuis 1977 à financer tous les quatre ans le renouvellement des manuels, il faudrait, au rythme annuel, 85 ans pour remplacer les collections de livres d’éducation civique. La pénurie dont souffrent de nombreux établissements scolaires montre clairement que le manuel n’est plus le vecteur privilégié de la formation du citoyen. Mais, tout en conservant à l’éducation civique un statut de discipline autonome, pourvue d’un programme spécifique, les textes officiels les plus récents insistent sur sa dimension interdisciplinaire et sur la nécessité de mettre en cohérence la diversité des apports : « L’éducation civique est l’affaire de tous. [Dans les collèges, le chef d’établissement] favorise l’implication de toute l’équipe éducative dans l’éducation civique. Sur certains thèmes du programme, des projets communs peuvent être mis en œuvre, parfois avec le concours d’intervenants extérieurs. » Ainsi l’éducation civique, centrée sur l’élève, donne-t-elle sens aujourd’hui, à l’ensemble du projet éducatif.
Années |
Enseignement primaire (élémentaire et supérieur) |
Enseignements secondaire et technique |
1880-1884 |
68 |
- |
1885-1889 |
19 |
- |
1890-1894 |
26 |
- |
1895-1899 |
26 |
- |
1900-1904 |
24 |
- |
1905-1909 |
17 |
- |
1910-1914 |
20 |
- |
1915-1919 |
1 |
- |
1920-1924 |
19 |
- |
1925-1929 |
12 |
- |
1930-1934 |
3 |
- |
1935-1939 |
2 |
- |
1940-1944 |
14 |
- |
1945-1949 |
1 |
15 |
1950-1954 |
4 |
6 |
1955-1959 |
2 |
9 |
1960-1964 |
2 |
36 |
1965-1969 |
1 |
30 |
1970-1974 |
5 |
27 |
1975-1979 |
0 |
10 |
1980-1984 |
0 |
5 |
1985-1989 |
53 |
57 |
1990-1994 |
9 |
22 |
1995-1997 |
26 |
31 |