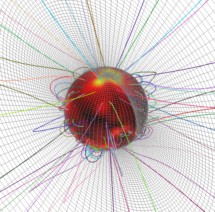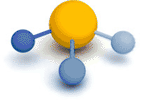|
Lorsque certaine pages d'histoire racontent le dévouement des médecins d'autrefois et, plus encore, leur désintéressement, on retrouve dans les propos: reconnaissance et admiration. Ainsi en est-il du Dr Théodore-Alexandre Talbot. Né à Québec le 4 juillet 1848, fils d'Henri Talbot dit Gervais, marchant, et de Marie Canty. L'acte de baptême nous révèle qu'eut pour parrain son frère Georges, et pour marraine sa soeur Henriette, qui le suivra jusqu'à sa mort, survenue en février 1893. Il était le dernier d'une famille de treize. Il fit ses études au Séminaire de Québec et à l'université Laval de 1870 à 1874, année ou il fut admis à la pratique de la médecine. Installé un ans à St-Judes dans le comté St-Hyacinthe et par la suite quelques temps à Lévis, la lecture d'articles dans le journal Le Canadien, attira son attention sur le lac St-Jean, surnommé "le grenier de la province". Il décida de venir s'établir à Hébertville au début de l'été 1876.
"Le grenier de la province" lui parut bien décevant. Alors qu'à Lévis le grain commençait à pousser, il y avait encore de la neige dans les coulées du lac et les semailles étaient à peine commencées. Le Dr Lacombe partait, il lui demande: "Qu'est-ce que vous venez faire ici?" - "Je viens m'y installer, quoi!" - "Vous allez périr: j'ai manqué moi-même y mourir de faim!" - "Je tâcherai de m'arranger, en élevant des petits animaux..., etc..., etc.... !" - "Vous n'aurez pas ce qu'il faut pour les nourrir ! tout de même je vous souhaite bonne chance ! - Et il avait mille et une fois raison.
N'ayant pas d'argent pour repartir, il resta. Il est resté cependant, partageant sa tranquille vie avec sa soeur Henriette qui tenait sa maison.
Le 29 janvier 1878, il épousa à Hébertville, Marie-Catherine Dumais, de Kamouraska.
En 1881, il ira pratiquer, un ans, la médecine à St-Ephrem de Beauce.
Et pendant qu'il était dans la Beauce, un autre médecin, le Dr Casgrain, est venu tenter l'aventure à Hébertville ; mais n'a pu résister. Il est mort peu de temps des suites des misères qu'il avait dû endurer en effectuant sa traverse de retour pour Québec, par le chemin de St-Jérôme- Québec, en hiver.
Ils sont revenu. Ils ont connu et vu a misère primitive. La vie était très difficiles et la nourriture manquait. Souvent ils n'avaient même pas assez de grain pour nourrir leurs petits animaux. La pratique de la médecine se faisait dans des conditions très dures. Lorsqu'il a dû aller soigner l'abbé Auclerc, curé de St-Prime, ça été une voyage très long, en hiver, dans "un traîneau à poches", pas de dossier, avec une pelle toujours, pour ouvrir les côtes ; tout de même quand venait-le temps de dormir, il dormait là-dedans. Une autre fois on est venu le chercher pour aller à St-Coeur de Marie, il raconte: "Dans ce temps-là, il n'y avait pas de pont Taché ; il y avait une place cependant qui ne "glaçait" pas et qui barrait le passage ; alors les hommes jetaient un peu de neige sur le courant pourtant très rapide à cet endroit, et il se formait ainsi une glace mince, sur laquelle un homme..., léger comme moi ... ! (?), pouvait se risquer de passer en courant".
Et le monde était très pauvre, en sorte qu'on ne payait à peu près pas le médecin.
A son arrivé, il s'était procuré un beau petit cheval de course pour aller aux malades. Comme il voyait souvent en ville, les charretiers attacher la patte de leur cheval avec un boulet, il lui prit un jour l'idée d'attacher la patte de son poulain avec un vieux chaudron, mais son cheval qui était fringuant comme tout, se soucia peu du chaudron s'enfuie comme ça en menant un vacarme d'enfer. Il fut obligé de donner ce beau cheval, pour payer sa pension, chez Monsieur Jovin, où il payait $16.00 par mois, mal nourri.
Un des principaux problèmes qu'il rencontrait était le manque de soucis pour l'hygiène, donc une mortalité infantile très considérable. Il déplorait de voir le lait exposé sur des tablettes dans une chambre à coucher non aérée, de voir essuyer les bols à thé avec le torchon et la malpropreté qui régnait partout. Selon ses dires: "dans les cas d'urgence, le patient mourait tout simplement sans pouvoir recourir aux chirurgiens trop éloignés ; lorsqu'un enfant mourait, on se réjouissait de compter un ange de plus dans la famille".
Les enfants: Marie-Anna née le 7 janvier 1879, décédée le 7 mai 1974 ; Alléluia née le 27 mars 1880 ; Flore née le 1er janvier 1882, au cours d'une brève tentative de pratique à Saint-Ephrem ; Joseph-Henri-Pascal né le 13 septembre 1885 ; Théodora née le 21 avril 1888 ; Jospeh-Alphonse- Alexandre né le 12 décembre 1889.
Se tenant au courant du progrès de la médecine par la lecture des meilleurs ouvrages du temps, il s'intéressait particulièrement aux grand travaux du physiologiste Claude Bernard. Il publia en 1888, un livre de 238 pages, intitulé " Action des boisson enivrantes sur l'organisme humais", imprimé par l'Imprimerie Général A. Côté et Cie. Il recevait des maigres honoraires et, parfois à ceux qui ne pouvaient payer, il ne demandait que des prières. Selon Alléluia "il eut l'intelligence du pauvre" le bon Dieu seul sait tous les pauvres qu'il a soignés pour son amour et des prières, même, il allait jusqu'à faire célébrer des messes pour la guérison de malades que ses soins et ses remèdes ne parvenaient pas à guérir. Quelque fois, il arrivait à la maison en disant: "Alors les filles à genoux, dites le chapelet pour que la Sainte-Vierge guérisse cette mère de famille". Alléluia avoue se rappeler plusieurs guérisons obtenues ainsi, plutôt que par les remèdes.
Parmis les souvenirs de jeunesse il a à nous raconter: j'avais des défaults naturellement, lorsque j'était jeune, un jour je me rends soignaer une jeune fille, comme elle était très belle !..., je l'assois sur mes genous et lui demande si elle y était bien !... elle me repond OUI !...
Il quitte Hébertville en 1918 et alla demeurer un ans à Péribonka puis finit sa carrière à St- Félicien. Il dut cesser de pratiquer en raison d'une cécité croissante, conséquence du glaucome.
Il mourut à l'âge de 92 ans, le 9 février 1941.
Notes:
- Son frère aîné, Guillaume, aurait enseigné aux Etat-Unis et publié un livre sur la manière de comprendre et de traduire le français, Philosophy of french pronunciation, à la librairie Ivison and Phinney, N.Y. en 1854. Il fut réédité sous le nouveau titre French translation selftaught, chez Crosby Nichols and Co., Boston, en 1855.
Dans le mois de juin, dans la coulée du rang St-Urbain, entre le 3ème rang et le rang Caron.
-
Au chapitre IX, il démontre que l'alcool n'est pas la source de chaleur que l'on croit. Ensuite, il réfute la croyance populaire, qui veut que les boissons alcooliques soient un préservatif contre les maladies. Il écrit: "Dans la première année de ma carrière, en 1875, j'ai donné des soins à un grand nombre de varioleux, et je n'ai pas contracté la maladien, qouique le n'aie pas pris un seul verre de boisson durant toute la durée de l'épidémie." Selon le témoignage du fils du docteur Camille Lavoie, celui- ci nous dit que sont père a trouver dans le grenier de la résidence du Dr Talbot, une alambic en très bon état. La vieille cousine Théodora avait une vieille recette pour conserver les framboises dans de l'eau et du sucre, ce jus était un petit remontant.
-
Les premiers temps furent certe difficiles, les médecins dans ce temps là gagnaient très homorablement leur vie.
-
Claude Bernard, physiologiste français (Saint-Julien, Rhône, 1813 - Raris 1878). Malgré le caractère précis et concret de sa méthode expérimentale, qui suppose la croyance au déterminisme, il se
rattache encore, en ce qui concerne la phylosophie générale, au courant positiviste de l'époque, qui nie la possibitlté d'atteindre la vérité absolue. Pour Claude Bernard le comment des choses est seul à notre portée: le pourquoi des choses dépasse notre entendement
|