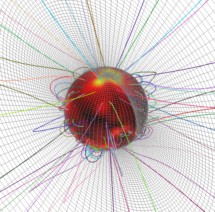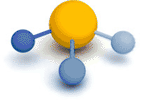|
Guillaume Couture était né à Rouen, en 1617, dans la paroisse de Saint-Godard. Il portait le nom de son père, un maître-menuisier, et se mère s'appelait Madeleine Mallet. On a des raisons de croire qu''il arriva au Canada en compagnie de Père Le Jeune, dès l'année 1632, alors qu''il n'avait que quinze ans. Il semble avoir été immédiatement attaché aux missionnaires en qualité de "donné", c'est-à-dire d'auxiliaire laïc. A dix-sept ans, en tout cas, il est chez les Hurons, dont il apprend la langue de façon à devenir un des meilleurs interprètes de son temps. Mais il a d'autres cordes à son arc, car le catalogue des emplois que tenaient les Pères à Québec indique qu''il est "menuisier", et même "bon ad omnia", c'est-à-dire qu''il sait tout faire. Ce beau certificat nous fait voir que Guillaume est un "débrouillard": la suite de sa carrière ne démentira pas cette première réputation.
En 1641, il y a sept ans qu''il demeure au pays huron. Il en revient l'année suivante comme compagnon du Père Jogues venu chercher du renfort à Québec. Le 2 août 1642, il repart avec le missionnaire, et c'est alors que, dans les îles du lac St-Pierre, les quarante hommes de la flottille sont attaqués par les Iroquois.
René Goupil fut pris le premier. Le Père Jogues et Couture, qui avaient réussi à se défiler dans les hautes herbes, et auraient vraisemblablement pu s'échapper, vinrent rejoindre leur compagnon, non sans que Guillaume eût trouvé moyen de tuer un chef iroquois. Aussi est-ce lui qui dut subir les premières tortures. Elles durèrent plusieurs semaines. On lui arracha les ongles, on lui mordit sauvagement les mains, on lui scia l'index droit avec un coquillage qui remplit si mal son office que le bourreau, pour en finir, arracha le doigt avec le tendons...
Vous savez que René Goupil fut massacré peu après, et que le Père Jogues et Couture eurent la vie sauve. Mais leur sort fut différent: le Père Jogues fut réduit à une forme d'esclavage, tandis que Couture, plus jeune et plus résistant, fut adopté par une famille du canton onnontagué, qui avait perdu un guerrier, dont le prisonnier fut institué le remplaçant, selon la coutume indienne.
Après l'évasion du Père Jogues, qui se réfugia chez les Hollandais dès qu'il comprit que sa mort était décidée, Couture se trouva seul chez les Iroquois. Comme dit J.-Edmond Roy, "il en prit courageusement son parti". Vigoureux, actif, infatigable, pouvant supporter les plus grandes misères et toujours content, habile dans tous les arts chers aux Sauvages, excellent tireur, agile à la course, capable de travailler le bois et de creuser proprement un canot, ce Normand, intrépide comme tous les Normands, ne tarda pas à s'emparer de l'esprit de ses nouveaux compagnons. Il se forma à leurs habitudes, apprit leur langue et fit tant et si bien que l'on finit par l'admettre dans les conseils de la nation. Quand ses amis restés au pays déploraient son sort, Couture trônait dignement au milieu des sachems indiens. Depuis trois ans le bon Guillaume vivait de la vie des bois, jouissant de l'estime et de la considération de ceux qui l'avaient voulu mettre à mort, lorsqu'arriva la nouvelle d'un paix prochaine. Fatigués d'une guerre sanglante, les vieillards de la nation, sans doute influencés par Couture qui avait de l'ascendant sur eux, décidèrent d'enterrer la hache de guerre, et envoyèrent notre héros au gouverneur Montmagny avec deux délégués indiens.
Quand les habitants des Trois-Rivières vinrent arriver, en 1645, Guillaume Couture, vêtu à l'iroquoise et ambassadeur en règle des Cinq-Cantons, ils n'en crurent pas leurs yeux. Ainsi que le rapporte la Relation de l'année, "chacun se jeta à son cou". On le regardait comme un ressuscité... Mais Couture ajourna les explications et s'occupa de son ambassade.
Marie de l'Incarnation a raconté dans ses lettres le détail des cérémonies qui accompagnèrent les négociations. C'était un rituel assez étrange, fait de discours imagés, de présentations de colliers de porcelaine... Les Iroquois se montraient d'une sincérité douteuse: on savait à quoi s'en tenir, le Père Jogues étant là qui écoutait parler de leurs prétendus efforts pour lui sauver la vie!... On accepta cependant la trêve qui s'offrait, et Couture retourna dans les Cantons pour faire ratifier la paix. Parti le 17 juillet, il revint le 17 septembre avec quatre cents Sauvages dont il était le porte- parole. Le traité est enfin conclu définitivement, et Couture repart pour hiverner chez les Agniers. A son retour au printemps de 1646, on le porte en triomphe: il est devenu évident que c'est grâce à lui si l'armistice dure. D'ailleurs, dès qu'il les eût quittés, les Iroquois rompirent la trêve, et c'est cette même année que le Père Jogues fut martyrisé.
Il faut insister ici sur l'autorité singulière de Guillaume Couture auprès des Indiens, et des Iroquois en particulier. Seuls Jean Nicolet et les Lemoyne semblent avoir joui de cette estime et de cette confiance. C'est sans doute pourquoi on donna à Couture le nom indien -"Achirra"- antérieurement conféré à Nicolet, ce qui marquait du même coup le souvenir du regretté disparu et le mérite éminent de son successeur. Un autre trait de cette influence se retrouve dans les dispositions heureuses des Onnontagués envers les Français. Couture ayant surtout vécu dans cette bourgade y avait semé des germes d'amitié et peut-être aussi des leçons de christianisme. A tout événement, c'est dans ce Canton que l'on verra le plus grand nombre de conversions, entre autres celle du fameux chef Garakonthié.
Pour revenir à 1646, Couture est relevé de ses engagements de "donné" envers les Jésuites, deux jours après son retour du pays des iroquois. Une délibération des Pères qui a été conservée laisse même entendre que Guillaume avait alors l'intention de se marier, car son mariage est approuvé à l'unanimité, mais ce n'est que trois ans après, en 1649, qu'il prendra femme. Pour le moment il va passer encore un hiver chez les Hurons: ce sera son dernier séjour dans les bois. Désormais il va se fixer dans la colonie.
Dès 1647, en effet, il se fait colon ; et il sera le premier colon de la côte de Lévis. On sera sans doute surpris d'apprendre qu'à cette date, trente-neuf ans après la fondation de Québec, pas un colon ne s'était encore établi en face, sur la rive droite du fleuve la seule habitation française sur la côte sud était le fort Richelieu, édifié sur le site de la ville de Sorel. Cette rive n'était rien de moins sûre. Il y avait bien une vieille seigneurie concédée en 1636, la seigneurie de Lauzon, qui comprenait trois lieues de front de chaque côté de la rivière "Bruyante" (la Chaudière), sur six de profondeur. Mais personne n'osait s'y installer, alors que les colons affluaient sur la côte de Beaupré et dans l'île d'Orléans, concédées en même temps. Ces dernières concessions étaient sous la protection du fort de Québec, dont elles étaient assez rapprochées, alors que la rive opposée de Lévis, magnifique observatoire, que les Iroquois guettaient les sorties des canots français. On trouve alors, dans le Journal des Jésuites, des mentions de ce genre: "Aujourd'hui nous avons apercevance des Iroquois à la côte de Lauzon". De temps à autres, des sauvages amis ou même des chasseurs imprudents y disparaissaient, au rapport du même Journal.
Il fallait sans doute Guillaume Couture pour y entamer le défrichement. Lui seul pouvait braver les Iroquois qui le connaissaient bien, et qui, de fait, lui porteront toujours une grande estime. Couture, une fois installé sur la côte de Lauzon, recevra leur visite. On signale même qu'en 1658 trois Iroquois, qui allaient porter la guerre à Tadoussac, brisèrent leur canot sur la rive sud, qu'ils longeaient trop près afin de passer inaperçus du fort de Québec. Or ils n'hésitèrent pas à aller demander asile à Couture, considérant sa maison comme un refuge assuré. A leur yeux, il semble que Couture fût resté Iroquois d'adoption...
Donc, en 1647, nous voyons Guillaume faire sa trouée, la hache à la main, dans la forêt lévisienne, sur la pointe de Lévy, aujourd'hui Saint-Joseph de Lauzon. Il travaille si bien qu'à l'automne on lui offre deux cents livres pour un petit corps de logis... avec quelques quantités de bois abattu autour du dit lieu. L'offre lui vient d'un bourgeois de Québec, François Bissot, qui a sur la pointe de Lévy une concession voisine de celle de Couture. Cette terre de Bissot, sur laquelle sera construite l'église de Lauzon, sera défrichée par Couture, qui y travaillera en même temps qu'il ouvrira la sienne. Guillaume est dès lors fixé à cette côte de Lauzon, où il finira ses jours...
Cependant il est trop précieux pour qu'on le laisse à sa besogne de défricheur. Sa vie va être émaillée, pendant dix ans encore, de missions et de voyages d'un grand intérêt et d'une grande utilité. En ces occasions, il laisse sa ferme à des engagés, et il va où on requiert ses services.
Mais il faut d'abord signaler son mariage avec Anne Aymard, Poitevine née à Niort ; la cérémonie eut lieu en 1649 dans la propre maison de Couture, et fut présidée par Messire Jean Lesueur, ancien curé de Saint-Sauveur-en-Normandie, ami de l'ingénieur Jean Bourdon qu'il avait suivi au Canada, et alors chapelain des Hospitalières de Québec. Deux des témoins au mariage sont, Olivier Letardif, l'interprète, et Zacharie Cloutier, fils du compagnon et censitaire de Robert Giffard: tous deux devenaient ce jour-là les beaux-frères de Couture, ayant eux-mêmes épousé Barbe et Madeleine Aymart...
Voyons maintenant Guillaume Couture voyageur et ambassadeur. En 1667, il est employé dans les négociations qui tendent à fonder un village français chez les Iroquois Onnontagués. La fondation eut lieu, mais nous savons qu'elle ne put être maintenue, la guerre ayant repris avec les Cinq-Cantons. En 1661, il accompagne Denys de la Vallière et les PP. Dablon et Druillettes qui vont essayer d'atteindre la baie d'Hudson par la voie du Saguenay et du lac Saint-Jean. Mais ici encore la guerre iroquoise empêche le succès du voyage. On doit s'arrêter au lac Nécouba, appelé sur nos cartes Nicabau, et qui est situé tout près de la ligne de partage des eaux, au 74 de longitude ouest par 49 de latitude nord, soit à mi-chemin entre l'embouchure du Saguenay et de la baie James. En 1665, Guillaume Couture fait un de ses nombreux voyages de traite chez les "Sauvage du Nord", comme on disait à l'époque. Ce voyage, raconté dans la Relation de 1665, nous montre Couture, en compagnie du Père Henri Nouvel, abordant l'île Saint-Barnabé, en face de Rimouski, et de là traversant le fleuve pour aller chez les Papinachois, qui avaient leur habitat à l'est de Bersimis. Couture hiverna avec le missionnaire. ce ne dut pas être la seule occasion qu'il eut de fréquenter ces parage, car il était alors en société commerciale avec l'interprète Charles Amyot, Noël Jérémie et Sébastien Prouvereau, d'après un contrat retrouvé dans le greffe du notaire Duquet, à la date du 28 mai 1665, et qui fait allusion à d'autres conventions antérieures. Enfin, en 1666, Couture prend qualité d'ambassadeur de la colonie lorsque Monsieur de Tracy l'envoie protester auprès des Hollandais du fort Orange, à l'occasion de meurtres commis par les Agniers, dont les bonnes dispositions avaient été garanties par les Hollandais. Couture retrouve une vieille connaissance, le vieux Colar, qui avait tenté, vingt-cinq ans plus tôt, de racheter le Père Jogues. Colar donna des explications satisfaisantes, et Couture, qui n'avait jamais peur de rien, se rendit de là directement chez les Agniers, auxquels il persuada de demander la paix, ce qu'ils firent en 1667. On voit ici que Couture était tout désigné pour mener à bien sa délicate mission: il connaissait tous les personnages intéressés. Ces diverses aventure montrent Guillaume toujours disposé à rendre service, et peut-être aussi ayant grand plaisir à reprendre les espaces sauvages...
Il se rend compte tout de même à cette époque (1667) qu'il a déjà neuf enfants, et que sur sa belle terre de six ou sept arpents de front qu'il a dû négliger au cours de ses missions diplomatiques, vingt arpents à peine sont en culture, et il a déjà plusieurs bouches à nourrir... Aussi, à partir de cette année-là, il ne paraît plus s'éloigner de sa ferme, où il élève les dix enfants qui lui sont nés de 1650 à 1670.
Mais il ne resta pas simple cultivateur. On lui confiera des responsabilités assez lourdes: il est toujours, comme en 1640, propre à tout faire. Ainsi il sera notaire, ou plutôt tabellion ou garde- notes, comme on disait en ce temps pour parler des personnes assez instruites pour présider à des contrats. Il fera plusieurs actes, qui sont maintenant perdus, mais dont il est fait mention dans certains greffes anciens. On cite entre autres un contrat du 17 octobre 1665, en disant que Couture était pour lors notaire. Il fut aussi élu capitaine de milice par les colons de Lévis, probablement à la suite de l'ordonnance du roi Louis XIV qui, le 3 avril 1669, régla le service des milices en Nouvelle-France. C'est à ce titre qu'il dut commander les troupes qui empêchèrent Phipps de débarquer des soldats sur la côtes sud en octobre 1690. Ajoutons que les capitaines de milice n'étaient pas seulement commandants militaires. "Ils devaient percevoir les impôts, exécuter les ordonnances des gouverneurs et intendants, surveiller la confection et l'entretien des chemins sous la surveillance des grands-voyers". Le capitaine de milice commandait encore les corvées, présidait aux dénombrements,... convoquait les assemblées des habitants. Mais Couture fut investi d'une dignité encore plus imposante. En 1713, il fut nommé juge-sénéchal de la seigneurie de Lauzon, cette charge nouvelle était équivalente à celle de juge seigneurial. On pouvait appeler de ses jugements à la cour de Québec, mais le juge-sénéchal était le premier à connaître des litiges dans la seigneurie. Ses fonctions ne se limitaient pas à décider des contestations ; il devait encore présider aux inventaires, apposer les scellés, remplir l'office de nos coroners d'aujourd'hui. Il semble avoir résigné sa charge en 1678, car alors il a un remplaçant, Jacques de la Lande. Mais il reprit ses fonctions en 1682, et il resta juge-sénéchal jusqu'à sa mort.
Il est assez singulier qu'on ne puisse savoir la date exacte de son décès. Son acte de sépulture ne se trouve ni à Québec ni à Lévis. On a calculé qu'il dut mourir en 1702, car le greffe des notaires contient un inventaire de ses biens fait cette année-là. Il fut peut-être emporté par l'épidémie de petite vérole ; elle sévissait en 1702 à Québec et elle fut fatale au quart des habitants. Il avait alors quatre-vingt-cinq ans ; et il laissait dix enfants, trente-neuf petits-enfants, et cinq- arrière-petit-enfants.
�Contrat de mariage entre Guillaume Couture et Anne Esmard. Audouard, 18 novembre 1649.
En faisant et traittant le Mariage qui au plaisir de Dieu sera faict et accomply en face de nostre Mers la Ste-Eglise Catoliq. Apostolique et Romaine entre honnestre homme Guillaume couture fils de feu Guillaume cousture et de Margdeleine Malet vivants ses pere et Mere de la parr. de St Godard de la ville de Rouen et Anne Emars fille de feu Jean Emar et de Marie Bureau ses pere et Mere de la parr. de St André de la ville de Niord. ledict cousture assisté de françois cousture Antoine baudouin Martin grouvel et Charles Cadieu parents voisins et alliés. et lad. Emard aussi assistée de Mr Ollivier le tardif Seigneur en partie de Beaupré de Zacharie cloustier le jeune ayant espouse avec tous les droicts quelle peut pretendre ..... de la succession de ses pere et Mere et au cas que lesd. mariez viennent a mourir sans hoirs chacun iouira de ses droicts iouxte et suivant la coustume de paris et en outre Ledict Sr Tardif pour Lamitié et bonne Affection quil porte a lad. Anne Emard Luy a donné Un Lict de plume garny de couvertes et de son tour avec une vache a laict dont de ce que dessus lesd. parties sont demeurées daccord et ont eu pour aggréable en pnce. de Mr. Jean le Sueur pretre Estienne Racine Louys Couillard et Jean Cloustier demeurants aud. Kebec tesmoings ce dix huitct et Jean Cloustier demeurants aud. Kebec tesmoings ce dix huict jour de novembre mil six cents quarente neuf et lad. Anne Emard a déclaré ne pouvoir signer pnce. desd. ts.
-
G. Cousture
-
Letardif
-
A. Baudouin.
-
F. couture
-
ZaCarie cloutier
-
Charles Cadieu.
-
barbe emard.
-
E. Racine
-
Louis Couillard.
-
J. Le Sueur, 1649.
-
La marque dud. martin grouvel.
-
La marque de Jean cloustier.
-
x iustement et esperer
|