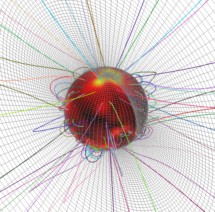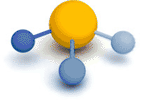|
Tous ceux qui sont venus en Nouvelle-France ont dû accepter, comme premier sacrifice, la traversée de l'océan. Pour nous, un voyage en mer prend figure d'excursion alléchante. Il en allait autrement à l'époque des voiliers. Nous ne pouvons comprendre la qualité d'âme de nos ancêtres si nous essayons pas de les suivre dans cette première étape. Il fallait autrefois, pour affronter l'océan, un courage dépassant la commune mesure. Les aventuriers de la mer, audacieux, durs à la misère, y trouvaient une joie excitante, mais en était autrement pour les terriens, les paysans, les chefs de famille, les femmes et les enfants. Pour eux, le voyage était un véritable martyre.
Ceux qui s'embarquaient pour la Nouvelle-France savaient qu'ils allaient à péril de mort. Aussi chacun se confessait, communiait, rédigeait son testament.
Le voyage durait de six à douze semaines. Les navires étaient petits, trapus, malodorants, dépourvus de tout confort. On y trouvait ni cabine, ni toilettes, ni lavabos ; aucun chauffage ni éclairage. La cale était encombrée de tonneaux d'eau douce, de biscuits de marin, de cidre et de vin, ainsi que de barriques de farine, de lard salé, de pois secs. Le pont était réservé aux matelots et à l'équipement: câbles d'ancres, cordages de mâture, ancres, chaînes, mâts de rechange, plaques de plomb, goudron, étoupe, etc..
Les passagers logeaient dans l'entrepont, bas de plafond, mal aéré, pauvrement éclairé par les sabords et par l'écoutille, ouvertures qu'il fallait fermer hermétiquement lorsque la mer était méchante. Alors l'obscurité et la puanteur transformaient l'abri en prison infecte, dont les passagers n'étaient libérés qu'une fois le calme revenu.
Le Père Biard, en route vers l'Acadie, en 1610, exprime ainsi ses doléances:
-
Naviguer en ce trajet de la Nouvelle-France, si dangereux et si aspre, principalement en petits vaisseaux et mal munitionnez, est un sommaire de toutes les misères de la vie. Nous n'avions repos ni jour ni nuict. Si nous pensions prendre nostre réfection, nostre plat subitement eschappoit contre la tête de quelqu'un ; un autre tomboit sour nous, et nous contre quelque coffre, et tourneboulions avec d'autres pareillement renversez ; nostre tasse se versoit sur nostre lict, et le bidon dans nostre seing, ou bien un coup de mer mandoit nostre plat.
Une compagne de Marie de l'Incarnation, Soeur Cécile de Sainte-Croix, relate à son tour quelques-unes de ses expériences maritimes, au cours de la traversée de 1639:
-
Nous eûmes une furieuse tempête qui dura quinze jours avec fort peut d'intervalle... ; le vaisseau était tellement agité durant tout ce temps qu'il était impossible de se tenir debout, ni faire le moindre pas sans être appuyée, ni même assise sans se tenir à quelque chose, ou bien on se trouvait incontinent roulé à l'autre bout de la Chambre. On était contraint de prendre les repas à plat terre et tenir un plat à trois ou quatre, et même ainsi on avait peine de l'empêcher de verser.
Les conditions ne s'améliorèrent que très peu avec les années. En 1734, le P. Nau se plaint du local où logent les voyageurs:
-
C'est une chambre grande comme la Rhétorique de Bordeau, où l'on voit suspendus en double rang des cadres qui devaient servir de lit aux passagers, aux passagères, aux officiers inférieurs et aux canonniers. Nous étions pressés dans ce lieu obscur et infect comme des sardines dans une barrique. Nous ne pouvions nous rendre à nos lits sans nous heurter vingt fois la tête et les jambes. La bienséance ne nous permettait pas de nous déshabiller. Nos habits, à la longue, nous brisaient les reins. Le roulis démontait nos cadres et les mêlait les uns les autres.
Par une brise normale, la situation était moins pénible. Les sabords et l'écoutille laissaient entrer un peu de lumière et d'air marin ; on pouvait aussi monter sur le pont, causer, scruter l'infini de la mer, vers la France ou vers la Nouvelle-France, selon le cours des regrets ou des espoirs.
Outre les réunions joyeuses, les chants et parfois les rondes, le pont était souvent animé par des cérémonies religieuses, messe, sermon, procession.
Les accalmies prolongées étaient rares. La brise d'ailleurs était désirée, car, par calme plat, le navire s'immobilisait, prolongeant la traversée. Les voiliers, trapus, ronds de quille, roulaient et dansaient, même par beau temps. Cette instabilité bouleversaient les estomacs. La mauvaise qualité des mets et les torsions du roulis et du tangage rendaient la digestion pénible. La plupart des voyageurs étaient torturés par le mal de mer. Diéreville s'en plaint avec humour:
Aussi je me sentais épuisé, toujours rendre et ne rien prendre, cela ne soutient point du tous les forces.
La gaieté de marin, soutenait-il, maintenait le moral des voyageurs:
Dans cette affreuse tourmente, j'admirais le courage de tous les matelots. Parfois ils étaient renversés et ballottés comme une balle de plume d'un bord à l'autre du pont. Tout cela ne faisait qu'exciter des éclats de rire qui faisaient autant de bruit que les coups de mer.
Les menus manquaient de saveur et de variété. Les provisions apportées par les voyageurs s'épuisaient vite et il fallait alors adopter le régime commun: pois secs, haricots, poisson fumé, salaisons, biscuit de matelot. Ce biscuit, soumis dans les soutes à la chaleur et à l'humidité combinées, se gâtait pourtant moins que les autres provisions. N'ayant pas le choix, on mangeait avec appétit, mais de préférence la nuit, pour ne pas voir les vers et sentir moins la pourriture.
Les santés les plus robustes résistaient mal à Pareil régime. La dysenterie, le scorbut, la furonculose, la fièvre putride, exerçaient leurs ravages parmi les voyageurs. Pour sa part, Pierre Boucher verra mourir, au cours de la traversée de l'été de 1662, soixante des cent colons qu'il amenait en Nouvelle-France. Soixante morts lentes, angoissantes ; soixante corps se décomposant, tombant en pourriture, jetés un à un à la mer. Quelle effroyable atmosphère suggère cette macabre évocation.
Dans son récit de voyage de 1685, Mgr de Saint-Vallier relate, comme un événement presque normal, la mort de 150 hommes et de deux des neuf prêtres qui l'accompagnaient:
Deux des prêtres qu'on avait embarqués avec cinq cents soldats qui passaient avec nous, furent les plus heureux de tous ; car outre les exercices de piété qu'ils firent faire à l'équipage et aux passagers, comme on le faisait dans les autres navires où nous étions, il plut à Dieu de leur fournir une nouvelle matière de zèle, par la maladie qui se mit dans les troupes, et qui enleva cent cinquante hommes.(...) L'un des prêtres mourut dans le vaisseau peu de temps avant qu'il touchât au port, et l'autre languit encore quelques jours après être arrivé à Québec.
Le facétieux La Hontan trouve moyen de plaisanter sur pareil thème:
Au reste nous agîmes fort honnêtement avec le peuple des morues qui habite en ces quartiers-là (Terre-Neuve) ; car s'il nous envoya de quoi faire bonne chère en maigre, nous lui servîmes le corps d'un capitaine et de plusieurs soldats morts de scorbut et à qui nous ne pouvions donner d'autre sépulture que la mer.
L'arrivée en vue de Terre-Neuve mettait le vaisseau en joie ; des réjouissances bouffonnes marquaient cet événement et chacun devait payer son écot au Bonhomme Grand Banc. Tous les passagers capable de monter sur le pont sentaient le besoin de remuer, de rire, de se détendre.
La perspective de manger enfin de la nourriture fraîche augmentait l'allégresse générale. Dès que les morues consentaient à mordre, plus rien ne comptait... pas même les sermons:
Le jour de la Pentecôte, comme j'étais près de prêcher, ce que je faisais ordinairement les dimanches et bonnes fêtes, un de nos matelots se mit à crier: molue, molue! Il avait jeté sa ligne et en tirait une grande. Il y avait déjà quelques jours que nous étions sur le banc, mais on n'avait quasi-rien pris. Ce jour-là on prit autant qu'on voulut. C'était plaisir de voir une si grande tuerie et tant de sang répandu sur le tillac de notre navire. Ce rafraîchissement nous vint fort à propos, après de si longues bourrasques.(R.P. Lejeune, s.j.)
En approchant des côtes, on pouvait se rendre à terre en barques, se gorger d'eau fraîche se rafraîchir et se débarbouiller, ce qui n'était pas un luxe après des semaines passées sans pouvoir se laver faute de savon et d'eau douce. La cueillette des fruits sauvages et la chasse au gibier à poil ou à plumes apportaient des suppléments au menu quotidien.
L'inconnu de la vie neuve qui s'ouvraient, la perspective de prendre pied sur la terre ferme, réveillaient la confiance. Le cauchemar semblait fini et on oubliait les autres misères qu'il faudrait affronter.
|