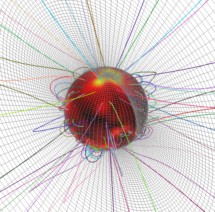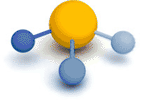|
Le maître charpentier Zacharie Cloutier naquit vers 1590 à Saint-Jean-de-Mortage au Perche. On connaît bien ses antécédents puisque des recherches effectuée en France ont permis de découvrir des actes notariés de concernant ainsi que ses parents. Le 2 mars 1633, devant Mathurin Roussel notaire à Mortage, il sert d'arbitre entre son père Denis Cloutier et un de ses frères, Jacques Cloutier qui s'apprêtaient à entrer en procès pour une question d'héritage. Cet acte fait mention également de la mère de Zacharie Cloutier, Renée Brière qui était décédée au moment de la passation de cet acte, ayant été inhumée à Mortagne le premier mai 1608. Denis Cloutier père de Zacharie ne resta pas veuf longtemps puisque le 3 novembre 1608, il épousait Jeanne Rahir (Gauthier) de la paroisse Notre-Dame de Mortagne. Il décéda à Mortagne où il fut inhumé le 11 décembre 1634. A cette date, Zacharie Cloutier habitait déjà à Beauport.
Le 18 juillet 1616, Zacharie Cloutier épousait à St-Jean de Mortagne, Saincte Dupont, veuve de Michel Lermusier de la paroisse de Feings. De leur union naquirent six enfants donc cinq les accompagnèrent en Nouvelle-France.
C'est à l'instigation de Robert Giffard que Zacharie Cloutier décida de quitter la Perche pour le Canada. Le 14 mars 1634, par contrat passé devant le notaire Mathurin Roussel de Mortagne, il s'engageait à venir travailler pour le sieur Giffard en sa seigneurie de Beauport pour cinq ans. Mais le fait qu'il amenait sa femme et ses enfants prouve qu'il avait bel et bien l'intention de s'y installer définitivement. D'ailleurs le contrat passé avec Giffard stipulait que ce dernier lui concéderait 1,000 arpents de terre, une fois son engagement terminé. De plus, Giffard s'obligeait à lui faire bâtir une maison. C'est ainsi qu'en avril 1634, Zacharie Cloutier, Xainte Dupont et leurs enfants; Zacharie, Jean,Charles, Anne et Louise quittèrent Mortagne pour Dieppe et s'embarquèrent sur un navire qui les conduisit à Québec le 4 juin suivant.
La première préoccupation de Zacharie Cloutier, dès son arrivée à Beauport, fut sans doute d'y bâtir maison habitable dans les plus bref délais. Conjointement avec Jean Guyon selon le contrat passé à Mortagne, Zacharie Cloutier construisit pour les deux familles une maison de charpente mesurant trente-cinq pieds de longueur sur seize de largeur, et six pieds de hauteur sous les poutres.
Après trois années employées à défricher les terres du seigneur Giffard, ce dernier remplit les termes du contrat passé à Mortagne, en lui concédant les mille arpents de terre promis, le 3 février 1637, devant le notaire De Lespinasse. Ces terres, Zacharie Cloutier et Jean Guyon les avaient reçues conjointement, c'est pourquoi le 10 décembre 1637 ils procédèrent au partage. Nous voyons apparaître au bas de cet acte la marque particulière de Zacharie qui pour signer dessinait une hache de charpentier.
Maintenant libre de travailler pour les siens, en bon maître-charpentier, Zacharie Cloutier prend des contrats qui lui permettront de vivre assez aisément puisque déjà ses enfants approchaient l'âge du mariage. Un des premiers contrats qui ait été conservé et qui le concerne fut passé devant le notaire Piraube, mardi le 23 juillet 1641. Pour la somme de 600 livres, Zacharie Cloutier s'engageait envers les religieuse Hospitalières "de leur faire bien et deument au dire douvriers et gens a ce cognoissants Ung Comble de charpenterie sur la moictcyé du bastiment qui est commencé."
En janvier 1643, le 26, c'est envers les Messieurs de la Compagnie de la Nouvelle-France représentés par Antoine Tabouret dit Saint-Amour qu'il "s'engage à employer trente six jour de cinq himmes, au travail de pièces de bois." Cloutier devait commencer le travail de deux février suivant. Il n'y avait pas encore terminé ce marché qu'il en passait un second. Cette fois en compagnie de Noël Langlois, il s'engageait envers les Messieurs de la Compagnie de "leur fournir deux cens de bonnes planches de dix pieds de long et de dix poulces de hauteur et de pouce franc scier."
Ces planches en réalité étaient déjà sciées et rendues au bord de l'eau prêtes à être transportées. Il recevait pour ce travail un poinson de farine, de quoi le fournir en pain pendant un ans.
Déjà en 1636, Zacharie Cloutier et Jean Guyon avaient contesté les termes de leur contrat les liant au seigneur Robert Giffard. le gouverneur Montmagny avait dû intervenir, et donna raison à Giffard. La querelle venait de l'interprétation qu'on faisait du contrat de 1634. Il s'agissait d'une question d'apostrophe, mais d'une importance capitale pour les deux censitaires. En effet, Robert Giffard dans le contrat d'engagement leur avait promis à chacun d'eux mille arpents de terre. Comme le notaire à l'époque n'était pas forts en ponctuation, le texte se lisait "à chacun deux milles arpents de terre". Cloutier et Guyon réclamèrent donc deux mille arpents de terre chacun. Ces derniers cependant ne se comptant pas pour satisfaits , revinrent à la charge, car selon les termes du contrat Giffard se devait de les payer pour les bonnes terres qu'ils avaient aidé à défricher. Comme le sieur Giffard ne pouvait les rembourser autrement qu'en leur accordant plus de terre, ces derniers crurent que pour satisfaire ces dettes ils joindraient à leur fief les terres en rotures sans en faire payer les cens et rente. Giffard ne l'entendait pas ainsi, exigeant le payement des cens et rentes. Cloutier et Guyon se rebellèrent, ne voulant pas prêter foi et hommages à leur seigneur. cette coutume obligatoire pour les propriétaires de fief ne plaisait pas aux deux compères qui refusèrent de s'y plier. Le gouverneur Montmagny, ayant, le 4 mai 1642, porté un jugement définitif en faveur de Giffard au sujet des limites des fiefs Du Buisson et de La Clousterie, on pouvait procéder à un dépôt final de prise de possession de leurs fiefs par Zacharie et Jean Guyon. Le vendredi 23 janvier 1643, le notaire Piraube produisit cet acte de dépôt. Dès lors, Zacharie Cloutier fut contraint de prêter foi et hommage. Il s'y refusa si bien que Robert Giffard dut faire une nouvelle requête le 2 juillet auprès du gouverneur.
Suite au jugement du gouverneur daté du 19 juillet, Cloutier et Guyon laissèrent traîner l'affaire si bien que le 30 juillet Robert Giffard fit une sommation leur ordonnant de présenter l'aveu et dénombrement de leur fief. Au lieu de cela, les deux compères présentèrent leur foi et hommage et ce n'est qu'un jugement du gouverneur, en date du lundi 20 août 1646 qui les força à présenter l'aveu et dénombrement de leur fief.
Ces chicanes n'empêchèrent pas la vie de continuer. Déjà Zacharie Cloutier avait marié sa fille Anne à Robert Drouin le 12 juillet 1637. Jeudi le 26 octobre 1645, c'était Louise qui à son tour épousait l'interprète François Marguerite.
Le maître-charpentier n'en perdait pas pour autant son intérêt pour la construction de maisons. Il s'adjoignit un jeune homme, Nicolas Giffard, qui, enfant avait servi les Jésuites comme interprète pendant quatre ans chez les Hurons. Zacharie Cloutier l'engagea à son service pour une période de cinq ans, à 40 livres de salaire par année. Ils firent quelques profits par la vente de peaux de castors.
En février 1648, Anne Cloutier femme de Robert Drouin décéda. Elle fut apportée le 4 à l'Hôpital, où on alla dire vespres des morts... à l'issue des vespres on fit la cérémonie à l'entour du corps qui ensuite fut porté au cimetière. Ils ne le voulurent pas traîner sur la traîne; ils furent contraints de le porter à deux à raison des chemins étroit. On envoya de la paroisse 4 cierges, 4 torches, la croix et le Psautier; le lendemain on dit une grande messe à la paroisse.
Ces épreuves passées, Zacharie Cloutier continua son bon travail de charpentier en promettant à Mathieu Huboust dit des Longchamps, maître-armurier, de lui bâtir la charpente d'une maison de vingt-cinq pieds de long et de dix-huit pieds de large. Ce contrat décrit en détail la façon dont la charpente devra être faite. Cette maison, comme spécifie le contrat, devra avoir:
"deux bouts Rabattus en Coupe Unne poultre de dix poulces en carré pour porter le plancher de la chambre Unne aue piece de huit a neuf poulces au mesme plancher quy sera supporter de la cloison quy faict separaxx de la chambre avec la chambrette"...
Le texte se continue ainsi de façon très précise. Zacharie Cloutier s'y conforma sans doute, car pour son travail il reçut 450 livres, et put faire réparer un pistolet et trois fusils par le maître- armurier Huboust.
Occupé à construire des maisons, Zacharie Cloutier n'avait guère le temps de cultiver; il dut cependant se préoccuper de la terre de son genre Robert Drouin. Suite au décès de son épouse Anne Cloutier, ce dernier contracta mariage avec Marie Chapelier. Il décida d'aller vivre avec cette dernière et les enfants issus de son premier mariage dans la région de Trois-Rivières. Son beau-père ne l'entendait pas ainsi. Il s'opposa à ce qu'il les emmène à Trois-Rivières "disant qu'il appréhendait que les enfants fussent mal traité par cette nouvelle femme". pour compenser, il s'engagea à les prendre et nourrir pourvu qu'on lui laisse s'occuper des biens qui leur revenaient de la succession de leur défunte mère. Drouin consentit à cela, et la terre de la Rivière-aux-Chiens fut partagée de façon à ce que les enfants aient leur part. C'est donc à la suite de cet engagement que Zacharie Cloutier loua en leurs noms un arpent et douze perches et demie de terre ensemencés en blé, à Michel Blanot, à raison d'un poinçon de blé et l'obligation pour ce dernier d'ensemencer et de partager la moitié de la récolte avec lui.
Un ans plus tard, et sans doute pour l'attirer plus près de son travail, le gouverneur Dailleboust lui concéda une place pour bâtir située sous le Sault-au-Matelot, contenant 40 pieds de long sur 24 de large. Il semble y être demeuré quelque temps et s'en servit sans doute comme pied-à-terre pendant le temps qu'il fut appelé à travailler au fort Saint-Louis.
Jouissant par contre d'un vaste fief qu'il ne pouvait pas faire valoir seul, il décéda d'y concéder des terres, ce qu'il fit en faveur de Michel L'homme, le dimanche 19 mars 1656. Cependant, ce dernier lui rétrocéda cette terre le 27 février 1663.
En 1661, tous les enfants Cloutier étaient marié, et leurs parents maintenant bien établis à Beauport semblaient filer le parfait bonheur. C'est ce que nous apprend une lettre que Xaintes Dupont l'épouse de Zacharie Cloutier fit parvenir en France cette année-là. Cette lettre, qu'il vaut la peine de reproduire ici, nous donne un bon aperçu de la vie de nos ancêtres à cette époque.
|
|
Bien chers parents
Le retardement de cette lettre ne vous aura pas causé d'inquiétude. j'espère. Elle partira par les derniers bateaux de la saison. Croyez que je ne suis pas tant éloignée de vous d'esprit que de corps.
Nous sommes tous en bonne santé.
Jean, notre garçon, a cinq enfants. L'aîné, "petit Jean" a huit ans et Anne, la dernière des quatre filles, n'a qu'un an. Il est marié à Marie Martin, la fille d'Abraham.
Charles est entrée en ménage, il y a deux ans, avec une fille bien apparentée, Louise Morin. Leur petite Ursule a bonne envie de vivre.
Pour Louise, vous avez appris que son défunt mari s'est noyé. Elle a épousé en secondes noces Jean Migneau-Chatillon de Bayeux. Un de leurs fils part pour l'Acadie où il va s'établir.
Nous avons eu bien peur des sauvages tout l'été. Au mois de juin, huit habitants de la côte de Beaupré ont été massacrés par les Iroquois, ce sont les épreuves du pays. On ne peut s'aventurer à l'orée d'un bois sans que la décharge d'un fusil abatte une personne. Si on s'embarque en canot, il est poursuivi et coulé par un sauvage caché dans les environs. Le feu prend au moment où l'on s'y attend le moins autour des cabanes des sauvages de Sillery ou de l'île d'Orléans, même de celles des Français.
L'hiver, nos gens vont à la pêche à la morue et au loup-marin, à Gaspé. Le Saint-Laurent est alors couvert de glace. Devant Québec, il sert de pont. On marche dessus comme une belle plaine.
Mon mari demeure toujours sur son fief de la Clouterie; mais il a dans l'idée de le vendre à Nicolas Dupont de Neuville. Quand le marché sera conclu, nous irons demeurer au Château-Richer. Il y a une église là, puis nous serons près de nos enfants qui y ont de beaux biens.
Lorsque nous sommes venus ici, il n'y avait que cinq ou six petites maisons; tout le pays était de grandes forêts pleines de halliers. Maintenant, Québec est une ville et il y a plusieurs villages tout autour.
Tous les parents, tous les amis vous font des respect. Moi, c'est sans feintise que je demeure,
Votre toute dévouée,
Xaintes Cloutier
Dans cette missive Xainte Dupont allusion au dessein de Zacharie Cloutier de vendre son fief au sieur Nicolas Dupont. Cependant on les voit hésiter à réaliser cette vente puisqu'ils obtiennent l'accord de leurs enfants au fait de céder le fief de La Clousterie à leur fils aîné Zacharie.
Le dimanche 12 mai 1669, considérant leur grand âge et l'impossibilité de se suffire à eux- mêmes, ils donnent et vendent à leur fils aîné Zacharie et son épouse Madeleine Esmard tous les biens meubles présents et à venir pour le reste de leur vie sans rien retenir à condition qu'ils leur assurent loyer, vêtement et nourriture jusqu'à leur décès, et qu'après leur trépas ils partagent ces biens avec leurs frères et soeurs.
Fidèles aux termes de leur missive de 1661, Zacharie Cloutier et Xaintes Dupont vendent leur fief de La Clousterie à Nicolas Dupont de Neuville, par-devant Gilles Rageot notaire, mercredi le 10 décembre 1670. Ils retirent de cette vente 4,500 livres tournois dont 600 livres pour la terre dont ont hérité les enfants Cloutier suite au retrait de Charles Turgeon. Nicolas Dupont fut fidèle à ses paiements et versa l'argent demandé dont il reçut quittance le 16 octobre 1674. Pour régler le tout, Zacharie Cloutier avait donné une procuration à Pierre Maheu des Hazards.
Après cette vente, les époux Cloutier se retirèrent chez leur fils Zacharie à Château-Richer. Les année ayant fait leur marques, le vieillard originaire de Montagne, âgé d'environ 87 ans, s'éteignit à Château-Richer le 17 septembre 1677. Sa veuve lui survécut encore trois ans et fut inhumée au même endroit le 14 juillet 1680.
|
|
Zacharie Cloutier, fils de Denis et de Renée Brière, de St-Jean de Mortage.
Xaintes Dupont.
| Les enfants: |
|---|
|
Zacharie (1617) | né à Saint-Jean de Mortagne, le 16 août 1617; marié(ct Teuleron, notaire à la Rochelle, 29 mars 1648) avec Madeleine Esmart, native de Niort, fille de feu Jean Esmart et Marie Bineau. Il signait: Sr de la Clouterie et commis de la Communauté de MM. les habitants de la Nouvelle-France. Inhumé à Château-Richer, le 3 février 1708. Les enfants: Barbe-Delphine, René, Sainte, Geneviève, Marie- Madeleine, Marie, Charles et Pierre;
| |
Jean (1620) | né le 13 mai 1620; marié à Québec, le 21 janvier 1648 avec Marie Martin la fille d'Abraham. Inhumé le 16 octobre 1690. Les enfants: Anonyme, Jean, Marguerite, Louise, Anna, Sainte, Joseph, Pierre- Paul, Pierre, Françoise, Angélique-Geneviève, Agnès et Marie-Madeleine;
| |
Saincte (1622) | née le 1er novembre 1622, inhumée le 19 septembre 1632;
| |
Anne (1626) | née le 19 janvier 1626, se marie avec Robert Drouin, le 12 juillet 1637; inhumée le 4 février 1648;
| |
Charles (1629) | né le 3 mai 1629, se marie le 20 avril 1659 avec Louise Morin, fille de Noël Morin et d'Hélène Desportes; inhumé le 5 juin 1709. Les enfants sont: Elizabeth-Ursule (Nicolas Gamache, Québec 1676); Marie-Madeleine (Paul Tessier, Château-Richer 1681); Marie-Anne (Charles Gariépy, Château-Richer 1684); Jeanne (Claude Gravel, Château-Richer 1687); Louise (Nicolas Bonhomme, Château-Richer 1695); Charles; Hélène (Pierre Gagnon, 1696); Marie (Joseph Gagnon, Château-Richer 1699); Jean-Baptiste (Anne Morisset, Château-Richer 1702); Zacharie (Jeanne Bacon, Château-Richer 1708); Augustin; Joseph (Elizabeth Morin, 1720);
| |
Louise (1632) | née le 18 mars 1632; se marie trois fois, avec François Marguerite, le 26 octobre 1645; Jean Mignot, le 10 novembre 1648; Jean Mataut, le 3 février 1684; inhumé le 22 juin 1699.
|
|