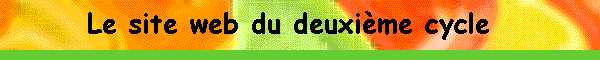
![]()
|
|
|
Criocère du lys
Le criocère du lis passe l'hiver à l'état adulte, enfoui sous terre. Tôt au printemps, il quitte son abri pour s'accoupler. Pour ce faire, le mâle grimpe sur la femelle. Les insectes peuvent garder cette position durant des heures. La femelle fécondée pond environ 300 œufs. Elle les fixe en bandes sur le dessous des jeunes feuilles de lis, le long de la nervure médiane. Une substance visqueuse leur permet de tenir en place. La couleur des œufs varie de jaune à rouge, en passant par l'orangé. Ils ont la forme d'un cylindre arrondi aux extrémités et mesurent environ 1,5 mm de long. L'éclosion a lieu après une à deux semaines, selon les conditions climatiques. La tête et les pattes de la larve sont noires, et le reste du corps est jaune. Son anus est situé sur la face dorsale du corps. Chaque larve s'enveloppe d'un manteau de mucus et d'excréments qu'elle agrandit au cours de sa croissance, qui est particulièrement rapide. La larve se déplace avec cet abri. Elle mue deux fois avant d'atteindre sa taille maximale, soit autour de 9 mm de long. Le développement larvaire s'étale sur environ trois semaines. Avant de se transformer en nymphe, la larve se laisse tomber au sol ou descend le long de la tige de sa plante hôte. Elle s'enfouit sous quelques centimètres de terre après s'être débarrassé de son enveloppe d'excréments. La larve fabrique un nouvel abri en mélangeant de la salive et des particules de sol. C'est dans ce cocon qu'elle se transforme en nymphe. L'insecte séjourne dans la coque nymphale durant quatre ou cinq semaines. L'adulte émerge ensuite, vers la fin de juin ou le début de juillet. Les criocères adultes commencent à s'abriter dans le sol pour passer l'hiver dès la fin de juillet. Ils se font rares sur la végétation à la fin d'août. Au Québec, il y aurait seulement une génération de ces insectes par année, alors qu'en Europe on peut en observer jusqu'à trois. On trouve ce coléoptère
dans les jardins et les cultures où croissent ses
plantes hôtes : il s'agit uniquement d'espèces
appartenant aux genres Lilium (lis), Fritillaria
(fritillaires) et quelques genres voisins. Introduit d'Europe, le criocère du lis vit maintenant en Ontario, au Québec et en Nouvelle-Écosse, ainsi que dans plusieurs États de la Nouvelle-Angleterre. Avec le temps, on estime que l'espèce pourrait étendre son aire de distribution à l'ensemble de l'Amérique du Nord. On trouve aussi cet insecte en Europe, en Sibérie, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. La larve et l'adulte se nourrissent des feuilles, des bourgeons floraux et des fleurs de leurs plantes hôtes (lis et fritillaires). Les très jeunes larves s'alimentent d'abord sur la face inférieure des feuilles, près de l'endroit où elles ont émergé des oeufs. Plus tard, plusieurs d'entre elles gagnent la face supérieure. Même si les larves sont bien camouflées et que les adultes ont un goût désagréable, les criocères du lis servent sans doute de nourriture à divers prédateurs. Aucun parasite indigène de cette espèce n'a encore été identifié en Amérique du Nord. Comme les autres insectes phytophages, le criocère du lis participe au contrôle de la prolifération de ses plantes hôtes. Ce coléoptère est surtout connu pour les dommages qu'il cause aux lis. Au printemps, les adultes perforent les feuilles dont ils se nourrissent, puis les larves s'y mettent aussi dès leur éclosion. Lorsque la plante a été défoliée, les insectes dévorent les bourgeons floraux.Au Canada, les espèces les plus ravagées par le criocère sont le lis blanc, le lis royal, le lis brillant et le lis tigré, toutes d'origine eurasienne. L'insecte ne semble pas constituer une menace pour les liliacées indigènes.
Le criocère du lis adulte émet un son lorsqu'on le pince ou qu'il se sent menacé. Cette stridulation est produite par le frottement des ailes cornées de l'insecte sur son abdomen. Plusieurs petites dents ornent en effet le dessous des élytres du coléoptère, qui les frotte rapidement sur la paire de plaques striées se trouvant à l'extrémité de son abdomen. Ce signal sonore servirait à éloigner ses ennemis.
Camouflée dans son abri d'excréments, la larve du criocère du lis passe souvent inaperçue. Elle se cache dans ce qui ressemble à une petite boule de boue. Ce manteau protecteur est fabriqué grâce à des mouvements rythmiques de l'intestin de la larve qui poussent les excréments de son anus dorsal vers l'avant de son corps. Cette coque pourrait servir à régulariser la température du corps de l'insecte et à le protéger du soleil et des prédateurs. En état d'alerte, le criocère adulte feint la mort et se laisse tomber au sol.
Certains lis attirent moins que d'autres cette espèce de criocère. On peut donc planter de préférence des variétés américaines, qui semblent un peu moins attrayantes pour l'insecte que les variétés asiatiques. Les variétés européennes sont les plus attaquées. Il est recommandé de faire une inspection visuelle des plantes à risque dès le début du printemps. Les adultes s'attrapent alors facilement avec les doigts. On peut repérer les œufs sous le feuillage et les enlever à l'aide d'un pinceau ou les détruire en les écrasant. Plus tard, les larves et les adultes sont récoltés à la main et jetés dans un seau d'eau savonneuse où ils meurent. Si la texture visqueuse de l'abri des larves vous rebute, utilisez des gants ou un pinceau pour les déloger. On peut aisément faire tomber les adultes en secouant les plants au-dessus d'un morceau de tissu ou d'un récipient. L'espèce étant résistante à la plupart des insecticides, les traitements chimiques ne sont recommandés que dans les cas d'infestations graves, en particulier dans les cultures. Aux États-Unis (Rhode Island), des chercheurs ont relâché des parasitoïdes européens du criocère du lis. Le but de cette étude était de vérifier si la présence de ces ennemis naturels, capables d'attaquer la larve malgré son enveloppe d'excréments, peut permettre un certain contrôle biologique de l'espèce. Ces insectes peuvent-ils tuer mes lis ? Si des criocères se trouvent en grand nombre sur un même plant, ils peuvent le défolier de façon radicale. Il est donc important de procéder à un contrôle pour éliminer le maximum d'individus. Les insectes ne causent cependant pas la mort des lis, car ces plantes survivent grâce à leurs bulbes
FAITS INTÉRESSANTS ET CURIOSITÉS La position dorsale de l'anus chez la larve de cet insecte est une particularité très rare dans le règne animal.
Les premières observations scientifiques du criocère du lis ont été consignées par le naturaliste français Réaumur, en 1737.
Des insectes nord-américains baptisés du nom scientifique Lema melanocephala ont été décrits par le naturaliste Say en 1826. Même s'il n'y a pas de spécimens de cette espèce dans la collection de Say, les entomologistes considèrent que la description qu'il en a faite correspond à celle de Lilioceris lilii, et qu'il s'agit du même coléoptère. On trouve un spécimen ancien de Lema melanocephala dans la collection de l'entomologiste québécois Léon Provancher. La description qu'il en a faite en 1877 est en tous points semblable à celle du criocère du lis, mais on ignore où l'insecte a été récolté.
La première capture de cet insecte en Amérique du Nord sous son identité de Lilioceris lilii a eu lieu en 1943, à Sainte-Anne-de-Bellevue. Le criocère passe d'abord inaperçu, puis il attire l'attention en 1945, à Montréal, en infestant le lis royal auquel il cause d'importants dommages. L'insecte reste probablement confiné à l'île pendant une trentaine d'années. On fait une première récolte hors de Montréal à Saint-Hippolyte, sur la rive nord du Saint-Laurent, en 1978. Il apparaît à Ottawa en 1981. En 1992, il a déjà atteint Wellington, en Nouvelle-Écosse, et Cambridge, au Massachusetts. Chaque année, le criocère du lis continue de gagner du terrain dans l'est de l'Amérique du Nord, s'adaptant à notre climat et profitant de l'absence de ses ennemis naturels
fait par Étienne le 20 novembre2002
|
|
Mis à jour le 25 novembre, 2002 |