(1930 - )
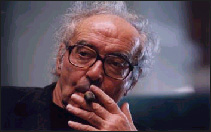
RÉALISATEURS CULTES
JEAN-LUC GODARD
(1930 - )
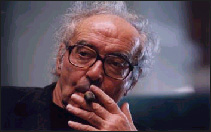
Par Kevin Cordeau
Jean-Luc Godard, véritable monument du cinéma français,
puise ses origines cinématographiques au coeur même de l'avant-gardisme
de ce que nous appelons la Nouvelle-Vague française. Il s'agit d'un mouvement
cinématographique fort important qui prit naissance au milieu des années
cinquante, en pleine période du classicisme florissant. De 1945 à
1957, il y a moins d'une dizaine de films qui échappent au cadre très
rigide de ce qui se prétendait être la " qualité française
". Ces oeuvres fortes, se caractérisant par le refus des habitudes
garantes et des traditions, révèleront plus de six nouveaux auteurs
du septième art. Quatre d'entre eux réalisent leur premier long
métrage à l'intérieur du système normal de la production;
ce sont Roger Leenhardt, Alexandre Astuc, Roger Vadim et Louis Malle. Cependant,
deux autres tournent de manière plus artisanale à l'écart
des règles strictes du Centre National de la Cinématographie;
ce sont Jean-Pierre Melville et Agnès Varda. Ces six nouveaux cinéastes
définissent le cinéma comme un art, un langage et un moyen d'expression,
n'étant plus seulement un simple métier et outil de spectacle.
Ils sont en ce sens les pionniers de la nouvelle-vague française, dont
le caractère brutal de l'explosion ne doit pas faire oublier qu'elle
n'est rendue possible que par la mise en commun de plusieurs conditions favorables.
La Nouvelle-Vague demeure un icône de la contre-culture des années
cinquante. Les films à gros budget alors présentés n'intéressent
que très peu le nouveau public de l'époque; les gens veulent quelque
chose qui parle d'avantage de la culture actuelle. La nouvelle-vague est ainsi
un cinéma de rupture. La cinéphilie grandissante d'alors constitue
certes son berceau; des milliers d'amateurs découvrent au rendez-vous
des fabuleux ciné-clubs les Eisenstein, Welles, Dreyer, l'expressionnisme
allemand, mais aussi les Bergman, Mizoguchi et Antonioni. La cinémathèque
d'Henri Langlois est pleine à chaque projection tout comme les cinémas
de répertoire qui fleurissent à Paris : le Studio 28, les Ursulines,
la Pagode, etc. Plusieurs revues spécialisés prennent aussi naissance
entre 1946 et 1954. Parallèlement, la télévision se cherche;
l'intérêt de ce qui s'y trouve n'est ni dans le dialogue, ni dans
la perfection technique, mais dans la véracité d'une image. Les
films français du temps, tant qu'à eux, sont toujours tournés
en studio. Mais l'effet artificiel et très carton-pâte des décors
intérieurs n'est pas dans les intérêts du nouveau public.
La caméra descend alors dans la rue. Dès le début de la
décennie, de brillants cinéaste du court-métrage prouvent
que des jeunes n'attendent seulement que de prendre la place : Kast, Resnais,
Marker, Franju, Demy. Les critiques eux-mêmes passent à la réalisation,
grâce à Pierre Braunberger qui finance, entre 1956 et 1957, les
premiers courts métrages de François Truffaut, Jacques Rivette,
Eric Rohmer et Jean-Luc Godard. Cependant, cette attente n'aurait sans doute
pas donné lieu sur des réalisations concrètes si les critiques
devenus cinéastes n'avaient pu contourner pratiquement l'obstacle technologique,
financier et institutionnel des règles du milieu professionnel. Les producteurs
seront alors attirés par la potentielle rentabilité que la nouvelle-vague
présente. Ce sont des films à budget très modiques qui
sont cependant susceptibles de rapporter beaucoup, autant en salle qu'avec les
primes de qualité. C'est surtout parce que les films de la Nouvelle-Vague
coûtent beaucoup moins cher que ceux des Clouzot, Clair, Clément
et Delannoy que le mouvement peut se développer ainsi et les nouveaux
réalisateurs peuvent remplacer les anciens. Ce sont eux qui apportent
pour la première fois la notion d'auteur au cinéma. Le cinéma
de la nouvelle-vague est un cinéma qui parle par lui-même; il se
caractérise par son esthétique en opposition totale avec celle
du cinéma classique : il y a énormément de ruptures de
ton, de post-synchronisation de jump-cuts et de déconstruction. Les personnages
sont ultra-caricaturés, unidimensionnels et représentent généralement
un groupe d'individus, une classe sociale plutôt qu'une seule et unique
personne.
Jean-Luc Godard est né à Paris, en 1930, issu d'une riche famille
suisse. Il a étudié à La Sorbonne, l'université
la plus prestigieuse de France, en ethnologie. C'est là qu'il se découvrira
une très grande vocation pour le cinéma. Il y fondera la Gazette
du Cinéma avec Jacques Rivette et Eric Rohmer. Il entame donc par la
suite sa carrière de critique dans Arts et Les Cahiers du Cinéma.
Il fait ses premiers pas derrière la caméra avec Opération
Béton, un court-métrage documentaire réalisé
en 1954. Il réalise son premier long métrage en 1959, À
bout de souffle qui, tout en étant un succès critique et public,
sera un des films phares de la Nouvelle-Vague. Godard réinvente drastiquement
la forme narrative du cinéma, avec plusieurs long métrages qui
succéderont sans cesse le premier, symbole de son dévouement envers
son art; parmi les plus importants : Une femme est une femme, Le petit soldat,
Vivre sa vie, Les Carabiniers, Le Mépris, Alphaville, Pierrot le fou...
Godard possède un style marginal et empreint des idéologies et
de l'esthétique de la Nouvelle-Vague. Il se définit par son obstination
à toujours abolir un mode d'expression conventionnel, une façon
classique de raconter quelque chose; Il s'affirme vraiment à travers
la mise en scène. Ses films sont généralement fractionnés
en tableaux, séparés en chapitres; Godard révolutionne
totalement la forme et le fond, donnant une structure assez complexe à
l'ensemble de ses oeuvres. Il provoque et choque souvent son public, il aime
bien mettre sa patience à l'épreuve; son cinéma laisse
place à beaucoup d'expérimentation autant au niveau esthétique
qu'au niveau narratif. Godard met l'accent sur chacune des composantes d'un
film, à savoir l'image, le son, la parole; il ne s'arrête pas au
scénario : cette entreprise représente souvent pour lui quelque
chose qui évolue et qui prend tout son sens dans le développement
du film, du tournage jusqu'au montage. Son propos va au-delà, car son
cinéma est toujours en quête de vérité des choses
et des êtres; un peu comme s'il prenait chacun des éléments
du film pour le diviser, le maltraiter même, l'utiliser à contre-courant
pour lui donner un sens nouveau. Il est relativement difficile de rentrer dans
un de ses films sur l'immédiat, comme le dit Jacques Villeret : "
Quand je vais voir son dernier film, j'ai parfois du mal à suivre,
j'ai l'impression de mal comprendre, je m'accroche, puis à la sortie,
quand je me retrouve au bistro ou au restaurant, j'ai l'impression de vivre
du Godard. [...] Je trouve que dans la vie, on vit souvent du Godard. "
Godard est effectivement difficile d'accès dès une première
approche. Il ne peut tout simplement pas démontrer par une simple fiction
des éléments simples de la vie : il passe la plupart du temps
par de grandes ellipses savantes. Il faut souvent visionner une oeuvre de Godard
à plusieurs reprises avant de comprendre le sens de ses films et leur
portée. Lorsque c'est chose faite, l'empreinte poétique et essentielle
laissée par le réalisateur et ses films est indélébile.
Dans la majorité de ses films, Godard demeure très éloigné de tout académisme, quelque soient les stades de la réalisation. Ses scénarios sont souvent très évolutifs. La première version d'un scénario, plus sobre qui lui permettra d'avoir un financement, souvent très différente de la version finale. Son premier long métrage, À bout de souffle, évolue fortement entre le projet et le tournage. Le sujet, au départ, est l'histoire d'un garçon qui pense à la mort et celle d'une fille qui n'y pense pas. Ainsi, jusqu'à ce qu'il en tourne la fin, Godard ne sait si Michel Poiccard va mourir ou non. Chaque matin de tournage, il écrit avec précision les scènes qu'il va tourner dans la journée. C'est en majeure partie pour cette raison que l'actrice Jean Seberg, effrayée par ce qu'elle pense être de l'amateurisme, vient à être sur le point de quitter le plateau de tournage. De cette façon de procéder ressort une impression de performance.
À bout de souffle, premier long-métrage de Godard, est l'un des films les plus importants de la Nouvelle-Vague. Le film est tout d'abord une dénonciation du luxe, présentant le personnage principal comme étant à l'opposé; Michel Poiccard est un marginal. La mise en scène du film est travaillée avec de nombreuses ruptures de rythmes, des jumps-cuts. Au niveau sonore, Godard enterre des dialogues avec des sons extérieurs à des points stratégiques. Au niveau de la direction artistique, il utilise la diction automatique, dans le but de mettre en relief le sens du texte, pour que le public le reçoive de façon moins passive et beaucoup plus critique; il s'agit là d'un procédé de distanciation flagrant, tout comme la première scène du film où Michel Poiccard s'adresse directement au public. À bout de souffle représente toutes les revendications de la Nouvelle-Vague, ses thèmes autant que son esthétique, et surtout cette volonté de mélanger les genres pour éviter d'être classer dans un genre spécifique. Son premier long-métrage représente aussi l'esprit de la nouvelle-vague : Rien à perdre, tout à gagner.
L'expression par le langage cinématographique est à ce point naturelle à Godard qu'il peut, comme il le disait un jour, " mépriser le cinéma ", c'est à dire les règles de la grammaire en usage. Il se moque des éclairages et il se moque du découpage; il se moque même, ce qui ne s'était jamais vu, des raccords. René Guyonnet, L'Express, 17 mars 1960.
Rien ne sert d'avoir des images claires si les idées sont floues. - Jean-Luc Godard
À force de regarder le visible, l'invisible va finalement apparaître. - Jean-Luc Godard
Ce que l'on croit est une image de la vérité. - Jean-Luc Godard.
La télévision fabrique de l'oubli. Le cinéma fabrique des souvenirs. - Jean-Luc Godard.
Le beau, c'est le laid qu'on tolère. - Jean-Luc Godard.
Photos: