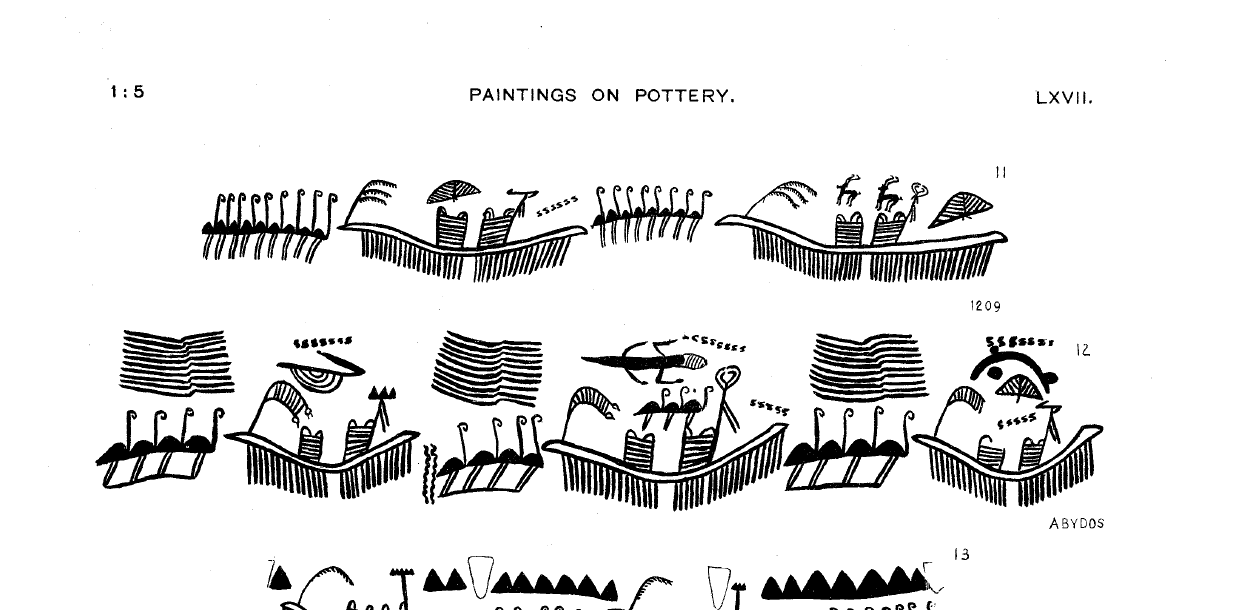
AEGYPTIO-GRAPHICA VII.
LE HARPON ET LA BARQUE.
DES POWERFACTS
AUX HIÉROGLYPHES
by ALAIN ANSELIN
English Abstract. The study of the artefacts of the tombs of predynastic cemeteries of Upper Egypt shows a minimal, but sociologically significant, concordance with the results of their size distribution. Particularly, the incorporation of two characteristic powerfacts, harpoon and boat, as standardized motifs in religious funerary iconographical "show" of Naqadan leaders, then their constituent passage from iconography to hieroglyphic writing accompany, illustrate and qualify a growing process of social stratification and the emergence of the state in the Nile Valley.
Introduction
Dans ses nombreux travaux (J.J.Castillos, A reappraisal of the published evidence on Egyptian predynastic and early dynastic cemeteries, Toronto, 1982; Evidence for the appearance of social stratification in predynastic Egypt, Proceedings of the Seventh International Congress of Egyptologists, Leuven, 1998, 255-259; J.J.Castillos, Wealth evaluation of predynastic tombs, GM 163, 1998, 27-33; J.J.Castillos, The predynastic cemeteries at Naqada, GM 196, 2003, 7-19; J. J. Castillos, Predynastic cemeteries in the Abydos area, GM 200, 2004; J.J.Castillos, RdE 49, 1998, Tables 1-4; J.J.Castillos, Inequality in Predynastic Egypt, CCdE 7-8,2005, 17-24; J.J.Castillos La estratificacion social en los origenes de Egipto, CCdE 10, 2007, 17-28), Juan Jose Castillos insiste sur la possibilité qu’offre une étude des cimetières et des tombes de mettre en évidence une histoire de la stratification sociale de l’Egypte dès les âges prédynastiques. Il brosse une synthèse de ses travaux dans deux articles des Cahiers Caribéens et un troisième à paraître dans les Göttinger Miszellen. Nous reprenons ses conclusion de l’article paru dans les CCdE 7-8 (2005).
"In recent years I have expanded this approach incorporating other such measures of social inequality, choosing tomb size (considered as volume whenever possible) and wealth (as I have defined it) as variables, and applying this method to all adequately published (and some unpublished) predynastic cemeteries in Upper and Lower Egypt, from the Early Predynastic to the Early Dynastic. The results from both variables showed a remarkable degree of agreement in most cases and enabled us to recognize other cases of decline in the inequality, similar to that observed at Armant, for example at Matmar, and also at Naqada, specifically in cemetery B and even more markedly, in the elite cemetery T. At Armant and Matmar (…), the most likely explanation appears to be the increasing distance from these communities to the centres of political power as time went by, but at Naqada the sharp decrease in inequality between Naqada II and Naqada III is not present in the Main Cemetery but rather at the elite cemetery T, indicating one of the probable results of the absorption of Naqada by one of its more powerful neighbours, depriving the local elite of access to many of the status-defining objects that marked their previous position in the contemporary society and which they reflected in the lavish endowment of their tombs". J.J.Castillos met en évidence la stratification sociale de l’Egypte prédynastique, et jusqu’à son histoire (le déclin de Nagada, opposé à Abydos et Nekhen) par la seule lecture de la distribution des tombes par taille. Les analyses des inscriptions ruspestres prédynastiques du Gebel Tauti dues à Renée Friedman et Stan Hendrickx abondent dans ce sens: «The lack of elite tombs of the Naqada III period in the Hu region indicates that it had ceased to be a distinct independant chiefdom by that time» et considèrent que Scorpion I, au Nagada IIIA a pu conquérir la région de Naqada. (R.Friedman & S.Hendrickx, 2003, 95-109).
Ce qui nous parait intéressant dans les travaux de J.J.Castillos, c’est leur cohérence avec la distribution des données matérielles dans les tombes selon le statut social, comme le remarque R.Friedman pour Hierakonpolis: «Dans la nécropole des notables (HK6), tout était conçu à plus large échelle» que dans le «cimetière des ouvriers» (R.Friedman, 2003,16). Toute une déictique royale est alors à l’œuvre, qui va du bestiaire royal inhumé dans les cimetières des élites, comme l’éléphanteau de la tombe 24 du site HK6
au Nagada IIA-B à Hiérakonpolis (R.Friedman,2003,19) aux powerfacts caractéristiques des rituels d’inhumation royale, comme le cuissot de bœuf de la tombe S d’Adaïma, qui préfigure le nps pharaonique, ou encore de l’expression du leadership, comme le harpon associé au défunt de la tombe S100 d’Adaïma, au Nagada IIC (B.Midant-Reynes, 2003, 179) .L’analyse qualitative nous conduit ainsi des powerfacts et théofacts, pour la culture de Haute-Egypte dès le milieu du millénaire nagadéen, à une iconographie qui leur est associée, et de là, à une hiéroglyphie au sens littéral du mot, qui continue les dispositifs purement artefactuels des premières tombes.
Des powerfacts à l’iconographie funéraire royale
Si les travaux conduits par J.J.Castillos mesurent l’inégalité sociale en Egypte, sa dynamique et son processus, l’étude que nous conduisons à propos de l’histoire des processus à l’œuvre dans la déictique royale, qui conduisent des powerfacts aux hiéroglyphes, s’attache à la qualifier.
Dans le cas de la tombe S100 d’Adaïma, au Nagada IIC, contemporaine de la céramique Decorated du Nagada II, l’association du sujet et des attributs n’est pas directe - la tombe contient un powerfact, le harpon, référent du signe iconographique puis du hiéroglyphe, qui qualifie le sujet, et un vase, attributif, décoré de bateaux (B.Midant-Reynes,2003,179). Dans une tombe contemporaine d’Abydos, Petrie a exhumé parmi les objets de la déictique funéraire royale un vase Decorated où le harpon passe du statut de powerfact à celui de thème iconographique. L’iconographie inscrit du coup la stratification sociale dans l’art funéraire. «Un libellé iconographique figurant trois barques,(…) cadres de scènes autonomes, est identifiable sur un vase de la Classe Decorated, provenant d’Abydos», enregistré U.C.6340 (W.F.Petrie,1921,1 :6, XXXIV). C’est un vase à décor figuratif complexe, que S.Hendrickx considère comme typique des périodes Nagada II C-D (S.Hendrickx,2000,22)»(A.Anselin,Aeg.Graph.IX, s.p.).
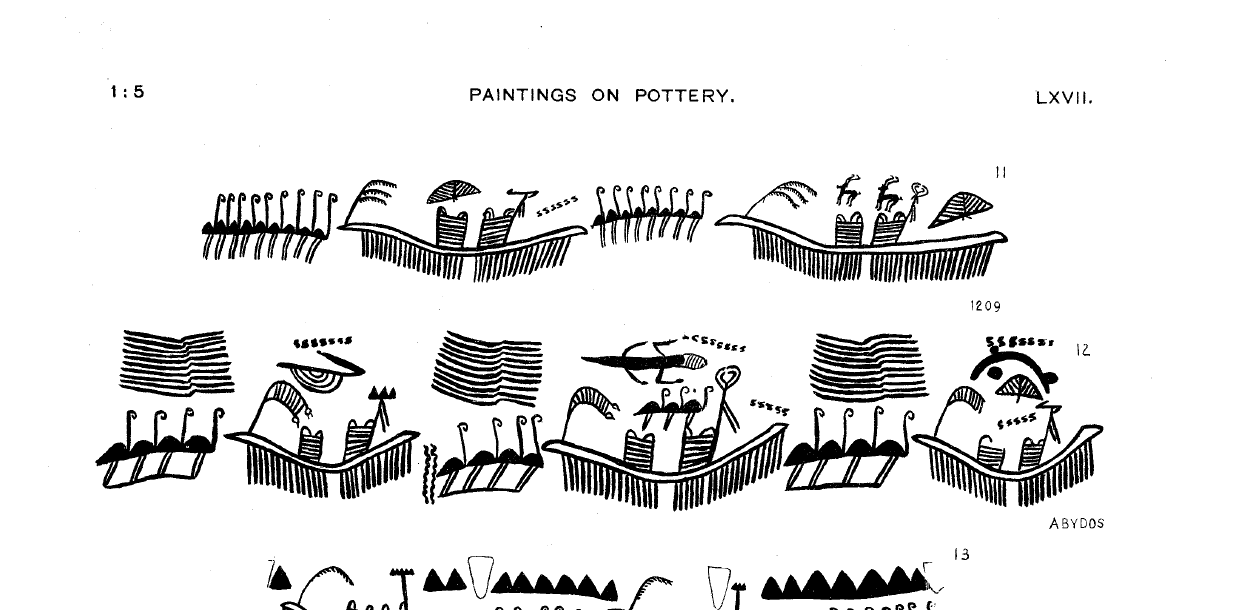
Peinture d’un vase Decorated Nagada II C, Abydos, Haute Egypte
(source : Petrie & Quibell,1896, LXVII)
W.F.Petrie remarque
que les trois bateaux du décor de ce vase Decorated sont surmontés de signes peints en rouge «These signs are the harpoon, the crocodile and the crescent" (Petrie & Quibell, Nagada and Ballas, 1896, 43)".Un autre vase Decorated de la même époque, trouvé à Badari par G.Brunton, le place de même dans son décor (G.Brunton & G.Caton-Thompson,1928, pl XL).
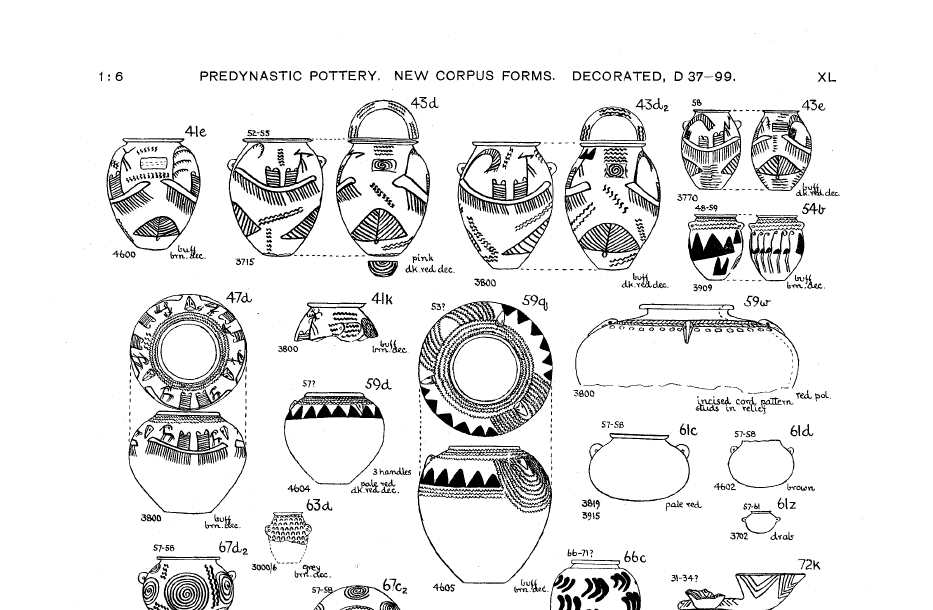
Vase Decorated 43d Nagada IIC, Badari (Brunton,1928,55 et pl XL)
L’iconographie du vase Decorated de Badari de la tombe du site transfère lui aussi sur le décor de la céramique les référents artefactuels qui caractérisent la sépulture d’Adaïma, la dépouille du défunt, et le harpon – nous tenons pour artefactuel le corps du défunt traité comme un objet culturel, et placé au centre du dispositif funéraire. Ces vases Decorated dessinent d’ailleurs une aire culturelle, qui intègre Adaïma, près de Nekhen, Naqada où Petrie a collecté les matériaux de sa classification, Abydos, et jusqu’à Badari, site de la Moyenne Egypte - où sous les niveaux nagadéens, G.Brunton et G.Caton-Thompson ont identifié une culture badarienne originale plus ancienne courant de 4300 BC à 3900 BC.
Le décor des fragments d’un autre Vase Decorated de la période nagadéenne, trouvé à Badari tombe 3759, par les deux égyptologues et aujourd’hui à l’Ashmolean Museum d’Oxford, ont retenu plus particulièrement notre attention. Des figures humaines en nombre réduit, équipées elles-mêmes chacune d’un harpon, y sont associées à des séries de harpons. Aussi S.Hendrickx l’a-t-il inscrit en 2002 dans son catalogue récapitulatif de vases Decorated à figures humaines (S.Hendrickx, 2002, 33, fig.9). Sur l’autre tesson, des harpons voisinent avec une barque.
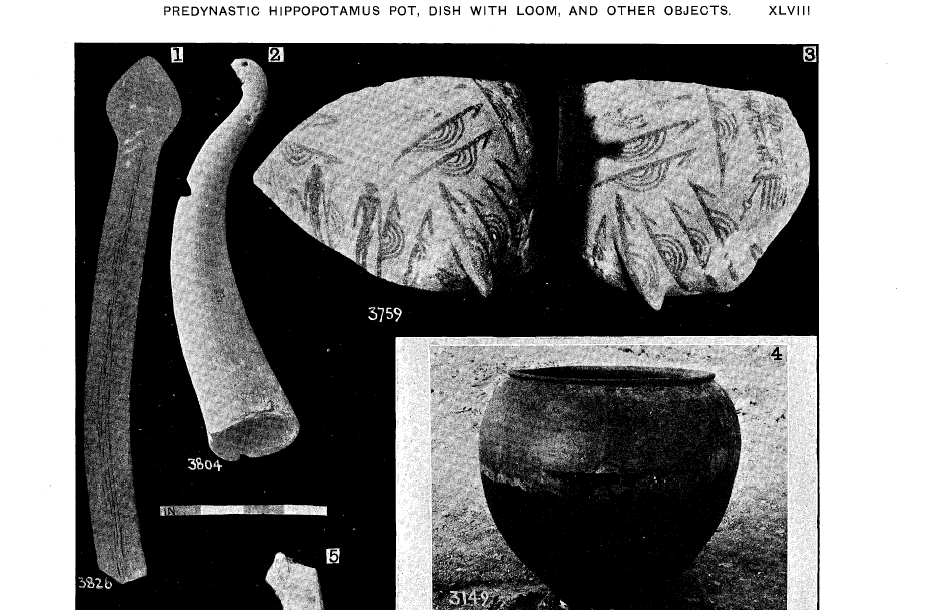
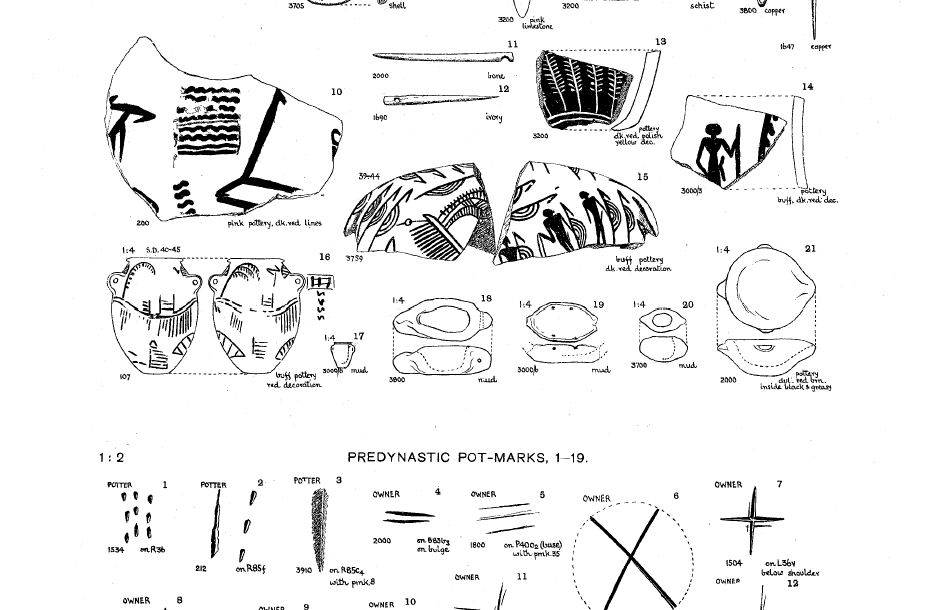
Décoration d’un vase nagadéen trouvé à Badari (G.Brunton & G.Caton-Thompson, 1928, Pl.XXXII,XLVIII/3 et LIV/15)
G.Brunton observe après A.Gardiner (1927,499 et 544) que des harponneurs, les msn.w, ![]() littéralement, les flotteurs ou msntyw, ceux aux flotteurs, copte
littéralement, les flotteurs ou msntyw, ceux aux flotteurs, copte
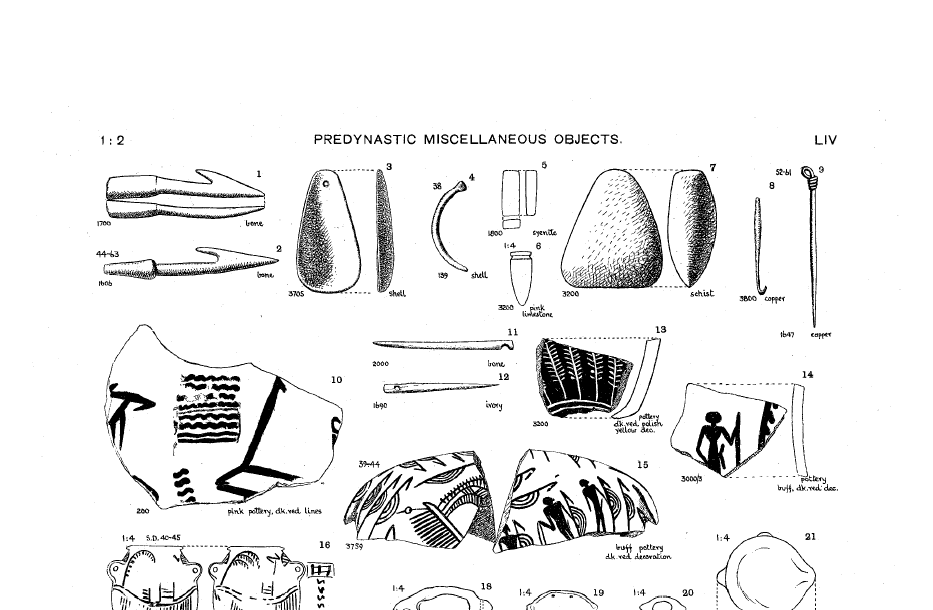
![]()

Pointe de harpon en os (Brunton,1928, Pl LIV) et Hiéroglyphes T19 et T21 (A.Gardiner)
Le hiéroglyphe du harpon en os en vient pour des raisons de contiguïté sémantique d’ordre culturel à permuter avec le signe du flotteur, ![]() , phonétiquement msn (Wb II,145,13). Le mot était aussi un titre des prêtres d’Horus à Edfou (Wb II 145,10), et le nom des harponneurs royaux (Wb II 145,11).
, phonétiquement msn (Wb II,145,13). Le mot était aussi un titre des prêtres d’Horus à Edfou (Wb II 145,10), et le nom des harponneurs royaux (Wb II 145,11).
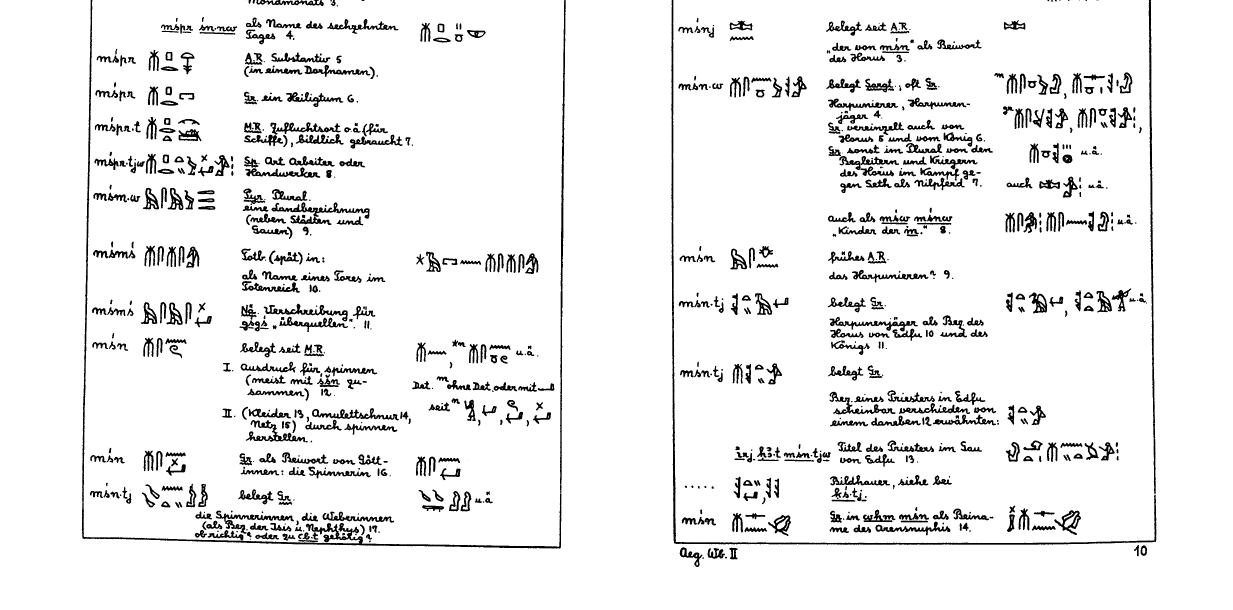
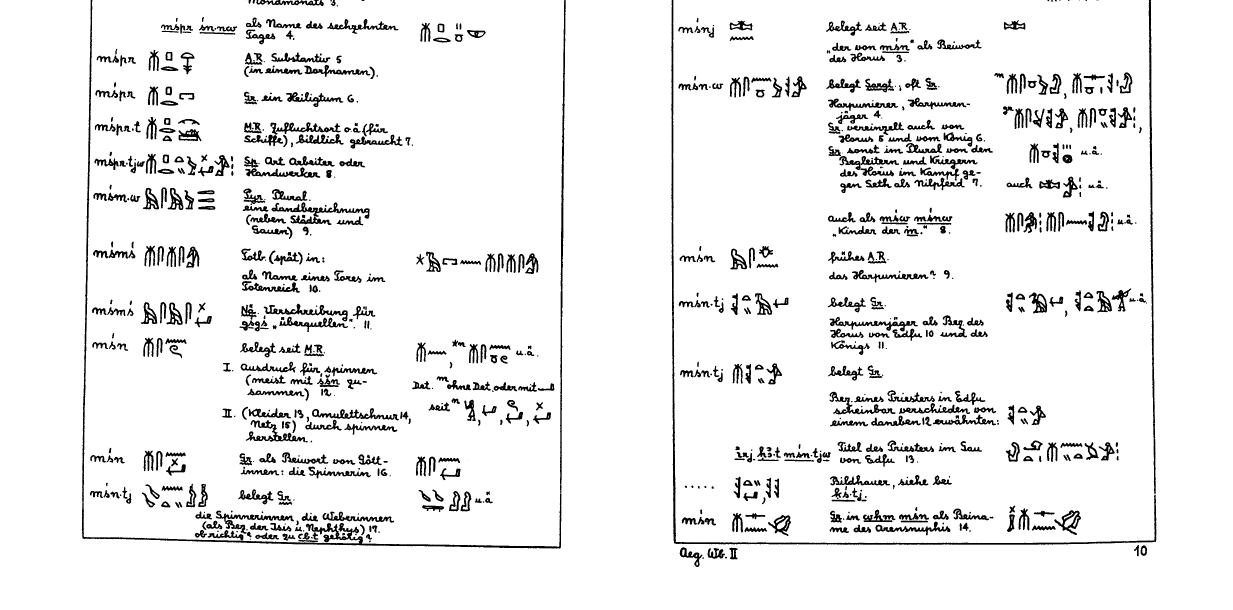
Les harponneurs leurs noms et leurs graphies dans le Wörterbuch d’Erman & Grapow
Première hypothèse : Pouvons-nous voir dans le décor de ce vase du Nagada IIC un antécédent lointain des harponneurs royaux ?
G.Brunton note aussi que les bateaux de quatre des huit vases Decorated qu’il a exhumés à Badari et datés de SD correspondant au Nagada IIC (SD 52-55) ont pour emblème un harpon. Toutefois le fragment de vase de la planche LIV est peut-être plus ancien.
Dans tous les cas considérés, le harpon est associé au pouvoir. L’artefact est visiblement un powerfact, un attribut du leader, son titre et son nom.
Deuxième hypothèse : l’attribut du leader le désigne-t-il dès cet époque comme celui au harpon, le harponneur royale, mais aussi la figure royale de l’Unique, w
c.w, qui fera partie signe et mot, des qualificatifs de Narmer au Nagada IIIC ?Essayons d’élucider ces deux points, l’Unique et les harponneurs royaux.
La première barque du Vase Decorated d’Abydos est associée à un harpon.
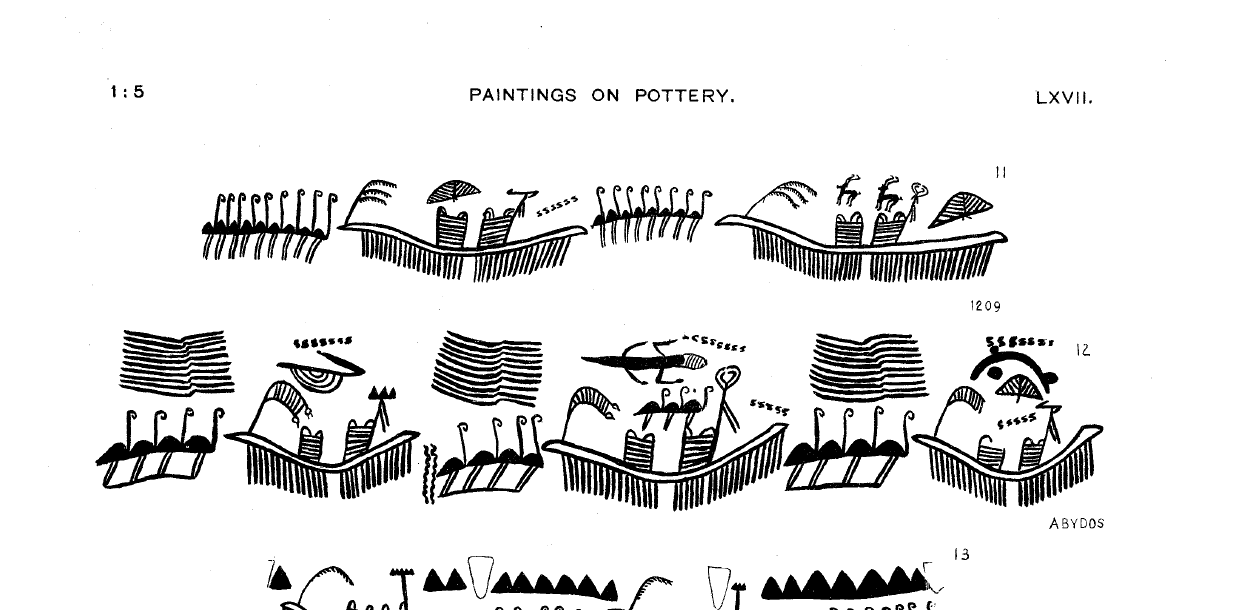
Peinture d’un vase Decorated Nagada II C
L’association de la barque et du harpon sur ce vase du Nagada IIC soutient la comparaison avec une association similaire gravée sur un powerfact funéraire trouvée dans le Grand Dépôt de Nekhen (Quibell, 1902), la palette de Narmer, datable du Nagada IIIC1.

Palette de Narmer Nagada III C1
Narmer y est visiblement figuré comme Horus au harpon sur sa barque, continuant l’association du harpon et de la barque, w
c et wi3, à la figure du pouvoir présente dans l’iconographie royale depuis quatre siècles déjà.L’attribut du leader le désigne-t-il cependant dès le Nagada IIC comme Unique, w
c.w, celui au harpon ? Le signe et sa valeur sémantique sont identifiables. Mais peut-on dire qu’il est lisible ? Il nous semble aventuré de répondre, car l’iconographie ne permet pas de déceler le changement d’articulation qui fait passer l’emploi d’un signe du sens que son image représente à la valeur phonétique qui est la sienne dans la langue du dessinateur.De l’iconographie à la hiéroglyphie
Ce qui distingue les deux décors, c’est que dans la réalisation du premier, sur la Vase Decorated du Nagada IIC, l’artisan a incontestablement privilégié l’articulation sémantique dans le libellé, iconographique, des attributs du pouvoir. Dans le second cas, sur la palette de Narmer au Nagada IIIC, l’artisan est en train de devenir aussi un scribe, et a privilégié l’articulation phonétique dans le libellé, linguistique, des attributs du pouvoir. En effet, le signe du harpon, comme son référent, n’a qu’une aile - par opposition à la flèche, qui en a deux. Les valeurs phonétiques de ces artefacts, puis des signes iconographiques sont-elles déjà à la disposition du scribe quand il hiéroglyphie son énoncé ? Le signe w
c, harpon, un attribut royal, est nécessairement le meilleur candidat pour nommer graphiquement comme Unique le leader, sans doute en raison d’une homophonie motivée plutôt qu’aléatoire, où le harpon est une figure métonymique le désignant par sa partie caractéristique, l’aile unique, opposable aux deux ailes de la flèche s(w)n ?Sur la palette de Narmer (Nagada IIIC1, ca 3100), ce n’est plus une figure humaine qui est associée au harpon qui la désigne comme leader, c’est un faucon, métaphore de la royauté et son emblème. Le harpon qualifie indéniablement le sujet, et son leadership. Son association à la barque en contexte funéraire mérite un complément d’études, mais la qualifie indéniablement comme barque royale. La barque est d’autre part le véhicule du voyage vers un au-delà stellaire. Précisément, w
i3 est aussi le nom d’une étoile comme le rappelle l’astrophysicienne et égyptologue K.Gadré – de même que le nps de l’offrande de la tombe d’Adaïma.On peut d’ailleurs suivre l’évolution de l’emploi des signes, au fil des Dynasties du Nagada IIC à Narmer puis au fil des Dynasties, du référent artéfactuel à l’élément iconographique et au signe hiéroglyphique – du powerfact au hiéroglyphe. J.Kahl a relevé toutes les graphies de ces mots - d’abord l’idéogramme, doté visiblement ou lisiblement de sa valeur phonétique, puis le hiéroglyphe pourvu d’un autre signe, complément phonétique insistant sur l’articulation, phonétique, privilégiée par l’artisan dans sa graphie. Et enfin augmenté de ses morphèmes, généralement sous la III° Dynastie :
w
c.w ein, der Eine, der Einzige (Wb I 273, 3-276,9) («Schlange»-Qaa - 3° Dynastie) figure sous la seule figure du signe du harpon :En cela, il continue les inscriptions qui courent de Nagada IIC, où il est d’abord sémantiquement lisible, à Narmer, où il est phonétiquement lisible. Le passage à l’écriture a lieu quand l’artisan iconographe et sculpteur privilégie l’articulation phonétique dans l’emploi des idéogrammes.
A partir de la II° Dynastie, la graphie, verticale, du mot est accompagnée de son complément phonétique, le hiéroglyphe ![]() ,
,
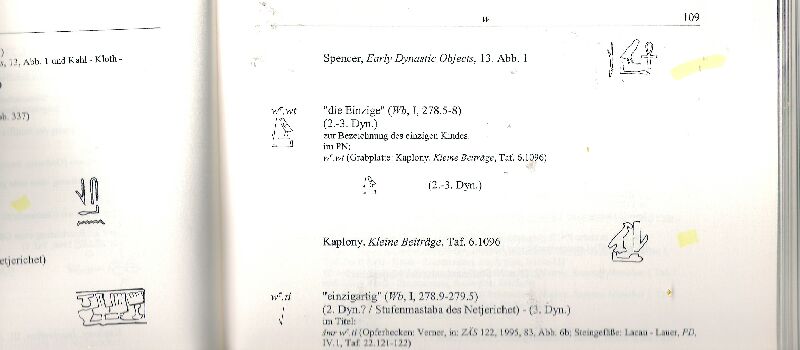 ,
, 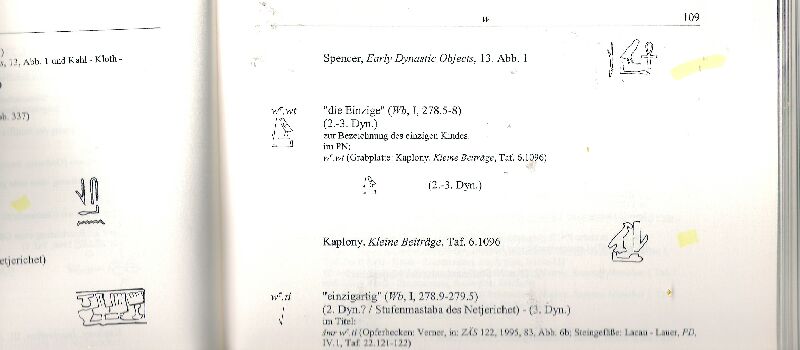 ,wc.w sn (Kaplony, Inschriften III,Abb.337) (J.Kahl, 2002,108).
,wc.w sn (Kaplony, Inschriften III,Abb.337) (J.Kahl, 2002,108).
A partir de la III°, du morphème –w, qui substantivise un participe : 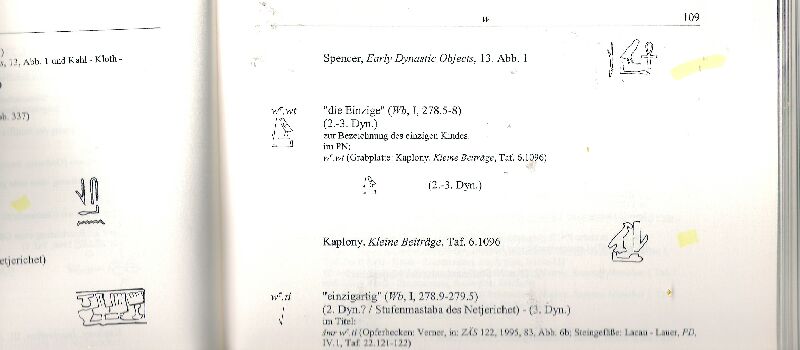 ,
, ![]() , dans w
, dans w
Conclusion
Il y a là une continuité historique qui reflète aussi les processus de stratification sociale repérée par Juan Jose Castillos pour la Haute-Egypte prédynastique par la seule lecture archéologique des tombes et du développement de leur taille solidaire de la concentration du pouvoir et de l’émergence de l’appareil palatial. Dès le Nagada IIC, l’Egypte pharaonique est déjà «en place». Il y a une correspondance de la taille des tombes et de la socialité des artefacts qui ont pu y être trouvés. Les powerfacts des sépultures nagadéennes supposent une chaîne opératoire en amont, des producteurs des matériaux et des outils des potiers aux potiers et de là jusqu’aux équipes de sculpteurs et de graphistes attachés aux premiers pouvoirs. Pendant des siècles, les artisans des palais des premières polities ont accumulé les matériaux iconographiques. Les unités élémentaires de l’iconographie nagadéenne, étaient évidemment nommables et reconnaissables à la fois au plan sémantique et au plan phonétique pour les artisans dans leur langue – à la fois la langue du palais et le véhiculaire de la vallée en Haute-Egypte. Ces signes graphiques pouvaient donc recevoir la valeur orale qu’ils y avaient. L’émergence de l’écriture hiéroglyphique tiendra à un changement d’articulation, sémantique (idéogramme) à phonétique (phonogramme), dans l’emploi des signe iconographiques - les idéogrammes étant réemployés pour leur valeur phonétique et non plus pour leur valeur sémantique, que l’homophonie du signifiant et du signifié soit aléatoire ou motivée (A.Anselin, 2001,23-42).
Bibliographie
Alain Anselin, Signes et mots de l’écriture hiéroglyphique, ArchéoNil n°11, Paris, 2001,21-43
Alain Anselin Iconographie des rupestres sahariens et écriture hiéroglyphique. Signes et sens, in Hic Sunt Leones. Hommages sahariens à Alfred Muzzolini, Cahiers de l’AARS n°10, 2006, 13-28
Alain Anselin Aegyptio-Graphica IX. Libellés iconographiques nagadéens et pluriel archaïque hiéroglyphique, 2007, s.p.
Guy Brunton & Gertrude Caton-Thompson, The Badarian Civilsation and predynastic remains near Badari, BSAE, London, 1928.
Juan Jose Castillos, Evidence for the appearance of social stratification in predynastic Egypt, Proceedings of the Seventh International Congress of Egyptologists, Leuven,1998, 255-259
Juan Jose Castillos, The pre-dynastic cemeteries at Naqada, Göttinger Miszellen n°196, 2003,7-19
Juan Jose Castillos, Inequality in Predynastic Egypt, Cahiers Caribéens d’Egyptologie n° 7-8, 2005, 17-24;
Juan Jose Castillos La estratificacion social en los origenes de Egipto, Cahiers Caribéens d’Egyptologie n°10, 2007, 17-28.
Adolf Erman & Herman Grapow Worterbuch der Aegyptischen Sprache 1927, Akadémie Verlag, Berlin, 1982, 13 volumes
Renée Friedman Hierakonpolis 2003 : exhumer un éléphant Bulletin de la Société Française d’Egyptologie n°157, juin 2003, 8-22.Alan Gardiner Egyptian Grammar, Oxford, 1927, 646 pages
Karine Gadré http://www.culturediff.org, 2007.
Stan Hendrickx et Renée Friedman, Gebel Tjauti Rock Inscription and the Relationship between Abydos and Hierakonpolis during the early Naqada III Period Göttinger Miszellen n° 196, 2003, 95-109.
Stan Hendrickx Checklist of predynastic «Decorated» pottery with human figures, Cahiers Caribéens d’Egyptologie n° 3-4, 2002, 29-50
Jochem Kahl Frühägyptisches Wörterbuch, vol. 3-f, 2002, vol.m-h, 2003, vol h-H, 2004,Wiesbaden, Harrasowitz
Beatrix Midant-Reynes Aux Origines de l’Egypte. Du Néolithique à l’émergence de l’Etat, Fayard, Paris, 2003, 436 pages
W.M.F.Petrie & J.E. Quibell, Nagada and Ballas, BSAE 4, Quaritch, London,1896.
J.E.Quibell & F.W.Green, Hierakonpolis II, BSAE 5, London, 1902.