L'INTERPRÉTATION GESTALTISTE DE FREDERIK PERLS par Thérèse-Isabelle Saulnier |
 |
L'INTERPRÉTATION GESTALTISTE DE FREDERIK PERLS par Thérèse-Isabelle Saulnier |
 |
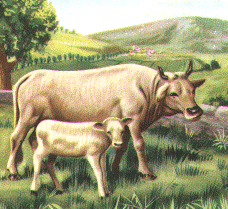 |
Elle regarde la mer du haut d'un promontoire, une falaise abrupte; en bas de celle-ci, une vache à cornes sort de l'eau, accompagnée d'un petit veau. D'autres vaches et d'autres veaux les suivent. Un homme vêtu de blanc, lui rappelant son père, vocifère. Il y a aussi d'autres hommes, avec des haut-parleurs, qui obligent les vaches à retourner dans la mer, parce que "ce n'est pas le moment". La rêveuse décide alors d'aller nager. Elle demande à l'homme si cela ennuierait les vaches. L'homme répond non. Elle va nager. Une mâchoire saisit soudain sa main, puis autre chose saisit son autre main. Elle finit par dégager sa main gauche et à sortir de l'eau. Dans sa main droite, se tient un petit chien pékinois semblant couvert de boue, mais c'était en fait "un de ces chiens qui gardent les troupeaux". Il se dégage sans se blesser. Fin. |