Le répertoire du luthEsquisse d'une synthèse par Christophe BERNARD - 1996 |
![]() version du 28/01/1997
version du 28/01/1997
Immense !!!! Imaginez-vous que le luth est à la Renaissance ce que le piano est au XIXème siècle ... Certes, tout n'est pas d'un intérêt extraordinaire, même chez les plus grands. Cet essai n'a d'autre but que de présenter brièvement les principales caractéristiques du répertoire au XVIème siècle. Pour plus d'informations, voir les livres spécialisés, écrits par des musicologues : je vous recommande " La musique de Luth en France au XVIème siècle " de J.M.Vacarro, aux Editions du CNRS.
On peut distinguer trois grands domaines d'utilisation du luth : 1. en soliste, 2. en accompagnement d'un chanteur, 3. dans un ensemble de musique de chambre. Il peut sembler étrange de distinguer les deux derniers domaines ; la raison en est simple : il n'y a aucune partition pour luth en ensemble (exception faite des consorts anglais), alors que les publications pour voix et luth sont assez nombreuses. Voyons brièvement chaque domaine :
1. le luth en soliste
2. le luth en accompagnement de la voix
3. le luth en ensemble
Une liste des tablatures éditées pour le luth au XVIème siècle est disponible
ici.
Une liste des compositeurs est visible ici.
Les premières tablatures (1500 - 1530) : Les toutes premières tablatures de luth sont imprimées au début du XVIème siècle, chez l'éditeur vénitien Petrucci. Elles sont destinées à des amateurs, comme en témoigne l'instruction au début "pour ceux qui ne savent pas lire la tablature". Elles contiennent des transcriptions ("mises en tablature" de pièces vocales, des danses et des pièces de forme libre (recercar, tastar de corde) : ces trois familles de pièces constituent l'archétype du répertoire de luth soliste au XVIème siècle. Elles sont représentées à des degrés divers selon les auteurs : ainsi le recueil de Dalza (1508) contient 4 mises en tablatures, 14 pièces libres et 43 danses, tandis le recueil de Spinacino (1507) contient 32 mises en tablature, 17 pièces libres et une seule danse. La même diversité dans les contenus apparaît dans les recueils français d'Attaingnant (un livre consacré aux danses, un autre aux mises en tablature et aux pièces libres) et "allemands" de Judenkönig (ca.1510 et 1523). Une quinzaine de livres sont publiées pendant cette période dans toute l'Europe.
| Auteur et année de publication | Mises en tablatures | Pièces libres | Danses |
|---|---|---|---|
| Spinacino (1507) | 32 | 17 | 1 |
| Dalza (1508) | 4 | 14 | 43 |
| Judenkonig (1510 environ) | 31 | 0 | 1 |
| Judenkonig (1523) | 16 | 5 | 10 |
| édité par Attaingnant (1529) | 10 | 5 | 0 |
| édité par Attaingnant (1530) | 0 | 0 | 64 |
L'explosion (1530-1550) : A partir de 1536, l'Europe connaît un véritable "boom" de l'édition de tablatures de luth : une cinquantaine de livres sont publiés, dont la moitié en Italie! Des artistes comme Francesco de Milano ou Alberto da Rippa éblouissent les cours par leur virtuosité. Les mises en tablatures de pièces vocales sont légions, et les pièces libres s'écartent de plus en plus de l'improvisation notée pour devenir des architectures contrapunctiques qui n'ont plus rien à envier aux pièces vocales d'un Palestrina ou d'un Josquin. Les danses sont bien représentées par des pavanes suivies d'une gaillarde ou d'une saltarelle.
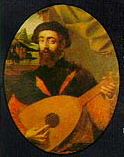
| Portrait d'un luthiste du début du XVIème siècle (peut-être Francesco da Milano). Cette position de la main droite est semble-t-il la plus commune au début du XVIème siècle, découlant de la technique du jeu au plectre, qui était utilisé jusqu'à la fin du XVème siècle. |
La maturité (1550 - 1580) : Les éditeurs continuent à publier à tours de bras ... mais si on regarde de plus près, il y a énormément de rééditions d'oeuvres déjà publiées auparavant (rééditions de livres de Francesco da Milano, publications "pirates" de Phalèse), ou d'artistes morts avant 1550 (publication des oeuvres d'Albert de Rippe par Adrian Leroy d'une part, et Guillaume Morlaye d'autre part). Toutefois ce ne sont les oeuvres originales et de qualité qui manquent, et ce dans toute l'Europe.
L'éclipse (1580-1600) : en préparation ...
Vers le baroque (1600 - 1620) : en préparation ...
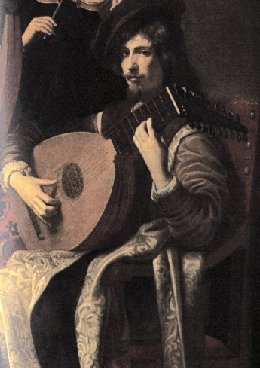
| Bel exemple de luth à dix choeurs, qui peut être appellé, selon de quel côté nos goûts nous portent, luth pré-baroque, ou luth renaissance tardif. Notez bien la position de la main droite, orthogonale aux cordes, et non plus parallèle, comme c'était semble-t-il le cas au début du XVIème siècle. Cette position sera celle du luth et de la guitare baroques, puis de la guitare actuelle. |
 2. Le chant au luth
2. Le chant au luth
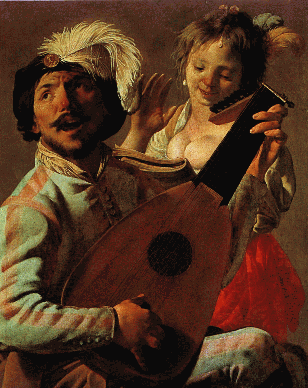
| Ce beau luthiste chante en
s'accompagnant au luth, couvé par le
regard émerveillé de la demoiselle au
corsage généreux...(c'est fou l'effet que
cet instrument produit sur la gent
féminine, les Anciens n'avaient pas tort
quand ils disaient que c'était la lyre
d'Orphée ...). Cette pratique semble avoir été très commune, vu le nombre de peintures et de partitions qui nous restent. Malheureusement, peu de luthistes actuels se sont attachés à la ressusciter, et préfèrent confier la ligne de chant à un ou une chanteuse (il faut dire que la partie de luth est souvent très ardue cf. Dowland, au hasard ...). |
Les représentations et témoignages écrits de la présence de luth(s) dans des orchestres sont nombreuses. Pour ce qui est du matériel musical par contre, il n'y plus grand'chose : des duos de luths (surtout en Angleterre) essenciellement. Alors ? Ceci m'amène à vous parler de ce qu'on sait de la pratique musicale au XVIème siècle. Des éditeurs publient de la musique à l'intention d'un public d'amateurs nobles ou en tous cas fortunés qui veulent s'esbaudir et "faire le boeuf" le dimanche ... Le répertoire consiste avant tout en chansons (pour les voix) et en danses (pour les instruments), à 4 ou 5 voix, libre aux musiciens de se répartir les voix en fonction de leurs instruments. En pratique, voix et instruments se mêlaient pour jouer ensemble les chansons (voir l'exemple ci-dessous). Ceci conduira à la pratique intense de la basse continue baroque.
 | "Le retour de l'enfant prodigue" ou "Les Cinq Sens"(de gauche à droite : le toucher, le goût, l'ouïe, la
vue et l'odorat) Les deux musiciennes jouent une chanson de Claudin de Sermisy : la flûtiste lit la partie de dessus sur le livre édité par Attaingnant, et la luthiste l'accompagne en suivant sur une tablature écrite à la main sur un bout de papier . Cette tablature "réduit" les autres voix de la chanson et intruduit même quelques diminutions (on peut reconstituer la partition tellement le tableau est précis, si vous ne me croyez pas allez voir l'original au Musée Carnavalet à Paris !) |
| Le répertoire | La guitare | L&G en France | Liens vers d'autres pages L&G |