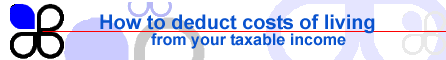
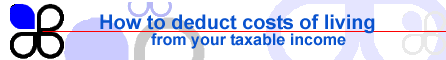
Cet article fut prsent pour publication "Tecbahia", Revista Baiana de Technologia
Willem Adrianus de Bruijn
Fondateur
ZERO
association des consommateurs qui maintiennent leur integrit avec leur revenu
80, avenue Emile Zola
B-1030 Bruxelles, Belgique
Tel. : 32 (2) 648 56 95
e-mail : WdeBruy@yucom.be
ZERO web site : http://www.oocities.org/zero_association/
Un dveloppement durable raliser
Rsum
Les consommateurs assurent leur mode de vie l'aide de biens et services. Ces biens et services composent le dveloppement conomique. Ce dveloppement pourrait perdurer dans une conomie dans laquelle les consommateurs seraient habilits dduire, de leurs revenus imposables, l'argent qu'ils consacrent l'achat de biens et services respectueux de l'environnement. Dans un tel contexte, les consommateurs sĠattacheraient vivre avec des biens et services qui maintiennent l'intgrit de la nature humaine. Ils seraient incits agir ainsi dans une optique de sauvegarde de leurs intrts, la fois personnels et financiers. Dans cette version cologique de l'conomie de march libre, les consommateurs donneraient un sens au dveloppement. Maintenir l'intgrit de la nature humaine, serait le but du dveloppement conomique.
Un consommateur pourrait engager une procdure judiciaire dans un pays o la loi stipulerait que les frais qui assurent un revenu sont dductibles de ce revenu, avant que des impts ne soient dus sur le solde de ce revenu. Dans cette perspective, le consommateur pourrait tenter de dmontrer que les frais de subsistance assure par l'usage de produits cologiques procurent des revenus pour l'ternit. En vertu de cette loi, et dans ce pays, ces frais seraient alors dductibles des revenus imposables. Peu importe le rsultat de ce procs, le consommateur se prsente avec sa capacit comptable de dduire des frais de ses revenus, pour assumer sa responsabilit de maintenir la nature en tat. Cette responsabilit pour la nature est soutenue par ses responsabilits naturelles pour la nature humaine.
Le consommateur est plus quĠun intermdiaire dans le cycle de vie d'un produit dans l'conomie de march libre. Ceux qui se sentent investis d'un rle de "rgent ou intendant de la nature humaine" recherchent une rgion d'accueil, un pays prt riger une rgion en zone conomique spciale. Cette zone entrerait dans la ralit macro-conomique de la plante, comme un dfi, par le biais de l'introduction dans la zone, d'un label commun chaque produit. Le label mettrait en vidence le pourcentage du prix d'un produit correspondant ses frais de production au moyen de produits respectueux de l'environnement. Ce label indiquerait ainsi le degr cologique de chaque produit. Les pourcentages un chiffre, que beaucoup de produits prsenteraient aujourd'hui, seraient un dfi moral amliorer la valeur cologique des produits grce auxquels nous assurons notre mode de vie. Le label constituerait une barrire cologique qui rserverait le march dans la zone ses producteurs. Le label excluerait tout produit du march qui afficherait un pourcentage plus bas que le pourcentage le plus bas appliqu dans la zone. Derrire cette barrire, les producteurs pourraient dvelopper une industrie cologique. La zone deviendrait le berceau d'un dveloppement thique et humain. Les producteurs de la zone bnficieraient dĠune situation privilgie dans la voie de ce dveloppement. Le Brsil est dans une situation favorable pour ouvrir la premire de ces zones.
DĠici l, un gouvernement pourrait tester l'efficacit de la gestion des frais de vie comme moyen de motivation des consommateurs vivre en harmonie avec la nature, en lĠappliquant un produit de grande consommation, comme le pain, le riz, les pommes de terre ou le mas, par exemple. Dans un premier temps, il devrait slectionner une organisation qui gre dj un label cologique pour ce type de produit. Cette organisation devrait tablir, avec l'aide de tous les producteurs qui voudraient participer au projet, un pourcentage moyen du prix de vente de ce produit qui correspond ses frais de production lĠaide de produits cologiques. Ce gouvernement pourrait ensuite promulguer une loi, autorisant les consommateurs, durant une priode bien dtermine, dduire de leurs revenus imposables, le montant correspondant ce pourcentage. Cette loi devrait, en outre, stipuler des conditions assurant l'efficacit du projet. Ces conditions devraient notamment guarantir que les prix de ce produit soient dtermins en faisant jouer la concurrence.
Mots cls
Consommateur, frais de vie dductibles des revenus imposables, but du dveloppement : intgrit de la nature humaine, principe d'efficacit de l'conomie, zone conomique spciale, pays d'accueil
Un dveloppement durable raliser
Planning
I Les conditions pour que le dveloppement puisse durer
Un mode de vie des consommateurs qui le soutienne.
En consacrant leur argent l'achat de biens et services, les consommateurs crent des courants de biens et services, d'une part, et d'argent, d'autre part. L'ensemble de ces courants compose le dveloppement conomique. Par l'entremise des biens et services qu'ils acquirent, les consommateurs pratiquent un mode de vie. Si les biens et services qu'ils consomment dtruisent ou puisent les ressources qui permettent de les crer, le dveloppement ne peut pas durer. Surviendra un moment o toutes les ressources seront, ou pollues, ou puises, ou dtruites. Il n'y aura donc plus de ressources pour assurer la production de biens et services pour le consommateur. C'est donc bien le mode de vie des consommateurs qui dtermine si un dveloppement peut ou ne peut pas durer.
Un dveloppement durable est, par dfinition, un dveloppement de nature durer longtemps. Pour qu'un dveloppement puisse durer longtemps, il faut qu'il soit soutenu par le mode de vie des consommateurs.
Un but du dveloppement qui en assure la continuit
Un dveloppement est un courant, car il est compos des courants de biens et services et d'argent. Un courant a une direction et un sens. Chaque fois que des consommateurs consacrent leur argent l'achat de biens et services, ils dterminent la direction et le sens dans lequel le dveloppement volue. Ils dterminent galement le but vers lequel s'oriente le dveloppement. Le but dans lequel les consommateurs dpensent leur argent est le but du dveloppement. Le seul but dans lequel les consommateurs peuvent dpenser leur argent, dans la version actuelle de l'conomie de march libre, est celui de consommer toujours davantage.
- Guids par cet objectif, les consommateurs de la plante ont dpens leur argent comme un enfant dpense son argent de poche. Ils ont ainsi men le dveloppement aux confins de la nature. Ces limites ont t, sont ou seront dpasses par le dveloppement. Celui-ci dtruit la nature. L'objectif que l'on s'est fix de consommer toujours davantage a pour autre consquence d'inciter la ralisation de bnfices par tous les moyens possibles et imaginables. Quelques-uns de ces bnfices sont raliss au dtriment de la nature ou de la nature humaine. Maximaliser la diffrence entre Produits et Charges, dans la poursuite d'un dveloppement sans sens, a cr une forme d'"apartheid" dans l'conomie, aussi bien au niveau national qu'international. Mme les enseignants de religion ou de morale de la plante n'ont pas t capables d'empcher que l'usure - d'aprs Larousse : "Dlit commis par celui qui prte de l'argent un taux d'intrts suprieur de" - devienne obsolte. L'usure a perdu de sa valeur au sein des cultures des socits qui poursuivent un dveloppement sans sens. Etre raisonnable et la sagesse, mme la bont, ont cess d'tre des valeurs estimes. La cause efficace des crises cologique, conomique et sociale est l'absence d'un but qui confre un sens au dveloppement et qui en assure la continuit. Cette lacune est un flau pour la plante qui est en train de la dvaster. -
Les biens et services indispensables au dveloppement sont produits partir des ressources de la nature. Ces ressources sont limites par la force des choses, alors que les demandes des consommateurs sont illimites.
Cette dichotomie entre des ressources limites et des demandes illimites est la raison mme de l'conomie. Elle est dfinie comme la science qui tudie le partage de ressources limites en vue de satisfaire des demandes illimites. A cette dfinition il faut ajouter le mot : continment. La dfinition se terminera alors par : afin de satisfaire des demandes illimites, continment. La conjonction de ces facteurs est indispensable, pour que l'conomie devienne la science qui assure aux gnrations futures un dveloppement durable.
L'objectif de consommer toujours davantage ne peut pas tre maintenu ternellement, puisqu'il surviendra un moment o toutes les ressources limites auront t utilises et qu'il n'en subsistera plus. Et pourtant, des thories conomiques appliques dans le monde volu encouragent une consommation toujours plus leve en vue de maintenir la croissance dans l'conomie.
Organisation
II Un mode de vie en harmonie avec la nature
Proposition
Logiquement, dans une conomie de march libre, un mode de vie qui soutient le dveloppement peut tre trac et un but qui en assure la continuit peut tre atteint en agissant sur le pouvoir qu'a le consommateur de choisir les biens et services par le biais de l'argent qu'il y consacre. Ceci amne la proposition suivante : les consommateurs devraient tre habilits dduire de leurs revenus imposables, l'argent qu'ils consacrent l'achat de biens et services respectueux de l'environnment.
- Dans ces conditions, un produit cologique sera dfini par les producteurs comme ils dfinissent une voiture sre : toujours mieux. Contraints, par la loi de la concurrence de satisfaire la demande des consommateurs pour des produits toujours plus cologiques, les producteurs amlioreront leurs produits continuellement. -
Consquence : un but pour le dveloppement
Dans une telle conception de la fiscalit, le consommateur serait en mesure de se procurer des biens et services qui sauvegardent l'intgrit de la nature humaine. Tout produit qui sauvegarde cette intgrit maintient galement l'intgrit de la nature, car l'intgrit de la nature humaine ne peut tre maintenue qu'au moyen de produits de la nature. Dsormais arms de la capacit de grer leurs frais de vie, les consommateurs greraient galement la nature. En rorientant leur consommation vers des produits cologiques, ils adopteraient un mode de vie en harmonie avec la nature. A la faveur de ce mode de vie, ils soutiendraient le dveloppement, tout en tant "regent ou intendant de la nature humaine". L'tre humain peut ainsi tre productif vingt-quatre heures par jour. Tout d'abord, en recueillant des revenus par une utilisation de ressources naturelles pour raliser des produits ; et ensuite, en dpensant ces revenus pour tracer un mode de vie en harmonie avec la nature. Il sauvegarde ainsi la nature dans des conditions qui assurent l'humanit son intgrit, grce aux produits qu'elle consomme. Dans un tel contexte, la sauvegarde de l'intgrit de la nature humaine serait le but du dveloppement.
Thorie
La dcouverte du but du dveloppement est une dmonstration de la validit scientifique de la thorie : les consommateurs doivent pouvoir dduire, de leurs revenus imposables, leurs frais de vie avec des produits cologiques.
Une autre dmonstration de la validit scientifique de la thorie est qu'elle prsente un principe de l'efficacit de l'conomie. Ce principe est : "L'quilibre entre les frais et les revenus doit tre maintenu par les gens qui rcoltent les revenus".
Ce principe est appliqu dans l'conomie de march libre au niveau des frais et revenus de production. Les producteurs peuvent dduire leurs frais de production des revenus que leur procurent les ventes, avant de devoir acquitter des impts sur ce qui reste de ces revenus aprs qu'ils aient support ces frais. - Dans la comptabilit franaise ces frais et revenus sont appels : Charges et Produits. Leur diffrence dtermine le Bnfice ou la Perte. - Grce cette libert de grer ses frais, le producteur peut atteindre, d'une manire efficace, le but de son activit : maximaliser ses bnfices. Cette libert est galement la raison de l'efficacit des producteurs dans l'conomie de march libre partager les ressources limites de cette plante pour satisfaire les dsirs illimits des consommateurs.
La production n'est pas le premier niveau dans l'conomie o des frais sont accrs. La production n'est pas non plus la premire obligation, motivation ou passion de produire des revenus. La premire obligation, celle qui justifie que l'on veuille gagner de l'argent, est la survie ou le soutien d'un mode de vie. Le premier niveau o des frais sont accrs dans l'conomie, est celui de la vie. D'aprs le principe de l'efficacit de l'conomie, cette efficacit augmenterait lorsque le consommateur maintiendrait l'quilibre entre ses frais de vie et ses revenus, avec comme but de maintenir l'intgrit de la nature humaine.
Autres consquences
Quand le consommateur pourra effectivement grer ses frais de vie, il sera logiquement attir par les produits respectueux de l'environnement, par intrts la fois financier et personnel. Ces deux intrts nourrissent des passions puissantes. De plus, le consommateur n'aura qu'intrt tre honntes lors de l'achat de ces produits. - Vivre de produits cologiques est meilleur pour la sant. Les consommateurs auront pour obligation de prouver l'Etat que les produits qu'ils auront achets taient cologiques. Le fait d'tre honntes dans la comptabilisation de leurs frais de vie vitera aux consommateurs tout problme avec l'Etat. - Les intrts personnels et financiers qu'auront les consommateurs tre sincres et honntes lors de l'achat de produits cologiques engendreront et soutiendront un courant thique dans l'conomie de march libre. Faire en sorte qu'une manire thique de conclure les affaires devienne la faon optimale de les traiter, rendrait cette manire normale. "Morabaha", - le mot Islamique pour des bnfices raisonnables - deviendraient des bnfices normaux. L'intgrit pourrait devenir la valeur de base sur laquelle seraient dsormais fondes les activits dans le monde de l'conomie de march libre. Le principe de l'efficacit de l'conomie confre ainsi une base thique l'conomie. Cette base fait dfaut dans la version actuelle de l'conomie du march libre.
Si le consommateur est habilit dduire de ses revenus imposables les frais de vie qu'il a consacrs des produits cologiques, la charge des impts sur le revenu serait transfre des revenus du consommateur de produits cologiques vers ceux des producteurs, utilisateurs des ressources naturelles. L'Etat collecte plus d'impts sur les revenus croissants des fournisseurs des produits cologiques, qu'il n'en perd du fait de la dduction par le consommateur de ses frais de vie cologiques, de ses revenus imposables. Une situation semblable s'est prsente lors de la rvolution industrielle. L'efficacit de l'utilisation des ressources naturelles y a aussi t augmente. Quand le consommateur gre ses frais de vie afin de maintenir la nature en tat, cette efficacit augmentera nouveau.
L'Etat collecte aussi davantage d'impts sur le revenu, en fonction de la disparition d'un march "au noir", les consommateurs ayant dsormais fournir la preuve de leurs achats cologiques, pour qu'ils soient considrs comme des frais dductibles de leurs impts.
De plus, l'Etat doit consacrer beaucoup moins de fonds la sauvegarde de la nature, celle-ci tant dsormais maintenue en tat par ses grants naturels, les consommateurs.
La demande des consommateurs portant sur des produits cologiques crerait une concurrence entre producteurs. Amliorer la qualit cologique de leurs produits deviendrait leur proccupation premire. Ils chercheraient dvelopper des outils et des processus de production de plus en plus cologiques. D'abord, parce qu'ils pourraient imputer les frais de recherche et de dveloppement aux consommateurs. Ensuite, puisqu'ils seraient tenus de fournir des preuves de la qualit cologique de leurs produits. Les consommateurs devraient, leur tour, utiliser ces preuves, pour justifier les dductions d'impts qu'ils solliciteraient. De leur cot, les producteurs dvelopperaient ainsi des cahiers de charges des industries cologiques.
La demande des consommateurs canaliserait les processus de production et polariserait les intrts des producteurs vers le maintien de l'intgrit de la nature humaine. La maximilisation des bnfices serait subordonnne au respect des nouvelles contraintes ainsi dfinies. Les consommateurs conduiraient le cycle de vente vers un quilibre harmonieux avec le cycle d'achats. Ces deux cycles sont prsents dans la figure 2 "Le Trou". Le cycle de vente dbute dans la nature, par le laboureur des ressources naturelles et retourne dans la nature, par les consommateurs des ressources naturelles. Le cycle d'achats dbute dans la nature par les consommateurs et retourne dans la nature par le laboureur des ressources naturelles. Cet quilibre harmonieux entre les deux cycles implique un quilibre harmonieux entre production et consommation. Il implique un quilibre harmonieux entre les frais de production et les revenus de vente des biens et services produits, car toute production implique des frais et toute consommation implique des revenus. Cet quilibre implique donc des bnfices harmonieux. Quand un quilibre harmonieux entre le cycle de vente et le cycle d'achats aura t tabli, les bnfices raliss dans le cadre de cet quilibre harmonieux seraient des bnfices optimaux, donc des bnfices normaux.
L'nergie directive des consommateurs serait libre par le partage du pouvoir socio-conomique en deux pouvoirs quivalents : le pouvoir social de revenu du producteur et le pouvoir conomique d'achat du consommateur. Avec ce dernier pouvoir, les consommateurs seraient capables d'tablir une relation harmonieuse entre n'importe quels groupes de gens dans la socit qui sont associs avec ces deux pouvoirs : des employs et employeurs, la Gauche et la Droite, le Nord et le Sud, L'Est et l'Ouest.
Grce leur pouvoir conomique d'achat, les consommateurs dirigent et maintiennent le dveloppement align sur les limites de la nature. Non obstru par ces limites, le dveloppement blouira de nouveau. Le consommateur entretient son progrs en lui assignant l'objectif de sauvegarder l'intgrit de la nature humaine, par son mode de vie.
La pratique qui veut que le travailleur apporte les fruits de son travail une autorit, inconditionnellement, aurait pris fin. L'esclavage aurait pris fin. Il s'y substitue un quilibre harmonieux entre l'nergie vitale du consommateur et le force de l'Etat, entre Yin et Yang. Au znith de la socit, le pouvoir pourra nouveau rayonner, avec sagesse. Celle-ci sera puise dans les aspirations de chaque consommateur de vivre en harmonie avec la nature et la nature humaine, donc, en paix. Un quilibre entre l'homme et sa nature peut tre trouv, dans lequel la ralit est une fonction continue de la vrit, tout moment. L'homme ou la femme peut alors garder contact avec la cause finale de la vie, car la vrit est la ralit de l'amour.
La gestion des frais de vie favorise la biodiversit. Une analyse du berceau la tombe y est implicite. Cette analyse dmontre l'impact des diffrences dans les terres cultives sur les vitamines, minraux et traces d'lments des produits. Elle dmontre aussi l'impact de ces diffrences sur la couleur, forme ou durabilit des produits cultivs ou levs. Ces diffrences dterminent les diffrences en valeurs nutritives, prventives, mdicales, commerciales et d'autres valeurs connues ou tre connues des produits de la terre. Ces diffrences seront utilises comme arguments de vente. La biodiversit est requise afin de concurrencer dans un mode de vie optimal l'intrieur de la nature et de l'conomie de march libre. Tous les produits de la terre seront vendus comme du vin. Dans "Le Monde" des 6 et 7 Novembre, 1999, un article indique que des exprimentations menes au sein de l'Union Europenne et soutenues par la Commission Europenne, dmontrent que des rcoltes diminuent de 80 grammes par mtre carr, chaque fois que le nombre d'espces diverses est divis par deux.
La libert personnelle de soutenir, par le biais de ses frais de vie, un dveloppement humain et thique, dbouchera sur un dveloppement soutenu, car cette libert permettra tout le monde de maintenir l'intgrit de sa nature, grce ses revenus.
Le prochain pas franchir logiquement, dans la voie d'un partage plus quitable du pouvoir entre un plus grand nombre de gens, ayant pour objectif ultime la dmocratie, la justice et la paix, consistera partager le pouvoir avec le consommateur. Ce pas pourra tre franchi en confiant ce consommateur le soin de maintenir l'intgrit de sa propre nature par le biais de ses propres revenus.
Opration
III Comment introduire la gestion des frais de vie dans l'ordre tabli par la loi?
En Belgique, il existe une loi stipulant que les frais qui assurent un revenu peuvent tre dduits de ce revenu, avant que des impts soient dus au prorata du solde de ce revenu. Un consommateur pourrait donc y engager une procdure judiciaire tendant valuer la possibilit quĠaurait le consommateur en gnral, de dduire, de ses revenus imposables, ses frais de vie, en tant que frais qui assurent un revenu pour lĠternit. Comme frais susceptibles dĠtre dclars dductibles des revenus imposables de ce consommateur, pourraient, par exemple, tre proposs les frais de location et de fonctionnement dĠun bateau voile qui aurait transport de la marchandise, dans le cadre de la ralisation dĠun projet de recherche. Le but de cette recherche aurait pu tre de trouver une mthode dĠexploitation dĠun moyen de transport qui assurerait des revenus pour lĠternit. Les frais supports par ce consommateur pourraient tre prsents comme des frais de recherche de processus assurant un revenu pour lĠternit. Un avocat est dispos entamer un procs pour dmontrer que ces frais, rpondant aux exigences de la loi, ont bien pour objet d'assurer le revenu de ce consommateur. Quel que soit le rsultat de ce procs qui, ce stade nĠest que potentiel, le consommateur dot dĠune capacit comptable prendre en charge sa responsabilit naturelle pour la nature humaine, est une ralit dont il convient de tenir compte.
Dans lĠconomie de march libre, le consommateur est plus quĠun intermdiaire dans le cycle de vie dĠun produit. Les Òrgents ou intendants de la nature humaineÓ cherchent une rgion dĠaccueil, un pays prt riger une rgion en zone conomique spciale. Cette rgion entrerait dans la ralit macro-conomique de la plante, comme un dfi, par le biais de lĠintroduction dans ladite zone, dĠun label commun chaque produit. Le label mettrait en vidence le pourcentage du prix dĠun produit correspondant ses frais de production, au moyen de produits respectueux de lĠenvironnement. Ce label indiquerait le degr cologique de chaque produit.
Il est vraisemblable quĠ lĠheure actuelle, la majorit des produits des pays industriellement dvelopps, porterait sur des pourcentages un chiffre. Ces pourcentages reprsenteraient un dfi moral amliorer la qualit cologique des produits grce auxquels nous assurons notre mode de vie. Ces pourcentages constitueraient un dfi pour les producteurs locaux. Ils pourraient envisager de fabriquer, dĠune manire cologique, des produits provenant habituellement de pays industrialiss. Il y aurait une demande locale pour leurs produits, car les consommateurs dans la zone pourraient dduire, de leurs revenus imposables, l'argent qu'ils consacreraient lĠachat de ces produits,. Le label fermerait les frontires de la zone tous produits qui auraient un degr cologique infrieur au pourcentage pratiqu dans la zone. Derrire cette barrire, les producteurs dvelopperaient une industrie cologique.
Imaginons que la Chine propose une zone conomique spciale. Le rsultat en dcouler pourrait tre que les producteurs chinois se lanceraient dans le dveloppement dĠune industrie cologique, dans une version cologique de l'conomie de march libre, derrire une barrire conomique respecter dans le commerce international. Les producteurs chinois dvelopperaient cette industrie dans le but commun de ne jamais payer lĠEtat chinois dĠimpts sur les revenus qu'ils utiliseraient comme consommateur. Ils atteindraient leur but, pour autant quĠils puissent dmontrer l'Etat quĠils vivent en harmonie avec la nature, grce aux produits de cette industrie. Dans une version cologique de march libre, les Chinois maintiendraient l'intgrit de la nature humaine, pendant leurs heures de loisirs, avec le pouvoir conomique de leurs achats et ils maximaliseraient du bnfice, pendant leurs heures de travail, avec le pouvoir social de leurs revenus. LĠindustrie cologique de la Chine deviendrait rapidement un dfi pour lĠindustrie dans la version actuelle de lĠconomie de march libre.
La zone conomique spciale devrait tre dote, de prfrence, dĠun centre universitaire ou acadmique, tabli au milieu dĠune zone rurale. - Les achats des consommateurs dans une zone rurale reprsentent, en gnral, surtout pour des produits alimentaires, une partie importante des revenus des producteurs de cette zone. La demande des participants au projet obligerait ces producteurs amliorer la qualit cologique de leurs produits. - Au dbut, la participation au projet serait limite aux membres de la communaut acadmique et universitaire. Ils introduiraient, dans un systme comptable, leurs frais de vie, au sein de leur centre de hautes tudes. De tels centres dĠtudes pourraient devenir des centres de traitement des donnes relatives aux frais de vie. Ces centres pourraient fournir aux participants des listes de frais de vie prsenter lĠadministration fiscale, comme tant dductibes de leurs impts. Ils pourraient aussi raliser toutes les analyses utiles ou ncessaires, par exemple, au dveloppement des pourcentages portant sur le label cologique.
DĠautres centres de traitement des donnes relatives aux frais de vie des participants au projet pourraient tre tablis proximit de cits administratives, hospitalires, ducatives, commerciales, militaires ou carcrales de la zone. Chacun de ces centres collecterait les donnes relatives aux frais de vie de ses membres. La zone serait dote dĠun systme comptable de Òrgents ou intendants de la nature humaineÓ. Quand ce systme serait oprationnel, tous les habitants de la zone pourraient participer au projet. Des recherches seraient menes en vue dĠtendre dĠautres rgions la gestion des frais de vie. La rgion dĠaccueil deviendrait ainsi le berceau dĠun dveloppement thique et humain, dans une version cologique de lĠconomie de march libre.
La zone pourrait tre cre dans un pays qui bnficie dĠaide au dveloppement, par endettement. Aprs un certain temps, les producteurs de ladite zone pourraient proposer que lĠaide soit change, contre un droit, pour les consommateurs qui acquittent des impts sur le revenu auprs du donateur de lĠaide, dduire, de leurs revenus imposables, le pourcentage cologique du prix dĠachat des produits venant de la zone. Cette dduction serait justifie, en ce sens quĠelle favorise le dveloppement cologique. La logique de la gestion des frais de vie pourrait ainsi tre introduite dans lĠconomie des donateurs dĠaide au dveloppement, par le biais de leur comptabilit nationale. La dmarche pourrait favoriser lĠextension progressive d'autres rgions de la version cologique de lĠconomie de march libre. LĠintroduction du label cologique dans la zone devrait acclrer cette volution, grce au fait quĠelle rige une barrire conomique efficace.
Le fait de pouvoir sĠintroduire dans les marchs des pays donateurs dĠaide au dveloppement, au moyen de produits gnrs par des processus de production en harmonie avec la nature, rend attractive la coopration avec les producteurs de la zone, pour ceux que se trouveraient dans la mme situation de dveloppement que celle des producteurs de la zone. Des producteurs dĠautres pays bnficiant dĠaide au dveloppement pourraient nouer des liens commerciaux, dans une version cologique de lĠconomie de march libre.
Les dettes des pays bnficiant dĠaide au dveloppement pourraient tre rembourses, par le biais dĠun dveloppement dĠune industrie respectueuse de lĠenvironnement, dans ces pays. Les producteurs de ces pays consacreraient leur activit satisfaire la demande des consommateurs des pays donateurs dĠaide, tendant changer leur mode de vie. Par voie de consquence, cette demande accrue procurerait des revenus et devises supplmentaires aux pays endetts, rendant possible le remboursement de leur dette.
Le Brsil est incontestablement dans une situation favorable lĠouverture dĠune zone conomique spciale. Il dispose notamment de ressources convoites par toute lĠhumanit en tant que poumons de la terre : ses forts vierges. Comme alternative lĠabattage des arbres, Benjamin Barber suggre aux Brsiliens de vendre lĠoxygne que procurent les forts amazoniennes, sur le march de l'conomie de marche libre, eventuellement en faisant concurrence aux autres pays qui veulent vendre lĠoxygne de leurs forts. M. Barber est l'auteur de "Jihad vs McWorld". Il sĠagit dĠ un conomiste, consult par le Prsident Clinton depuis 1996. (10) En fonction des rsultats des activits dans la zone quĠil aurait cre, le Brsil pourrait formuler, comme autre alternative, la proposition de permettre aux consommateurs des pays industrialiss qui acquerraient ses produits cologiques, de dduire les frais dĠachat de ces produits de leurs revenus imposables, en tant que frais favorisant la sauvegarde de la virginit des forts vierges. Le Prsident Clinton a, du reste, rcemment propos, dans son Message sur l'Etat de l'Union, lĠadoption de stimulants fiscaux pour les consommateurs qui achtent des produits cologiques. (11)
Ds quĠune telle zone aura t ouverte par le Brsil, une autre zone pourrait sĠouvrir en Equateur, plus prcisment dans la rgion de ÒBahia de CaraquezÓ, ville qui fut dtruite en 1998 par une coule de boue. Les autorits de cette ville ont dcid, par un arrt de fvrier 1999, que la ville serait reconstruite en tant que ÒBahia EcologicaÓ. Dans cette mouvance, les responsables communaux tudient actuellement une proposition tendant lĠouverture dĠune zone conomique spciale. (12)
DĠici l, un gouvernement pourrait tester l'efficacit de la gestion des frais de vie comme moyen de motivation des consommateurs vivre en harmonie avec la nature, en lĠappliquant un produit de grande consommation, comme le pain, le riz, les pommes de terre ou le mas, par exemple. Ce gouvernement pourrait slectionner une organisation de contrle qui gre dj un label cologique pour ce type de produit. Il pourrait demander cette organisation de dterminer un pourcentage moyen des prix de vente de ce produit qui correspond ses frais de production lĠaide de produits cologiques. Cette organisation pourrait calculer cette moyenne avec l'aide de tous les producteurs qui voudraient participer au projet. Ce gouvernement pourrait ensuite promulguer une loi, autorisant les consommateurs, durant une priode bien dtermine, dduire de leurs revenus imposables, le montant correspondant ce pourcentage.
Cette loi pourrait stipuler que la dduction pourrait tre comptabilise ds l'achat, par une rduction de prix. Dans ce cas, un taux moyen dĠimposition appliquer aux consommateurs de ce produit devrait tre dtermin, pour pouvoir tre appliqu. Cette diminution dĠimpt accorde au consommateur ds l'achat de ce produit cologique dmontrerait dĠemble l'impact de la gestion des frais de vie sur la conduite du consommateur. L'obligation faite aux consommateurs de rendre compte de la qualit cologique de leurs achats serait, dans de telles conditions, satisfaite par les vendeurs qui auraient accord les rductions. Ils devraient communiquer lĠEtat les quantits dudit produit qu'ils auraient vendues de mme que les montants des rductions quĠils auraient accordes. Un centre dĠtude pourrait prendre en charge la collecte et le traitement de ces donnes.
Un nombre suffisant de producteurs devraient tre impliqus dans le projet, afin que celui-ci apporte des indications fiables quant la manire dont le prix de ce produit voluerait, dans une version cologique de l'conomie de march libre. Pour garantir que ce prix soit tabli en faisant jouer la concurrence, d'autres producteurs pourraient tre admis, en cours de projet, y participer. A elle seule, la simple demande tendant pouvoir participer au projet, soulignerait dj l'intrt quĠaccorderaient les producteurs voir les frais de vie faire dsormais lĠobjet dĠune gestion.
Le 7 fvrier 2000, nous avons reu un engagement du Dr. Xavier Gamboa Villafranca, d'ouvrir une zone conomique spciale au Mexique, dans la partie sud de l'tat Quintana Roo. "Cette zone est, ce qui peut tre considr la dernire frontire environmentale du Mexique. CEPROS a des forts liens de coopration avec l'universit de l'tat, l'University de Quintana Roo." Dr. Xavier Gamboa Villafranca est le Prsident du Conseil d'Administration de CEPROS AC (Center for the Study of Juncutral, Predictive and Prospective Studies) (11)
Ncessit d'une gestion des frais de vie
Le systme de contrle en vigueur au sein de l'Union Europenne, dvelopp en collaboration par le monde scientifique, le gouvernement europen et l'industrie alimentaire, n'assure pas la scurit de l'alimentation. (1) Selon une confrence intitule: "La scurit alimentaire", qui s'est tenue Bruxelles (Belgique), le 21 octobre 1999, les rsultats des contrles effectus en application de ce systme, sont encore : "tenter d'empcher la dernire crise". De toute manire, la frquence de ces crises augmente. Les autorits allemandes ont pu arrter la pollution par la dioxine dans le lait, juste avant qu'elle ait atteint le niveau d'une crise. La dioxine aurait t introduite dans la nourriture des vaches par des pelures d'oranges venant de Brsil. Les autorits allemandes n'ont cependant pas pu empcher cette pollution. L'objectif de la mise au point d'un systme de contrle tait qu'il assurerait une alimentation sre pour tout le monde en l'an 2000. Tous les orateurs ont ax leurs interventions sur la ncessit d'informer, d'duquer, ou mieux encore, d'engager le consommateur dans un processus assurant la scurit de l'alimentation. Un dernier effort de l'industrie alimentaire allant en ce sens consiste utiliser des listes de spcifications positives auxquelles doit satisfaire l'alimentation.
L'une de ces spcifications pourrait tre que la nourriture soit produite au moyen des processus de production assurant des revenus pour l'ternit. Cette dfinition d'une alimentation respectueuse de l'environnement impliquerait la mise en oeuvre d'un cahier des charges, lequel contiendrait notamment des spcifications concernant les ressources utiliser et les moyens de transformation appliquer. Ce cahier des charges devrait dfinir ces spcifications dans les moindres dtails, portant entre autres sur les processus de production de chaque produit, depuis sa cration jusqu' sa disparition ; de son berceau sa tombe.
Le cahier de charges d'une industrie proccupation cologique, ne pourrait tre conu que par les producteurs. Ceux-ci seraient tenus d'appliquer toutes les spcifications dans le cadre du processus de production. En appliquant ces spcifications, ils dcouvriraient d'autres techniques et moyens d'amlioration de la qualit cologique de leurs produits. Il ne serait de leur intrt rechercher, introduire et dvelopper de telles amliorations, que s'ils pouvaient faire supporter par les consommateurs les frais de recherches et de dveloppement, sans pour autant nuire leur position concurrentielle. Ces conditions pourraient tre satisfaites si les consommateurs pouvaient, leur tour, dduire, de leurs revenus imposables, leurs frais de vie assure par le biais de produits cologiques.
Dans de telles conditions, la demande des consommateurs deviendrait une force qui inciterait les producteurs s'loigner des limites rgissant chaque contrle. De ce fait mme, cette force empcherait la survenance de nouvelles crises. Les producteurs n'opreraient plus en se cantonnant aux limites de la crise de pollution. La demande des consommateurs les forcerait se livrer une concurrence essentiellement axe sur une meilleure qualit cologique de leurs produits. Cette qualit s'amliorerait forcment, jusqu' ce que soit atteinte une qualit cologique des processus de production qui soit en harmonie avec les processus de la nature. La demande des consommateurs tendant pouvoir bnficier d'une bonne alimentation rendra celle-ci effective lorsque ces consommateurs seront habilits faire tat de leur frais de vie, dans une comptabilit publique de "rgents ou intendants de la nature humaine".
Si les consommateurs ne pouvaient pas dduire, de leurs revenus imposables, leurs frais de vie cologiques, les producteurs ne pourraient, par voie de consquence, pas leur imputer les frais de recherches et de dveloppement, sauf mettre en pril leur position concurrentielle. Ainsi, titre d'exemple, Van Leer's Vatenfabrieken Amstelveen, aux Pays-Bas, avaient achet une invention capable de rendre la matire plastique plus biodgradable. Or, il s'est avr que cette socit ne pourrait pas vendre les produits fabriqus grce cette technique, du fait que ses clients n'taient pas disposs payer le prix plus lev occasionn par l'utilisation de cette production plus cologique. Chaque gobelet caf aurait en effet cot un cent de plus. De mme, toute mesure qui serait impose par l'Etat, tendant amliorer la qualit cologique d'un produit, aurait pour effet d'en augmenter le cot et aurait donc une consquence ngative sur la position concurrentielle. C'est bien pourquoi les producteurs se bornent ne respecter que de manire minimale, les limites de qualit imposes par l'Etat. C'est aussi ce qui explique que, dans de telles conditions de production proches des limites de la crise de pollution, celle-ci pourrait survenir la moindre erreur ou la premire panne srieuse. Les crises surgiront fatalement des frquences plus leves.
En fonction de la sophistication croissante des polluants potentiels et de leurs effets aggravs sur les gnes et cellules, chaque pollution dpassant les limites de crise pourrait liminer la population d'une fraction d'une ville, dans un laps de temps qui pourrait devenir de plus en plus bref. De tels polluants pourraient aller jusqu' rendre cette population aveugle ou la mutiler soit mentalement, soit physiquement, d'autre manires, au cours de ce mme laps de temps. Telle pollution pourrait s'accompagner de fuites et devenir une arme aux mains de bandes, cartels ou groupes nourrissant des intentions belliqueuses ou nfastes.
L'incapacit dans laquelle se trouve, en pratique, l'Union Europenne d'assurer la scurit de l'alimentation, en faisant application de son systme de contrle, dmontre logiquement qu'aucune assurance ne peut tre donne, quant une qualit ou un tat, en s'assurant simplement du respect, ou de l'adhsion des normes minimales. Seuls des contrles rguliers visant soutenir une qualit ou un tat atteints et une recherche continue amliorer cette qualit ou cet tat peuvent assurer une qualit ou un tat. Pareil contrle est du ressort de grants. Ce manque de succs assurer la scurit de l'alimentation rend plus urgente encore l'introduction de la notion de gestion des frais de vie. Si l'Union Europenne ne peut pas assurer la scurit alimentaire, quel pays, tat ou nation pourrait l'assurer?
Des programmes publics ayant eu pour objet le subventionnement de projets cologiques, n'ont pas non plus atteint les rsultats escompts.
Une "note de recherche" analyse des formes de polices et de programmes gouvernementaux, aussi bien dans des pays en voie de dveloppement que dans des pays dvelopps. Elle encourage la ralisation d'investissements dans des technologies plus vertes et le partage de ces technologies.(2) "La privatisation pourrait tre une bonne opportunit de progresser dans la voie d'une production environtallement plus durable. Ce progrs pourrat tre atteint par des incitations financires introduire des technologies plus propres pendant la restructuration de la production. Pourtant, il apparat que de tels progrs ne sont pas apparus. Le seul rsultat que les gouvernement ont obtenu est d'assumer la responsabilit de nettoyages." (3)
"Le prochain stade de la recherche doit porter sur des tudes de cas plus en profondeur, pour comprendre avant tout, comment ces programmes fonctionnent institutionnellement, dans la ralit; deuximement dans quelles conditions ces polices amliorent avec succs la coopration technologique et, troisimement, l'impact de la technologie environnementale sur l'environnement." (4)
Cette mme conclusion, selon laquelle il faut savoir comment appliquer des programmes et polices proposs, pour assurer le succs de la dmarche tendant rendre l'conomie plus cologique, est implicite dans le rapport du Groupe de Lisbonne : "Les limites la comptition". Le rapport s'achve par un dernier point : "c) identifier les moyens de mettre excution les quatre contrats globaux". (5)
La connaissance au niveau des institutions gouvernementales en ce qui concerne la rsolution de la crise cologiques et des crises conomique et sociale que cause celle-ci, apparat dans la presse et dans un document officiel :
Dans une interview, publie dans le "Newsweek" du 27 septembre, 1999, Klaus Tpfer, Directeur excutif du Programme Environmental des Nations Unies et ancien Ministre de l'Environnement d'Allemagne, souligne que la crise cologique empire globalement. Il termine sa description du problme en dclarant qu' : "Ajourner l'action n'est plus une option". Sa rponse la question: "Quelle sorte d'actions est ncessaire", est la suivante : "Il est indispensable d'tablir des polices plus comprhensives et mieux intgres." "Des institutions internationales, des gouvernements, le secteur priv, des organisations non-gouvernmentales, la communaut scientifique - ils doivent apprendre travailler plus troitement, en symbiose" (6)
Quelques mois plus tard, dans le "Newsweek" du 24 janvier 2000, Les Nations Unies mettent une annonce, invitant tout le monde, partout, leur envoyer leurs ides, notamment sur "des solutions possibles des problmes conomiques courants -- des ides donner des raisons d'espoir rel pour un futur meilleur pour les citoyens du 21 ime sicle." (7)
" (...) Mais la loi du 5 mai 1997 va plus loin et prvoit, durant cette mme priode, une large consultation de la population. De nombreux arguments justifient une telle consultation. Deux dĠentre eux sont dvelopps ici car ils revtent une grande importance dans un contexte de dveloppement durable.
Le premier argument a trait lĠincertitude scientifique. Malgr les progrs normes de la science et de la connaissance, force est de constater aujourdĠhui que des aspects essentiels du fonctionnement des systmes cologiques et sociaux nous chappent toujours, de mme que lĠimpact que peuvent avoir sur eux les activits humaines. " (8)
"Le deuxime argument concerne la participation, lment-cl de la dmocratie. Mme si le gouvernement prend les dcisions appropries, leur effet restera certainement insuffisant si elles ne sĠaccompagnent pas de rels changements de comportement la fois dans le chef des entreprises et des citoyens. La socit a atteint un tel degr de complexit et de dynamisme, quĠune simple rglementation rgissant ce qui est permis ou non ne suffit plus. En dfinitive, chaque citoyen, par son comportement, comme consommateur, automobiliste, travailleur ou industriel, porte une certaine part de responsabilit." (9)
Bruxelles, le 25 mars 2000 W.A. de Bruyn
Transformation littraire par Gil Touraine
1 EU control system does not assure safe food, prsent ce site de ZERO, sous : Latest News
2 Tecbahia, Revista Baiana de Technologia, Volume 14, Nomro 2, Maio/Ago 1999, "How to stimulate investments in and sharing of Environmental technology between developed and developing countries : a research note", Jos Antnio Puppim de Oliveira, page 39, premire colonne, premire phrase
3 idem : page 42, premire colonne, premire paragraphe
4 idem : page 43, premire colonne, premire paragraphe, dernire phrase
5 "Limits to competition", The Group of Lisbon, Gulbenkian Foundation - Lisbon 1993, page 177
6 "Newsweek", September 27, 1999, page, 76 : "Greening the Global Agenda"
7 "Newsweek", January 24, 2000, page, 10 : "Shaping a better future for all"
8 Avant-Projet de Plan Pour Un Dveloppement Durable 2000-2003, Janvier 2000, Avant Propos : "2.2.2. Une large consultation", page IV, paragraphe 2 et paragraphe 3, phrases 1 et 2
9 idem, page V, premier paragraphe
10 "De Morgen" 18-12-1999 (ed. Algemeen), De Financile Morgen, Rudi Rotthier, "Gesprek met Clinton-adviseur Benjamin Barber over globalisering", "De economie wil ons kinds houden"
11 Environment News Service (ENS) 2000, "Clinton's State of the Union Envisions Greener FutureÓ prsent ce site de ZERO sous : Latest News et au site de Environment News Service avec URL : http://ens.lycos.com/ens/jan2000/2000L-01-28-01.html
12 ECUADOR GREEN CITY REVISITED, AUGUST '99 by Peter Berg, prsent ce site de ZERO sous : Projects to apply the theory ; Ecuador Green City Project
13 The Mexico Project, prsent ce site de ZERO sous : Projects to apply the theory.
Figure 2 : Le Trou
A sustainable development to be realised
Abstract
Consumers sustain their way of living with the goods and services that make up economic development. This development could endure in an economy in which consumers could deduct, from taxable income, the money they spent on products that are ecologically sound. Consumers would use this accounting capacity to live with goods and services that maintain the integrity of human nature. They would be driven to do so by the ability to take care of their personal and financial interests, simultaneously. In this ecological version of the free market economy, consumers would give sense to development. To maintain the integrity of human nature would be the goal of development.
A consumer could initiate a trial process in a country in which the law states that costs that assure an income can be deducted from this income before taxes have to be paid. In this perspective, the consumer could try to demonstrate that the costs of living, sustained by the use of ecological products, procure income for eternity. Because of this law and in this country, these costs would therefore be deductible from taxable income. Whatever the result of this process, consumers present themselves with the accounting capacity to deduct costs from taxable income, to take charge of their responsibility to maintain Nature in a good state. This responsibility for Nature is sustained by the natural responsibility of the consumer for human nature.
In the free market economy, the consumer is more than a canal to pass in the life cycle of a product. Consumers who aspire to be "steward or trustee of human nature" are looking for a country willing to establish a special economic zone. This zone would enter the macro-economy as a challenge, with the introduction of a common label in the zone, for all products. This label would present the percentage of the price of a product that corresponds with its costs of production with ecological products. It would thus indicate the ecological degree of each product.
The percentages of one figure, which many products would present today, would be a challenge for producers to improve the ecological quality of the products with which we live in the free market economy. The label would constitute an ecologically justified economic barrier. It would keep all products out of the market in the zone that had a lower percentage than the lowest percentage practised in the zone. Behind this barrier, the producers could develop an ecological industry. The zone would become the cradle of a human and ethical development. The producers in the zone would have a head start in this development. Brazil is in a favourable position to open the first of these zones.
In the mean time, a government could test the efficiency of the management of the costs of living in motivating consumers to live in harmony with Nature, by applying it to a product of mass consumption, such as bread, rice, potatoes or corn, for example. First, this government would have to select an organisation that already manages an ecological label for this kind of product. This organisation would have to establish, with the help of all the producers who would like to participate in the project, an average percentage of the price of this product that corresponds with its costs of production with ecological products. This government could then issue a law that authorises consumers, during a well defined period, to deduct, from their taxable income, the amount that corresponds with this percentage. This law should, moreover, stipulate the conditions that guarantee the efficiency of the project. These conditions should guarantee in particular that the prices of this product would be determined by competition.
Key words
Consumer, costs of living deductible from taxable income, to maintain the integrity of human nature, goal of development, principle of efficiency of the economy, special economic zone, label indicating ecological degree of a product, "steward or trustee of human nature"