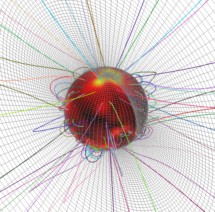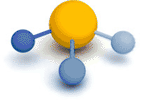|
En 1668, (Paul Dupuis était natif de Beaucaire, en Lanquedoc. Son père s'appelait Simon, et sa mère Suzanne Brusquet.) arrivaient sur La Grosse Ile et l'Ile-aux-Grues deux-ex-officiers du régiment de Carignan avec leurs jeunes épouses. Il s'agissait de Paul Dupuis et de Pierre Bécard de Granville. Ils s'étaient mariés le même jour, le 22 octobre 1668, dans l'église de Québec. Le premier avec Jeanne Couillard, fille de Louis Couillard, premier seigneur de la Rivière du Sud, le second avec Anne Macard, fille de Nicolas Macard et de Marie Couillard, soeur de Louis. Jeanne Couillard et Anne Macard étaient donc cousines germaines.
Louis Couillard avait donné à sa fille la moitié de la Grosse et de la Petite Ile-aux-Oies et la moitié de l'Ile-aux-Grues. Monsieur Bécard de Granville avait, le 16 octobre 1668, acheté l'autre moitié. MM. Dupuis et Bécard s'engagèrent, par contrat, à mettre en commun les biens qu'il possédaient et ceux qu'ils pourraient acquérir durant trois ans.
Après s'être rendus sur leurs îles, ils y travaillèrent en commun pendant trois ans. Le 10 octobre 1671, ils se séparèrent et un partage eut lieu qui donnait la Grosse Ile-aux-Oies à monsieur Dupuis et la Petite Ile-aux-Oies et l'Ile-aux-Grues à monsieur Bécard. Pour ce qui est des prairies qui se rencontrent et qui sont entre la Grosse et la Petite Ile-aux-Oies, elles seront partagées également entre les dites parties. Les battures dans la Grande Ile-aux-Oies autour de la Petite Ile-aux-Oies et de la dite Ile-aux-Grues appartiendront au Sieur de Granville. Pour ce qui est de l'anse du nord-est, les Sieurs de Grandville et Dupuis se les réservent pour leur chasse et celle de leurs enfants.
Ce fut sous l'administration de monsieur Dupuis que la Grosse Ile-aux-Oies fut colonisée et qu'elle prit alors son plein essor.
Paul Dupuis s'y établit avec sa famille, il y fit de la culture et de l'élevage. Plusieurs chefs de famille, encouragés par cet exemple, vinrent le rejoindre et bientôt on vit sur ces îles près de quarante personnes y compris les femmes et les enfants.
Un recensement de 1681 nous a transmis les noms suivant:
Paul Dupuis, sa femme et leurs six enfants ;
Deux domestiques du nom de Claude Guichard et de René Lavergne ;
Pierre Lamy, sa femme, Renée Montmigny, et un enfant ;
Pierre Michaud, sa femme, Marie Asselin et cinq enfants ;
Guillaume Lemieux, sa femme Elizabeth Langlois, et dix enfants ;
Mathurin Ducheron, sa femme Marguerite Roussel, et quatre enfants ;
Charles Potvin.
Pour sa part, Paul Dupuis avait, à la même date, 20 arpents de culture et 24 têtes de bétail. Lamy, Michaud et Potvin avaient chacun 7 arpents de terre et Ducheron cinq.
Monsieur Paul Dupuis était un homme très vertueux. Voici ce qu'en dit M. l'abbé Casgrain:
Son manoir offrait l'image d'un cloître bien réglé. Outre les prières du matin et du soir que l'on faisait en commun, les heures de travail étaient partagées de pieuses lectures et d'autres saints exercices auxquels ils présidait lui-même. Il consacrait en outre plusieurs à l'oraison. Cette vie édifiante avait fait une profonde impression sur les familles qu'il avait groupées autour de lui et qui le vénéraient comme le patriarche de l'île.
Quoique M. Dupuis vécut très retiré dans ses terres et qu'il ne parut à Québec que bien rarement, la réputation de sa sainte vie et de ses vertus s'y était cependant répandue, et plus d'une fois les gouverneurs jetèrent les yeux sur lui pour l'élever aux dignités de la magistrature.
Après quelques années il quitta son île pour venir s'installer à Québec et il occupa successivement les charges de lieutenant particulier et de lieutenant général de la Prévôté de Québec.
Ces divers changements de fortune, dit le même biographe ; ne changèrent rien des ses habitudes de piété et de vie exemplaire ; son assiduité aux offices divins et sa grande dévotion envers la Sainte-Vierge, dont il était un des plus fervents congréganistes était un sujet d'édification générale. Chacun le respectait et vénérait comme un saint. Ce qui charmait surtout ce vénérable septuagénaire, c'était de voir que sa haute piété ne lui avait rien fait perdre de l'enjouement et des manières aimables du gentilhomme.
Monsieur Dupuis eut treize enfants. La plupart étaient nés à l'Ile-aux-Oies. Edifiées par la vie exemplaire de leur père, trois de ses filles entrèrent au monastère.
Deux d'entre elles devinrent Augustines tandis qu'une autre se fit Ursuline.
Geneviève fut la première à entrer chez les dames de l'Hôtel-Dieu, sous le nom de Mère de la Croix et elle fit profession le 22 novembre 1691 à l'âge de 16 ans 7 mois.
Elle décéda le 28 novembre 1747 après 56 ans de vie religieuse ; elle fut supérieure de sa communauté pendant six ans de 1720 à 1726.
Marie-Madeleine, sa soeur, connue sous le nom de Mère Marie-Madeleine de la Nativité, prit l'habit des postulantes le 15 septembre 1711. D'après les annales de l'Hôtel-Dieu, la Mère de la Nativité était une femme distinguée par se piété et son goût prononcé pour l'étude. La Mère de la Nativité fut inhumée le 2 octobre 1724. ceci explique pourquoi monsieur Dupuis vendit aux hospitalières de l'Hôtel-Dieu sa seigneurie de l'Ile-aux-Oies, une partie de la vente servit à payer la dot de ses deux filles.
Marie entra une première fois chez les Ursulines, en ressortit pour y entrer à nouveau et y mourir.
Voici ce qu'en disent les annales des Ursuline:
Douée de beaucoup d'esprit et d'une grande vivacité, Melle Dupuis, à sa sortie du couvent, n'eut pas de peine à se faire des amis, et elle se trouva bientôt entourée de tout ce qui semble propre à charmer un jeune coeur ; mais prévenue par l'inspiration céleste, elle se tint en garde contre le piège. Ce combat entre la grâce et l'attrait des plaisirs qui paraît comme impossible de soutenir à tant d'autres, la jeune Marie le soutint avec une étonnante facilité. Elle avoua à une amie intime qu'elle n'éprouvait dès lors qu'un extrême éloignement pour les créatures qui ne laissent après elles que vide et ennui, quoiqu'aimables qu'elles nous paraissent.
De retour au Monastère en qualité de postulante, Melle Dupuy se distingua tout d'abord par se ferveur, et elle prononça ses voeux avec la piété d'un ange, ne s'apercevant même pas d'un accident qui déranges toute l'assistance. Son attrait particulier la portait à prier sans cesse, accomplissant ce précepte du divin Maître, non pas précisément à la manière de ces saints et saintes qui sont en adoration perpétuelle, mais en tenant son coeur attaché à Dieu au milieu des plus pressantes occupations, vivant dès ici-bas, d'une vie toute céleste et toute divine. Elle ne comprenait pas que l'on pût jamais s'ennuyer à la prière, et avouait ingénument qu'elle se sentait une inclination aussi forte et entraînante à faire oraison, que l'oiseau à s'envoler dans les airs ; elle eût passé dans ce saint exercice les nuits entières si l'obéissance ne s'y fut opposée... Elle célébrait toujours dans de nouveaux sentiments de ferveur, de gratitude envers Dieu, chaque anniversaire de son entrée en religion et de sa vêture et de sa profession religieuse, appelant ces jours bénis sa Pâques particulière et délicieuse, où le Seigneur l'avait fait passer de la terre d'Egypte en la terre du repos et de la paix.
Cette chère Soeur semblait pressentir la mort qui devait la réunir à son céleste Epoux ; toujours est-il qu'à cette époque on s'aperçut qu'elle tendait à un plus parfait détachement des choses de la terre. Sa tendresse pour sa famille était extrême et elle eut d'immenses sacrifices à faire en la quittant ; que dire donc du glaive qui transperça son âme quand elle se vit enlever, presque en même temps, sa mère, trois de ses soeurs, en petit neveu et une petite nièce! Cependant, dit la novice, non seulement elle accepta avec résignation toute céleste la coupe amère de la douleur, mais pour s'assurer d'une générosité plus complète, elle s'offrit elle- même comme victime au Seigneur. Son offrande fut agréée ; atteinte de la petite vérole qui faisait alors de si affreux ravages dans le pays, elle mourut le septième jour dans les dispositions où elle avait vécu.
Cette jeune Soeur, sur laquelle la Communauté avait tant compté pour l'avenir, achevait à peine sa vingt-quatrième année, dont elle avait passé neuf au service du Seigneur.
Une autre de se filles, Suzanne, avait épousé le 4 juillet 1701, monsieur Jean Petit, trésorier de la marine et ancien contrôleur des rentes de l'Hôtel de Ville de Paris.
Entouré de ses enfants, de sa femme et de sa belle-mère Geneviève Després, veuve du seigneur Louis Couillard, Paul Dupuis avait écoulé des jours heureux dans sa propriété située sur la place de l'église, mais en l'espace de 10 ans, ceux qui l'entouraient disparurent. Dieu fait souvent passer ses amis par le creuset des souffrances et des tribulations pour les rendre plus dignes de Lui et de la récompense qu'Il leur promet.
Ce fut d'abord la mort de sa femme bien-aimée, Jeanne Couillard qui mourut le 12 juillet 1702.
L'épidémie de petite vérole qui s'abattit ensuite sur Québec lui ravit trois de ses filles.
Suzanne qui venait d'épouser monsieur Petit ;
Marie qui était entrée chez les Ursulines ;
Louise-Madeleine qui était encore à la maison.
Voici en quels termes l'annaliste de l'Hôtel-Dieu parle de cette épidémie:
L'année 1702, un chef sauvage mettait pied terre à la Basse-Ville, après avoir fait en canot d'écorce, quoique malade, le long trajet qu'il y a entre la Nouvelle- Angleterre et Québec. Si les citoyens de cette ville, qui l'avaient regardé débarquer avec indifférence, avaient soupçonné quel hôte terrible, quoique invisible, faisait son entrée avec lui dans leur murs, il auraient reculé d'épouvante. Ce sauvage reçut l'hospitalité dans une famille où il ne tarda pas à tomber dangereusement malade. Tout son corps se couvrit de pustules livides et infectes que l'on reconnut bientôt pour la petite vérole. Comme presque tous les sauvages attaqués de cette maladie, il en mourut en peu de jours.
Le gouverneur, M. de Beauharnois, lui fit faire des funérailles avec tous les honneurs qu'on avait coutume de rendre aux capitaines de sa nation.
L'épidémie s'était communiquée à la famille où il était mort, et de là par toute la ville et dans les campagnes. Durant le cours de l'hiver, ce fléau sévit sur toute la surface de la Nouvelle-France avec une violence dont on n'avait jamais eu d'exemple.
A Québec qui était le principale centre de la population, des familles entières se trouvèrent frappées, et le peu de soin qu'elles recevaient, joint à l'infection et à la malignité de cette peste, les faisaient mourir fort promptement: il est vrai qu'il en mourut un grand nombre à qui rien n'avait marqué, et que l'effroi s'étant mêlé dans cette affliction générale, plusieurs moururent de peur, sans qu'on pût remarquer sur leur corps aucune apparence de petite vérole. La mortalité fut si grande que les prêtres ne pouvaient suffire à enterrer les morts, et à assister les mourants. On portait chaque jour les corps dans l'église de la Basse-Ville ou dans la cathédrale sans aucune cérémonie, et le soir on les inhumait quelquefois jusqu'à quinze, seize, dix-sept, dix-huit ensemble. Cela dura plusieurs mois, en sorte que l'on comptait sur les registres mortuaires plus de deux milles morts dans Québec, sans parler des environs qui n'eurent pas meilleur sort. Jamais on n'a tant vu de deuil ; chacun pleurait ses proches, l'un sa femme, l'autre son mari ; celui-ci son frère, celui-là ses enfants, les orphelins pleuraient leur père et leur mère ; tout le monde était dans les larmes, et pendant tout l'hiver, on ne s'assembla que pour des funérailles. Ceux qui n'étaient pas attaqués de ce mal, fuyaient les maisons où il y avait des malades ; malgré leurs précautions, ils étaient pris à leur tour et mouraient comme les plus exposés.
Notre hôpital fut rempli d'une si grande quantité de malades que, ne pouvant les y loger tous, et n'ayant pas d'endroit chaud pour y mettre, nous les plaçâmes dans le coeur ; on interrompit les observances et nous retardâmes les vêtures de mes soeurs Jeanne-Geneviève Beaudry de la Conception et Françoise Auclair de Saint-Bernard qui étaient entrées dans le cours de l.été, parce que dans le temps de nous reconnaître. Nos religieuses tombèrent malades en si grand nombre, dès le commencement, qu'il n'en resta pas assez de saines pour soigner les pestiférés de nos salles et de nos infirmeries. Nous acceptâmes l'offre que plusieurs bonnes veuves nous firent de nous rendre service, Elles venaient pour avoir soin des religieuses malades, tandis que les religieuses qui se portaient bien avaient soin des salles, car nous ne voulûmes pas faire servir les pauvres par des séculières. Ce fut une espèce de bonheur de ce que nous essuyâmes, les premières les rigueurs de ce fléau, parce que cela nous mit en état de soulager les autres dans le temps qu'ils en eurent le plus de besoin et cela nous donna aussi l'expérience qu'il fallait pour les traiter. Il en mourut peu à l'hôpital en comparaison de ce qu'il en mourut dans la ville, ce qui redoublait l'empressement qu'on avait de venir chez nous.
La plupart des religieuses, accablées de veilles et de lassitude, furent atteintes par la contagion: cinq d'entre elles succombèrent. Les noms de ces cinq victimes qui, toutes à la fleur de l'âge, immolèrent leur vie au chevet des mourants, pour l'amour de Jésus-Christ, méritent d'être mentionnés dans cette histoire. Ce sont la mère Marie-Angélique Mony de Saint-Agnès, qui n'était âgée que de vingt ans ; la soeur Marguerite Côté de Saint-Paul, religieuse conversé, qui avait que vingt-neuf ; la mère Marie-Madeleine Maufis de Saint-Louis, âgée de trente-deux ans ; la mère Marie-Anne Gauvreau de Sainte-Thérèse de Jésus, âgée de trente-deux ans ; enfin la mère Louise Roussel de Saint-Gabriel, âgée seulement de trente ans.
Presque toutes ces chères soeurs parurent d'abord se rétablir à la suite de leur maladie ; mais épuisées sans doute par les excessives fatigues qu'elles avaient subies auparavant, elles entraient soudainement en agonie au moment où elles paraissaient en voie de convalescence, et expiraient en quelques heures. On avait la précaution de leur donner d'avance les derniers sacrements, d'abord pour ne pas les effrayer au moment d'une crise, et ensuite pour être délivré d'inquiétude à leur égard.
L'année 1703 peut être comptée parmi les plus tristes qu'ait eu à traverser le monastère de l'Hôtel-Dieu, soit à cause de la part intime qu'il prit à la consternation générale et au deuil de tant de familles décimées, soit à cause de la mort prématurée de plusieurs de ses membres, sur qui il fondait de belles espérances.
On peut imaginer le chagrin que causa à monsieur Dupuis ces disparitions soudaines de trois de ses filles.
En 1712, la mort frappait à nouveau à sa porte et sa belle-mère, Geneviève Després, qu'il aimait tant, décédait à l'âge de 72 ans.
Il ne lui restait plus, à part les deux Augustines, que ses fils, Simon et Jean-Paul, mais ils avaient suivi la carrière des armes et étaient loin de lui. Comme Job, il ne se révolta pas contre le Dieu qui l'avait éprouvé si durement.
Il employa la fin de sa vie à la prière comme il l'avait toujours fait et se consacra à des oeuvres de charité.
Paul Dupuis vit arriver le terme de son existence avec calme ; sa mort fut celle d'un saint. Il fut inhumé le 20 décembre 1713 dans l'église de Québec. La disparition de cet homme de bien causa un deuil profond au pays tout entier et en particulier aux maisons religieuses de Québec qui perdaient en lui un vrai protecteur.
Le malheur n'avait pas fini de s'acharner sur cette famille et ses deux fils, Simon et Jean-Paul, ne devaient pas lui survivre longtemps.
Simon, l'aîné, s'était enrôlé tout jeune encore dans l'armée coloniale ; il avait fait les campagnes d'Acadien et de la Nouvelle-France. Revenu en garnison à Montréal,on le retrouve, en 1716, dans la maison de Jacques le Ber, sieur de Senneville. C'est là qu'il fit son testament par l'entremise de l'abbé Priat, prêtre de St-Sulpice et vicaire de Notre-Dame. Ce dernier le déposa au greffe du notaire Adhémar.
Le lecteur aimerait sans doute à connaître les dernières volontés de mourant. D'abord, il demande à être inhumé dans l'église de Ville-Marie, avec un service solennel au jour de se funérailles, et un second, à l'anniversaire de son décès. Il désire six cents messes basses de requiem ; il donne aux pauvres de la paroisse 200 francs ; à la chapelle de la Congrégation, chez les Jésuites, à Montréal, 200 francs ; à madame Forestier, épouse de Jean-Baptiste Bissot, sieur de Vincennce, son gobelet, sa cuiller, sa fourchette, le tout d'argent, en reconnaissance des services qu'elle lui a rendu pendant sa maladie ; à Melle Marie Arnault, novice chez les dames de la Congrégation, 60 livres pour contribuer à sa dot ; à Jean-Baptiste Bernard dit Jolicoeur, son vieux surtout, sa veste, sa culotte, pour les bons services qu'il lui a rendus, déclarant lui avoir payé ses gages jusqu'à ce jour ; à Mme Louise Bissot, veuve de M. de la Valtrie, capitaine, 50 francs pour les bons services qu'elle lui a rendus.
Simon Dupuis, sieur de l'Isloye, fut inhumé le 6 avril 1716:
Le sixième jour d'avril de l'an mil sept cent seize, a été inhumé, dans l'église de cette paroisse le corps de Simon Dupuis, âgé de trente-huit ans, écuyer, enseigne d'une compagnie du détachement des troupes de la marine, après avoir reçu les sacrements de l'Eglise.
Témoins: François Chaumeaux et François Chazé,
prêtres de cette ville.
Signé: Chaumeaux, Chazé.
Dans sa chambre a esté trouvé ce qui suit: Un lit de plume couvert de peau de chevreuil ; un matelas de layne couvert de toile bleue, un petit tour de lit en serge rouge, fait en tombeau orné d'une petite frange rouge, une cassette couverte en peau de loup marin dans laquelle s'est trouvé un porte-feuille ; un petit portefeuille en loup marin avec une agrafe d'argent, dans lequel s'est trouvée une carte de quarante livres, sept cartes de vingt livres, une cartes de six livres, deux cartes de quarante sols faisnt la somme de 191 livres, un gobelet, une cuiller et une fourchette et deux boutons, le tout d'argent, deux vieux couteaux à ressort ; un petit miroir de poche, couvert en chagrin, une paire de ciseaux à barbe, deux petits livres de dévotion ; un petit pistolet de poche avec son fourreau ; une vielle paire de jarretières et un crochet d'épée d'argent ; un écritoire de corne ; une vieille paire d'heures de la Congrégation ; deux rasoirs et une pierre à rasoir avec trousse ; une livre de poudre à poudrer ; un petit paquet de bouttons de fil ; un livre du Nouveau- Testament ; un petit livre de compte contenant 23 feuilles écrites concernant les affaires particulières ; une obligation consentie par le dit feu Sieur Dupuy à monsieur Petit, trésorier, retirée ; une autre de Jean Hins dit Langlois, retirée par le dit sieur, au profit du sieur Paul Guillet ; un billet de la somme de 26 livres en Castors ; seize billets du Sieur de Lilloy acquittés et mis en liasse ; trois vieilles perruques ; une petite courte-pointe, doublée et piquée ; une robe de chambre de Camélia rouge ; deux vieux manteaux de draps rouges ; une ceinture noire ; un plumet nir ; quatre tomes de la vie des Saints ; un nouveau testament ; les caractères de Théophraste, et les oeuvres de Balzac... Voilà ce qui constituait le trousseau d'un soldat.
Son frère Jean-Paul, étaient entré, comme son aîné, dans la carrière des armes. Quoique fort jeune, il prit part aux expéditions d'Acadie et de la Nouvelle-Angleterre. On rapporte que, grâce à son concours, la fille d'un juge anglais, capturée par les sauvages, fut sauvée d'une mort certaine. monsieur Dupuis sans s'occuper de la longueur du chemin, la porta sur ses épaules jusqu'à Montréal. Lorsque le jeune héros arriva à Ville-Marie, écrit M. Sulte, la ville lui fit une ovation.
Nous ignorions quant mourut Jean-Paul Dupuis ; ce fut avant 1717, puisque Geneviève Després, tante des Simon et Jean-Paul Dupuis, qui les avait choisis, comme ses héritiers à la condition qu'ils lui paieraient rente le reste de ses jours, se vit contraintes de faire annuler le contrat qu'elle avait fait avec eux, le 6 mars 1714. Le Conseil Souverain, à qui elle s'adressa pour rentrer en possession de son bien, lui accorda ce qu'elle demandait, par une décision en date du 19 juillet 1717, dans laquelle il est dit que les deux fils de M. Paul Dupuis étaient décédés.
|