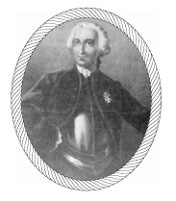
Levé par commission du 25 mai 1657 en Roussillon et en Catalogne par le cardinal Mazarin, le régiment Catalan-Mazarin fait tout d'abord partie des corps étrangers. Appelé à l'armée de Flandre en 1658, il est notamment engagé lors du siège de Gravelines. Après la mort de Mazarin en 1661, le régiment devient propriété du roi Louis XIV sous le nom de Royal-Catalan. Un brevet du 27 janvier 1667 lui donne finalement le titre de Royal-de-Roussillon.
I/ PREMIÈRES ARMES SOUS LOUIS LE GRAND
Durant la brève guerre de Dévolution, Royal-Roussillon s'illustre particulièrement au siège de Lille, en août 1667. En 1670, il compte parmi les troupes choisies pour occuper le duché de Lorraine.
Lorsqu'éclate la guerre de Hollande, Royal-Roussillon se distingue en janvier 1675 par la prise du fort de Litzel, dans la région de Trèves, dont il massacre la garnison. Celle-ci pillait systématiquement nos convois de ravitaillement. En 1677, le régiment participe successivement à la prise de Valenciennes, de Cambrai et de Saint-Ghislain. Le 8 mars 1678, il s'illustre lors de la prise des deux demi-lunes de Gand qui entraîne la chute de la ville. Royal-Roussillon est encore signalé au siège d'Ypres. Surtout, il repousse les gardes du prince d'Orange à la bataille de Saint-Denis-sous-Mons, perdant huit officiers au feu durant cette seule journée.
Après la paix de Nimègues, Royal-Roussillon va prendre possession de la citadelle de Casal, « porte de l'Italie », cédée au roi de France par notre allié le duc de Mantoue. C'est alors que « en 1682 [Royal-Roussillon] reçu par incorporation le régiment corse de Péni. Depuis cette époque il s'est recruté exclusivement de sujets français, et à la mort de Louis XIV il ne conservait plus de trace de son origine étrangère. » (Susane, p. 400).
En 1684, il assiste à la prise de Luxembourg où il subit des pertes sérieuses.
Lors de la guerre de la ligue d'Augsbourg, Royal-Roussillon se fait remarquer sous les ordres de Vauban à la prise de Philippsbourg. Mais le régiment se signale plus brillamment encore à la bataille de Neerwinden, le 29 juillet 1693. Tenu en réserve une bonne partie de la journée, il est engagé dans la soirée puis lancé dans l'assaut décisif qui permet aux nôtres de prendre le village. Les pertes sont lourdes mais le prince d'Orange doit battre précipitamment en retraite. Royal-Roussillon s'illustre encore au siège de Charleroi en septembre-octobre 1693, en particulier lors de l'attaque de la redoute de Dormoy.
Une paix de courte durée est signée. L'acceptation de l'héritage espagnol par Louis XIV met l'Europe en émoi et déclenche la guerre de succession d'Espagne. Le 20 juin 1703, Royal-Roussillon participe à la bataille d'Eckeren contre les Hollandais. En 1704, on retrouve le régiment au camps de Neerhespen sous les ordres de Monsieur d'Artagnan.
Le régiment participe à diverses opérations et se trouve le 11 juillet 1708 à la bataille d'Oudenarde. Les alliés ont Marborough et le prince Eugène à leur tête, les meilleurs généraux de leur temps. Nos troupes sont défaites et doivent se replier sous la couverture de quelques troupes dont celle de Royal-Roussillon qui perd son colonel, Monsieur de Ximenès dans l'action.
L'année suivante, le régiment se trouve sous les ordres de Villars à Malplaquet, le 11 septembre. Posté à notre aile droite aux côtés du vieux régiment Picardie, Royal-Roussillon tient ses positions toute la journée durant; tous ses officiers sont blessés au cours de cette fameuse journée. Si l'armée française, très inférieure en nombre, compte 8 000 tués ou blessés et doit finalement battre en retraite, les Alliés ont perdu 20 000 hommes et sont incapables de nous poursuivre.
Royal-Roussillon ne participe pas à la bataille de Denain mais ses grenadiers se rattrapent héroïquement au siège de Fribourg en septembre-novembre 1713. A cette occasion, Villars vantera leur bravoure à Louis XIV : « La valeur de nos grenadiers ne peut trop être louée... Pour moi, je suis dans l'admiration. »
II/ DU RHIN AU QUÉBEC
La paix d'Utrecht de 1713 ouvre une longue période de paix jusqu'à la guerre de succession de Pologne en 1733. Royal-Roussillon va se battre en Italie où il se signale en emportant à l'arme blanche le chemin couvert de Pizzi-Ghetone malgré un feu violent.
Le 29 juin 1734 à la bataille de Parme, le régiment fait prisonniers 400 Autrichiens et un général à lui tout seul. Le 15 septembre, au combat malheureux de la Secchia, Royal-Roussillon reste en arrière-garde, sauve notre artillerie et parvient à la ramener jusqu'au camp. Les hostilités cessent en 1735.
Peu après, la République de Gênes sollicite la médiation armée des Français contre les Corses révoltés. Royal-Roussillon est dépêché sur l'île où il mène des combats de guérilla qui confirment sa valeur de 1739 à 1742.
Alors éclate la guerre de succession d'Autriche (1741-1748). Après deux ans d'inaction en Flandre, Royal-Roussillon est envoyé sur le Rhin. Le 4 septembre 1743, il est à Rheinweiler d'où sont repoussés les Autrichiens. Puis à Augenheim les grenadiers du régiment contribuent à la défaite de l'ennemi.
Mais devant la triste tournure prise par nos affaires d'Italie, Royal-Roussillon est envoyé couvrir nos frontières méridionales en 1746. L'année suivante, lors de l'attaque manquée du terrible Col de l'Assiette qui nous coûta 6 000 hommes, il se signale par sa bravoure et « [excite] l'admiration des Autrichiens » (Susane, p. 405) au prix de lourdes pertes.
Lorsque éclate la guerre de Sept Ans, les deux bataillons du régiment sont séparés.
Le premier est envoyé à l'armée du Mein. La malheureuse journée de Rosbach (le 5 novembre 1757) l'éprouve vivement. Cependant, dans la confusion de la défaite, le bataillon fait une longue et admirable résistance avant de se replier lentement et en bon ordre.
Surtout, il se distingue à la bataille de Bergen du 13 avril 1759 où Soubise repousse Brunswick. Avec le vieux et glorieux régiment de Piémont, Royal-Roussillon brise tous les assauts ennemis. Puis les deux régiments chargent une colonne adverse et la mettent en déroute, une seconde colonne venue à son secours subit le même sort et se fait même prendre ses canons. Il faut l'intervention d'une troisième colonne pour arrêter enfin leur impétueux élan. Vivement éprouvé, le bataillon est alors envoyé en France pour s'y reconstituer.
Pendant ce temps, le second bataillon était parti renforcer nos troupes du Québec avec cinq autres bataillons. Il comptait alors 31 officiers et 525 hommes.
En février 1757, 1 100 volontaires dont plusieurs soldats de Royal
En août, Montcalm attaque le fort de Saint-Georges. Royal-Roussillon ouvre la tranchée et la place tombe. Nos hommes se signalent alors par un beau geste : « lorsque les Anglais se retiraient avec les honneurs de la guerre, une vingtaine d'entre eux fut massacrée par des sauvages ; l'intervention des nôtres empêcha de plus grands malheurs » (J. de Verzel, p. 34). Royal-Roussillon prit ensuite ses quartiers d'hiver chez l'habitant aux environs de Montréal où il reçut 69 nouvelles recrues.
Le 8 juillet, le bataillon est présent à la bataille de Carillon. Il occupe le centre de la ligne commandée par Montcalm en personne. En dépit de leurs assauts réitérés, les Anglais ne peuvent ébranler nos troupes et doivent se retirer, laissant 5 000 hommes sur le terrain pour 377 français. À la suite de cette victoire, Montcalm s'exclame dans une lettre « Ah ! quelles troupes que les nôtres ! Je n'en ai jamais vu de pareilles. » Au mois d'octobre, Royal-Roussillon reprend ses quartiers d'hiver près de Montréal.
Pourtant, malgré ces hauts faits d'armes, la guerre au Québec touche à sa fin. Les Français doivent affronter des troupes dix fois plus nombreuses que les leurs. Montcalm regroupe alors ses forces autour de Québec. La première bataille de Québec est livrée le 13 septembre 1759. Dernier à rompre le combat avec La Sarre, Royal-Roussillon se distingue par sa bravoure. C'est d'ailleurs à son colonel, Monsieur d'Haussonville, que le marquis de Montcalm mourant transmet ses derniers ordres, lui recommandant de bien mener la retraite et de « ménager l'honneur de la France ».
Royal-Roussillon laisse un piquet de 40 hommes à Québec où son lieutenant-colonel de Bernetz commande en second. Après la chute de la ville, Royal-Roussillon passe une fois de plus l'hiver aux alentours de Montréal.
Au printemps, Vaudreuil et le chevalier de Lévis montent une opération pour reprendre Québec. Royal-Roussillon est de l'expédition. La seconde bataille de Québec est livrée le 28 avril 1760. Formés en bataille, les Anglais tiennent solidement la plaine d'Abraham. Bientôt, le combat fait rage, indécis. Le lieutenant-colonel de Poulhiarès lance alors une charge à la baïonnette sur le flanc gauche de l'ennemi avec Royal-Roussillon et Guyenne. Les Anglais fléchissent, se débandent, abandonnent 22 canons et « s'enfuient jusque dans la ville demeurée sans défenseurs. Un effort de plus, impossible à donner en raison de la grande fatigue des Français, et ceux-ci franchissaient derrière eux les portes de Québec. » (J. de Verzel, p. 37). Les Français assiègent la ville sans succès puis doivent se retirer devant l'arrivée de renforts ennemis.
En septembre 1760, Montréal tombe. Nos soldats reçoivent les honneurs de la guerre mais doivent prendre l'engagement de ne plus combattre avant la paix. Ils sont ramenés en France par des navires Anglais. Ils débarquent à Rochefort en 1661. Leurs officiers recevront de nombreuses pensions et gratifications du roi en récompense de leurs actions héroïques.
III/ VICTOIRES AU LOIN
Après le traité de Paris, 24 régiments sont expressément affectés à la garde des ports et des colonies. Les exploits de Royal-Roussillon outre-mer le signalent particulièrement pour cet office. Envoyé à Marseille, il est le premier de ces régiments.
En 1765, la France fait une nouvelle opération de police en Corse pour le compte de Gênes qui finit par vendre l'île à Louis XV. Une violente insurrection éclate alors sous le commandement de Paoli. Expédié sur les lieux, Royal-Roussillon se signale aux combats de Barbaggio et de Patrimonio. Surtout, il s'illustre le 24 août 1768 à Nonza où une colonne française est prise en embuscade. Sans se disloquer, la colonne gravit la montagne, prend l'avantage du terrain. Serrant les rangs, elle disperse les assaillants et leur inflige de lourdes pertes. À la suite de cet engagement, Monsieur de Chauvelin écrira au roi : « On ne peut trop louer la valeur de M. de Trans, colonel du Royal-Roussillon, et des capitaines de Bassignac et Martignac, du même régiment. »
Le régiment reprend le poste de Murato, enlevé par les Corses, et décime les insurgés à Mezana. L'île est bientôt entièrement pacifiée. Royal-Roussillon peut rentrer en France à la fin de l'année 1770.
En 1772, Royal-Roussillon reprend son service dans l'armée de terre après la création de régiments spéciaux pour la garde des ports et des colonies.
Avec la reprise de la guerre contre les Anglais en 1774, les Français interviennent aux Indes. Le deuxième bataillon de Royal-Roussillon est envoyé en renfort au marquis de Bussy qui se trouve près de Pondichéry.
Fort de sa supériorité numérique, le général Stuart vient à la rencontre de notre petite armée. Le choc a lieu à Gondelour, le 13 juin 1783. Nos grenadiers sont tout d'abord mis en déroute et se replient sur les tranchées tenues par Royal-Roussillon et Austrasie qui brisent l'élan britannique. Un second assaut des Anglais tourne à leur confusion. Alors, les tambours battant la charge, les deux régiments français culbutent définitivement l'ennemi. La relation officielle du combat dit que « en moins de quatre minutes, les colonnes anglaises furent enfoncées; ce qui se sauva de la baïonnette ne put éviter les coups de fusil des soldats qui chargeaient en courant et s'arrêtaient pour tirer avec plus de sûreté. » Les Anglais perdent 900 Européens et 2000 Cipayes pour 400 des nôtres hors de combat. À cette occasion, son lieutenant-colonel de Vaugiraud se fait remarquer et acclamer. Malade comme on peut l'être sous ces climats souvent fatals aux Européens et alité, il se dresse au bruit de la fusillade, court au feu et trouve la force de galvaniser ses hommes par sa bravoure toute la journée durant.
Le traité de Versailles met bientôt fin aux hostilités et Royal-Roussillon est rapatrié.
Vient la Révolution. Par le règlement du lu janvier 1791 substituant des numéros aux noms des régiments, Royal-Roussillon devient le 54ième d'infanterie.
Lorsque la guerre éclate, le 1er bataillon se distingue à la bataille de Jemmapes. En 1794, il est versé dans la 107ième demi-brigade.
Quand au deuxième bataillon, après s'être illustré dans la défense de Mayence, il est intégré à la 108ième demi-brigade.
ANNEXES
Royal-Roussilon avait des drapeaux dont les quatre quartiers présentaient respectivement les couleurs bleue, rouge, verte et feuille morte. La croix blanche était semée de fleurs de lys d'or.

Le premier uniforme du régiment était composé d'un habit et d'une culotte blancs ou gris blanc ; la veste, les parements et le collet étaient bleus ; les boutons et le galon du chapeau étaient d'or , les poches étaient en pattes avec 3 boutons ; il y avait six boutons sur les manches. En 1763, l'uniforme entièrement blanc du régiment fut distingué par le collet, les revers et les parements vert de Saxe et les boutons jaunes [couleurs qui distinguaient les 24 régiments affectés à la défense des ports et des colonies]. En 1772, les parements et les revers devinrent bleu céleste, et, en 1776, on y ajouta le collet rouge. Les boutons à cette dernière date furent blancs. » (Susane, p. 4 10)
Liste des mestres de camp ou colonels du régiment royal de Roussillon
1/ baron de CARAMANY (Joseph), 26 mai 1657
2/ comte de XIMÉNÈS (Joseph), 30 mars 1672
3/ marquis de Proissy (N. de Ximénès), 10 Juin 1701
4/ marquis de XIMÉNÈS (Augustin), 17 juillet 1708
5/ duc de Biron (Louis-Antoine de Gontaut), 22 juillet 1729
6/ comte d'HAUSSONVILLE (Charles-Bernard de Cléron), 23 novembre 1734
7/ marquis du HAUTOY (N.), 1er janvier 1748
8/ comte d'HAUSSONVILLE (Louis-Bernard de Cléron), 13 janvier 1759
9/ duc de CHATILLON (Louis Gaucher), 30 novembre 1761
10/ comte de LÉVIS
11/ marquis de VILLENEUVE DE TRANS (Louis-Henri), 5 juin 1763
12/ marquis de FRÉMEUR (Jean-Toussaint de La Pierre), 11 juin 1774
13/ marquis de VAUBOREL (Louis-Malo-Gabriel), 13 avril 1780
14/ marquis de BROISSIA (Marie-Charles-Hilaire-Flavien Froissard), 10 mars 1788
15/ de GASTON (Michel-Etienne), 25 juillet 1791
16/ DUMESNIL (Pierre-Michel-Joseph Salomon), 27 mai 1792
Ouvrages de référence :
Louis SUSANE : Histoire de l'ancienne infanterie française
Jean de VERZEL : Le 54ième de ligne

On peut appercevoir ici le sergent Bataille à gauche muni de son fourniment, et le soldat Michel à droite portant la veste et justeaucorps.
L'uniforme porté par le régiment en Nouvelle-France ressemble en plusieurs points à celui des compagnies franches de la Marine, mis à par de la culotte et de la doublure du justeaucorps (grand manteau régimentaire) blanche au lieu de bleue. Les régiments des troupes de terre portent également sur leur doublures des grenades ou coeurs dépendemment de si ils appartiennent à des compagnies de grenadiers ou de simples fusillers. Ces motifs sont posés à quatre endroits sur la doublure pour cacher les petites attaches qui permettent de rabattre les flancs du justeaucorps pour faciliter les mouvements du soldat (comme c'est le cas sur la photo ci-dessus).
La compagnie que personnifie les membres des miliciens et réguliers est celle des grenadiers, ayant occupé le dernier fort français en Nouvelle-France de 1759 à 1760. Le Fort Jacques-Cartier est situé aux abords de la rivière du même nom tous près de Donnacona dans la région de Portneuf. Nos grenadiers portent un collet, autre distinctive des troupes de terre, par rapport à leurs homologues de la Marine. Les collets ne font pas parti de l'ordonnance pour les troupes de terres envoyées au départ pour protéger la colonie, mais font leur apparition graduellement avec les années; en effet, les uniformes donnés aux soldats sont renouvlés normalement à chaque année, et ils sont de la responsabilité du soldat d'en faire l'entretien.
Contrairement à la croyance populaire, les soldats français ne portent pas tous des habits bleus. Seuls quelques régiments d'infanterie étrangère à la solde du Royaume, des régiments d'élite comme les mousquetaires et les cuirassers du Roy, la plupart des tambours régimentaires, les artilleurs, les ingénieurs, l'État-major et quelques régiments de dragons portent au XVIIIe siècle un justeaucorps bleu. En fait, la plupart des uniformes des troupes du Roy de France sont de blanc; couleur de la pureté Royale! Les autres couleurs en vogue pour les uniformes militaires à l'époque sont bien entendu le rouge (même chez les français), le violet, le vert, le jaune, les couleurs unies et faciles à distinguées sur le champs de bataille.

Le régiment de Royal-Roussillon n'y fait pas exception. Ce qui pourra permettre de le différencier de d'autres régiments comme le régiment de Languedoc par exemple, sera la couleurs des boutons, leurs quantités sur les poches ou parement de justeaucoprs, leur nombre de rangées sur la veste, la forme des poches...
Le Royal-Roussillon possède un uniforme de laine gris-blanc aux boutons de laiton pour les soldats et d'or pour ses officiers. Les galons décoratifs au chapeau et aux parements (pour caporaux et sergents) sont d'or faux pour les soldats et d'or véritable pour les officiers. Plus le rang est élevé, plus les éléments décoratifs sont d'importance. Ainsi, on voit souvent sur le contour du tricorne des hauts-officiers d'un régiment des plumes blanches.
Le reste de l'équipement des grenadiers est ceinturon permettant d'accueillir un sabre et une baïonette, une cartouchière de 30 charges, des souliers, des guêtres de toile blanche pour protèger les bas, 2 chemises et des bas assortis à la culotte.
Merci à Monsieur Jean de France, Duc de Vendome pour le texte sur l'historique du régiment.