C'est entendu, les grands singes
ne « parlent » pas comme nous : ils ne disposent pas de
l'appareil vocal adéquat. Qui plus est, leur cerveau,
trois fois plus petit que le nôtre, ne leur permet pas
de dépasser l'intelligence d'un enfant de trois ans. «
Mais les recherches auprès des bonobos, des singes dont
il ne resterait que quelques milliers d'individus dans
les forêts de l'est du Congo, sont tout de même
troublantes », dit Stewart Shanker, professeur de
philosophie et de psychologie à l'université de York,
qui participe à des expériences avec ces singes pour
mieux comprendre l'autisme et l'aphasie chez les enfants.
Dans le grand arbre de l'évolution, les bonobos (et les
chimpanzés) forment le dernier embranchement qui sépare
les primates des hominidés. Nous partageons avec eux 99
% de notre patrimoine génétique, un petit pour cent de
différence qui nous permet tout de même de bien nous démarquer
!
Comme nous, ces grands singes sont bipèdes, et leur
cerveau possède les zones où le langage semble se
concentrer chez l'homme : les aires de Broca et de
Wernicke. Leurs capacités cognitives sont suffisantes
pour comprendre des modes de communication complexe. Kanzi, un bonobo élevé par la chercheuse Sue
Savage-Rumbaugh,
au Centre de recherche sur le langage en Géorgie, est
capable de comprendre plus de 500 mots d'anglais, agencés
en phrases structurées (sujet-verbe-complément). «
Kanzi peut aussi, grâce à un tableau de symboles,
communiquer plus de 200 concepts », dit Stewart Shanker,
convaincu que les bonobos avec lesquels il a travaillé
essayaient de prononcer son nom.
Des observations menées en milieu naturel laissent
entendre que ces singes utiliseraient des « marqueurs »
dans la forêt pour indiquer, par exemple, le chemin vers
la nourriture aux autres membres du groupe. « Cela
signifierait qu'ils sont naturellement sensibles à
l'abstraction et à la sémiologie », dit Stewart Shanker. D'autres recherches récentes indiquent que ces
singes posséderaient une « théorie de la pensée ».
Autrement dit, ils ont conscience de leur propre pensée,
et de la nôtre. « On a testé leur capacité à mentir
ou à communiquer sur quelqu'un d'absent, sur le passé
ou l'avenir. Dans tous les cas, les résultats sont
positifs », dit Stewart Shanker.
Aucun bonobo n'arrive cependant à la cheville d'un
enfant humain qui devient un « as » du langage à l'âge
où il fait pourtant encore pipi au lit ! Mieux : le
petit humain joue avec la langue, en inventant sans cesse
de nouveaux mots, comme les adultes. Si brillant que soit Kanzi, le génie de la langue lui échappera toujours.
 Le gorille des montagnes Le gorille des montagnes
Ils
vivent dans la chaîne des volcans Virunga, réserve
naturelle divisée en trois grandes parties :
- Le
Parc National des Virunga, situé au Zaïre
- Le
Parc National des volcans au Ruanda
- La
réserve des gorilles de l'Ouganda
C'est
cette espèce très menacée et découverte seulement en
1902 qu'a étudiée Dian Fossey au centre de recherches Karisoke. George Schaller en avait dénombré environ 450
en 1959. Après une décrue significative dans les années
60, leur nombre a progressivement réaugmenté, pour
atteindre environ 650 animaux aujourd'hui.
Le repeuplement des gorilles ne peut être qu'assez lent,
car en plus de la mortalité non naturelle, la femelle ne
peut mettre au monde que 6 ou 7 petits dans sa vie (la période
d'allaitement après la naissance est de 3 ans).
Les
gorilles vivent en groupe avec à la tête de chaque
groupe un "dos argenté", mâle dominant
appelé ainsi à cause des poils de son dos de couleur
gris clair (qui apparaissent vers l'âge de 11 ans). Il
veille sur le groupe, rythme ses déplacements et choisit
et protège ses femelles. La mort d'un dos argenté crée
en général l'éclatement du groupe.
Le gorille passe beaucoup de temps à chercher sa
nourriture. Il est végétarien et se nourrit de
feuilles, de fleurs, d'écorces, de racines, de fruits et
de pousses de bambous. Quand il ne mange pas, le gorille
se repose (au soleil si possible), joue ou se déplace
dans la montagne. Il confectionne chaque jour un nouveau
nid à l'aide de branches et de plantes, soit par terre
soit dans un arbre.
Pour étudier
et reconnaître ses protégés, Dian Fossey se servait
des excréments trouvés dans leur nid pour les suivre médicalement
et déterminer leur âge. En outre, chacun des gorilles
pouvait être identifié de manière certaine grâce à
ses empreintes nasales.
Évolution de la situation
Depuis
Dian Fossey (assassinée en 1985), de nombreuses
organisations internationales - comme la fondation Digit
qu'elle a créé du nom d'un de ses protégés assassiné
- ont poussé le gouvernement ruandais à entretenir des
patrouilles anti-braconnage et à mettre en place un
programme d'éducation destiné à faire prendre
conscience de l'importance de la sauvegarde de l'espèce
aux ruandais.
Le braconnage, même s'il diminue, continue encore malgré
les lourdes peines de prison encourues par leurs auteurs,
qui tuent aussi indirectement les gorilles par des pièges
à antilopes.
Les
braconniers et les collectionneurs ne sont pas les seuls
responsables de la diminution du nombre des gorilles. En
effet, la superficie du parc naturel occupé par les
gorilles a été réduite en raison de la nécessité
pour la population d'acquérir de nouvelles terres
fertiles.
De plus, la culture du pyrèthre (plante nécessaire à
la fabrication d'un insecticide, destinée à
l'exportation) sensée enrichir le Ruanda, a obligé elle
aussi à défricher la forêt et a donc privé les
gorilles d'une partie de leur parc naturel.
Le gorille est donc obligé de chercher sa nourriture de
plus en plus haut là où le climat est plus froid et
plus humide et où les plantes sont plus rares. Or les
gorilles sont très sensibles au froid et à l'humidité,
qui provoquent chez eux de nombreuses maladies, notamment
la pneumonie.
FAIT PAR LOUIS le 18 novembre 2002
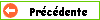 Page 2
Page 2 
|
![]()