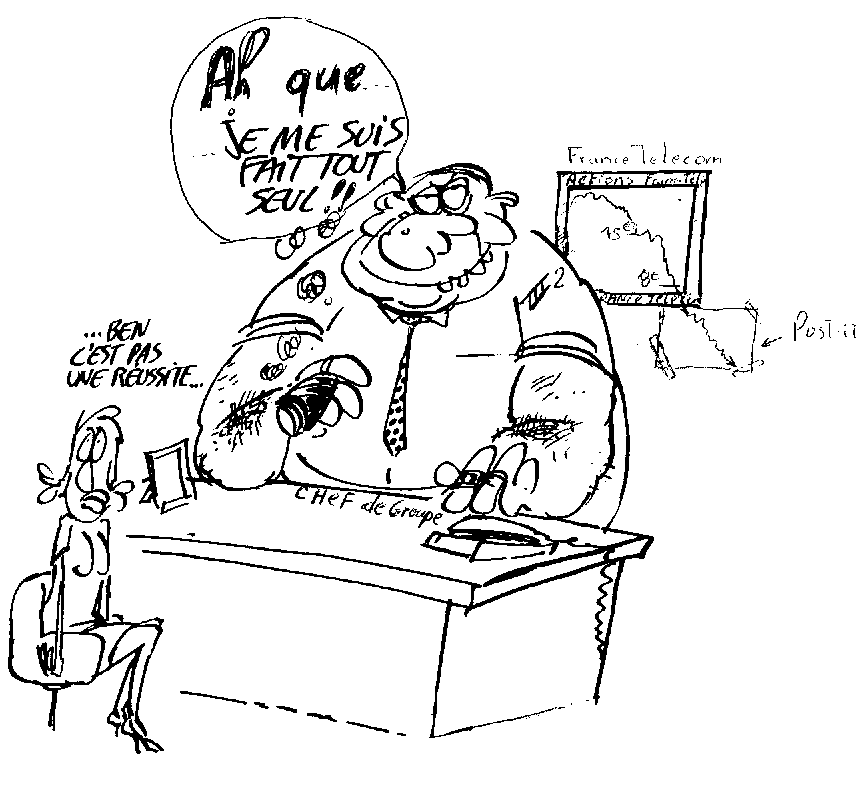Alain Gautheron : C’est une question que nous considérons comme essentielle. Nous lui donnons une bonne place dans l’ouvrage que nous venons de publier.
Aujourd’hui, le monopole de droit se justifie d’abord pour des raisons économiques. Le monopole public garantit ce que les économistes appellent des " économies d’échelle " : on ne finance pas plusieurs fois des réseaux concurrents, ce qui permet de garantir les péréquations tarifaires et la cohérence nationale de l’offre (un même service offert partout). Car une offre unifiée permet de baisser les coûts et d’offrir des tarifs abordables.
Il permet même des " économies dites d’envergure " , c’est-à-dire la possibilité d’offrir une gamme élargie de services, car les services rentables financent les services " moins rentables " .
Le monopole public se justifie ensuite pour des raisons stratégiques, en donnant à chaque nation la maîtrise publique et nationale de ses réseaux de communication. C’est un acteur d’indépendance nationale et même de sécurité pour un peuple.
Enfin, il faut bien réfléchir à l’échelle de la collectivité nationale pour choisir entre disposer de monopoles publics nationaux ou subir la loi de quelques monopoles privés multinationaux. Si la logique déréglementaire se poursuivait à la sauce maastrichienne, il n’y aurait à terme sur la planète entière que quatre ou cinq grands coursiers mondiaux américano-australiens et cinq ou six grands opérateurs de télécoms nord-américains. La domination du globe passerait par ces réseaux privés: les Etats et les gouvernements seraient dominés par ces quelques multinationales.
Le monopole public n’est donc pas " ringard " , comme s’acharnent à le faire croire les " Eurocrates " et le gouvernement, mais il est la condition d’exercice des missions du service public: péréquations tarifaires, aménagement du territoire, maîtrise et cohérence des réseaux. C’est la " concurrence " qui est aussi vieille que le capitalisme. La " concurrence " libère les forts, le monopole public protège les faibles. Pour que la société d’information bénéficie à tous les usagers, il faut un monopole de droit renforcé.
Pendant ce temps les salariés sont éjectés, mutés, pressés, stressés, redéployés, restructurés, éliminés, par contre, les Kapos et les "chéfaillons" se reproduisent comme des lapins :