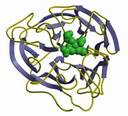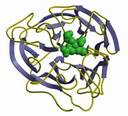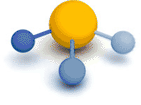|
La grippe - première partie
La grippe est le nom donné à un syndrome ou à une collection de signes cliniques et de symptômes, parfois appelés « maladies grippales ». Depuis 1930, nous savons qu’une de ces maladies grippales, aussi appelée influenza, est causée par certains virus particuliers (virus influenza). Il existe d’autres virus qui causent également des maladies grippales et il est parfois difficile de les distinguer sans procéder à des tests de laboratoire qui peuvent être sophistiqués et coûteux. La grippe causée par le virus influenza est une maladie des voies respiratoires supérieures et inférieures, d’autres organes étant parfois également atteints.
Contenu :
Le syndrome de la grippe et son rapport avec l’influenza
Les voies respiratoires
Infections respiratoires
Trop de protections?
Le syndrôme de la grippe et son rapport avec l’influenza
La plupart des gens sont familiers avec les symptômes de la grippe. Une fièvre soudaine, des frissons, des maux de tête, un état fébrile, des malaises, des douleurs et une perte d’appétit. La fièvre dure quelques jours chez les adultes, accompagnée par une gorge douloureuse, de la toux, des mouvements d’yeux douloureux, un nez chargé et les ganglions lymphatiques de la nuque gonflés. Lorsque ces symptômes sévères commencent à disparaître, une toux sèche et prolongée peut se maintenir. Cela se termine souvent par une période de faiblesse et de fatigue qui peut durer plusieurs semaines.
Beaucoup d’autres infections se déclenchent comme la grippe et un médecin aura du mal à identifier de quelle maladie grippale il s’agit sans des tests en laboratoire. La raison en est que lors de la phase initiale d’une infection, même avant de reconnaître la nature de l’envahisseur, le corps tire un signal d’alarme général qui à pour résultat la fièvre, des douleurs musculaires et un malaise général (qui sont la conséquence de l’émission de substances appelées cytokines, impliquées dans la première réponse du corps). Les symptômes initiaux semblables à ceux de la grippe se rencontrent dans des infections aussi diverses que l’anthrax, la variole et bien sur l’influenza, mais le terme « maladies grippales » est maintenant bien accepté. La différence due au type exact de microbe entre en que lorsque l’infection se développe.
Nous pouvons maintenant aborder les maladies et les agents infectieux. Ni capacité de causer une maladie (le pouvoir pathogène) ni la sévérité (virulence) de celle-ci ne sont la propriété de cet agent. Le pouvoir pathogène et la virulence sont des propriétés de la relation qui se crée entre cet organisme et l’hôte qu’il infecte. Nous abritons tous une grande variété de micro-organismes, incluant des virus, des bactéries et des parasites. La plupart cohabitent avec nous et nous ne sommes pas conscients de leur présence. Certains sont utiles, comme les bactéries dont le métabolisme nous fourni des nutriments essentiels. Certains sont des parasites, qui peuvent nous ennuyer. Parfois, des micro-organismes inoffensifs peuvent dans de mauvaises conditions et au mauvais moment être la cause de problèmes, comme dans le cas d’une personne infectée par le virus HIV. Une maladie infectieuse (et la virulence avec laquelle elle infecte) n’est donc pas seulement dépendante de l’agent infectieux, mais de la combinaison de cet organisme et de son hôte à un moment et à un endroit particulier.
La maladie est donc la propriété d’une relation entre un hôte et un parasite, et cette relation chez différents hôtes et avec d’autres parasites évoluera d’une autre manière. Après la première rencontre avec le parasite, l’hôte et le parasite réagiront l’un par rapport à l’autre comme dans une danse, différentes relations hôtes/parasites ont leurs caractéristiques particulières que l’on appelle maladie. Les mouvements sont dictés par la biologie du parasite et par les réactions de l’hôte, et notamment son système immunitaire.
Donc lorsque le virus de la grippe se loge dans nos voies respiratoires, il se produit une réponse initiale, l’apparition brusque de la maladie grippale (fièvre, frissons, douleurs, etc.) dont nous prenons conscience environ deux jours (avec une fourchette de 1 à 4 jours) après l’exposition à l’infection. Chez certaines personnes, les voies respiratoires peuvent devenir hyperactives, ce qui conduit à des états paroxystiques de toux et à des difficultés respiratoires. Cet état peut durer des semaines ou des mois, même chez des personnes préalablement en bonne santé. Normalement, la plupart des gens retrouveront une santé normale.
Ces symptômes d’infections respiratoires sont causés par l’inflammation des voies respiratoires hautes et basses. Les inflammations sont des réactions locales des tissus à certaines blessures ou plaies (comme une infection, mais pas uniquement). Une inflammation est également de nature dynamique, c’est un état ou une réponse, pas une condition spécifique. Elle fait partie des réactions de défenses de l’organisme, qui servent à raccourcir le mal et à promouvoir la guérison, bien que dans certains cas, cette inflammation en elle-même puisse devenir dangereuse si la réponse est trop vigoureuse.
Pour avoir une meilleure idée de ce qui se passe, nous allons passer en revue la structure du système respiratoire.
Les voies respiratoires
On peut assimiler le système respiratoire (bouche, nez, gorge, poumons) à un arbre inversé (racines au-dessus et feuilles en dessous). Nous inspirons de l’oxygène par la bouche et le nez et il est dirigé à travers un tuyau (la trachée) qui commence juste sous l’arrière de la gorge, au larynx et qui se ramifie en une série de tubes, les bronches, qui se séparent de chaque côté de la poitrine. A l’extrémité des branches, juste après un réseau de tubes fins, les bronchioles, se trouvent de petits sacs appelés les alvéoles, qui sont en contact intime avec des vaisseaux sanguins très fins, les capillaires, qui permettent à l’oxygène de pénétrer dans le sang, et au gaz carbonique de retourner vers l’extérieur.
Le système respiratoire a donc deux parties fonctionnelles, un système d’alimentation pour amener et extraire les gaz des lieux d’échange et l’endroit où l’échange se produit, les alvéoles (les feuilles de l’arbre). La plupart de nos réflexes respiratoires (tousser, frissonner, produire des glaires) servent à évacuer des substances encombrant les alvéoles. Mais les cellules dans n’importe quelle partie du système, de la partie haute (la bouche, le nez, la gorge) à la partie basse (la trachée, les bronches, les alvéoles) peuvent être infectées par un virus ou un autre agent pathogène (un organisme capable de causer une maladie). Une inflammation d’un tissu spécifique est nommée en ajoutant le suffixe –ite, comme laryngite (inflammation du larynx), bronchite (inflammation des bronches) ou mal de gorge, pharyngite (inflammation du pharynx ou de l’arrière de la gorge). Une caractéristique des infections virales du système respiratoire est la trachéo-bronchite, une inflammation de la partie inférieure du système. Voici une image trouvée sur Patient-UK http ;//www.patient.co.uk /showdoc/21692518/. Les voies respiratoires supérieures sont le nez, la gorge, le larynx et une partie de la trachée, celle se trouvant juste sous le larynx (la limite entre les voies respiratoires hautes et basses varie suivant les cas). Les voies respiratoires inférieures incluent habituellement les bronchioles et les alvéoles, les petites zones d’échange gazeux qui sont comme des feuilles à l’extrémité des tiges que forment les bronchioles.

Infections respiratoires
L’arbre inversé est fait de différentes sortes de cellules et toutes peuvent être infectées par des virus. Les infections causées par les pathogènes primaires des poumons (il n’en existe qu’une demi-douzaine) sont des causes importantes de maladies et de décès, et la cause principale de symptômes sévères résultant en une visite chez un médecin. Bien que les virus ne réagissent pas aux antibiotiques, les infections respiratoires virales sont une des raisons principales de prescriptions (inappropriées) d’antibiotiques aux USA (Mainous, Hueston 1998). La plupart commencent par une infection des voies respiratoires supérieures qui se déclare soudainement et l’amélioration est souvent spontanée (on va mieux sans traitement spécial). Ce qui différencie une infection par le virus de l’influenza de la plupart des autres causes virales (comme un mauvais refroidissement) est la forte fièvre, la sévérité de la maladie et le lent rétablissement.
Les gens victimes d’infections de la grippe souffrent à des degrés divers, mais même les plus atteints se rétablissent généralement. Certaines personnes ne se rendent même pas compte qu’elles ont été infectées et ne présentent que des symptômes mineurs. Mais bien que le pourcentage de gens sérieusement malades ou qui meurent est faible, durant une épidémie l’infection est si largement répandue que même si ce pourcentage de décès est faible, on en dénombre des dizaines de millier pendant une année normale. Pendant une pandémie majeure, on en comptera des centaines de milliers voire des millions aux USA et des dizaines voire des centaines de millions dans le monde. Les souches de grippe qui causent les pandémies tendent à être plus virulentes, provoquant une plus forte mortalité.
Parmi les conséquences les plus sérieuse d’une infection de grippe, on compte la pneumonie virale primaire. Les pneumonies sont des inflammations des tissus des poumons causées par des infections et qui provoquent une accumulation de fluides et de débris de cellules mortes dans les tissus et les espaces vides des voies respiratoires. On les remarque sur des radiographies comme des taches blanchâtres là où l’on devrait voir des tissus pulmonaires clairs. Si elle n’est pas trop sévère ni trop étendue, le patient peut rester ambulatoire et même aller au travail ou à l’école, mais durant une saison de grippe normale, environ 2% des cas de pneumonie sont sérieux, et durant une pandémie, ce chiffre peut atteindre 20%. La pneumonie grippale commence comme une grippe typique, mais après quelques jours, la respiration devient sifflante, le souffle est court et douloureux. Dans certains cas très sévères, le patient peut expectorer du sang ou des glaires sanguinolentes et la mortalité est élevée. Les traitements sont des traitements de soutient, requérant l’utilisation de respirateurs. Comme il n’y a pas beaucoup de respirateurs (sur les 100.000 estimés aux USA, 80.000 sont constamment utilisés), lors d’une pandémie, il faudra procéder à des triages.
Une pneumonie lors d’une infection virale des poumons peut également être causée par des bactéries qui profitent des tissus des poumons abîmés (infection secondaire). Ces infections secondaires surimposées peuvent être traitées avec des antibiotiques si les bactéries y sont sensibles. Les infections secondaires ne sont pas rares, et dans certains cas, peuvent atteindre d’autres organes et amener à des infections à méningocoques, à des syndromes de chocs toxiques (dus à une infection secondaire de staphylocoques). D’autres complications plus rares incluent des insuffisances rénales, la destruction de muscles (rhabdomyolyse), des coagulations suivies d’hémorragies (coagulation intravasculaire disséminée), des encéphalites, des paralysies et des syndromes de Reye (augmentation soudaine de l’accumulation de graisse dans le foie, le cerveau ou d’autres organes qui peut rapidement être fatale et qui affecte principalement les enfants se rétablissant d’une infection virale). Ces complications sont d’ordinaire rares (<1%), mais furent remarquables pendant la pandémie de 1918. Le taux de complication et le fait que d’autres systèmes d’organes soient atteints sont liés à la souche spécifique du virus de la grippe. Les facteurs qui rendent une souche beaucoup plus virulente qu’une autre ne commencent qu’à être compris et dans la majorité des cas ne peuvent pas être prédits. L e virus de la grippe aviaire H5N1 qui est maintenant endémique dans la volaille en Asie semble particulièrement virulent lorsqu’il infecte un humain, mais il est encore à vérifier si une de ses versions transmissible d’humain à humain restera aussi virulente. Le virus montre déjà des signes de modification de ces caractéristiques de virulence vers une forme moins fatale, mais il reste très dangereux.
Trop de protections?
De façon claire, le virus lui-même endommage des cellules du système respiratoire, en en directement tuant certaines et en en forçant d’autres à s’autodétruire (en initiant un programme de suicide cellulaire). Mais il y a de larges évidences que la réponse vigoureuse du système immunitaire destinée à nous protéger peut, de manière paradoxale, conduire à nous rendre plus malade. Lorsque les cellules du système pulmonaire deviennent infectées, elle présente des fragments de protéines virales à leur surfaces. Des cellules du système immunitaire (les cellules T) peuvent reconnaître ces cellules infectées et sont activées pour produire un signal soluble destiné à prévenir d’autres cellules pour qu’elles viennent prendre part à la lutte contre l’infection. Une ou plusieurs de ces substances chimiques solubles (appelées chemokines ou cytokines) peuvent produirent encore plus de dégâts dans les poumons ou dans d’autres organes, de même qu’elles sont responsables de l’apparition des symptômes comme la fièvre, la perte d’appétit, et les douleurs musculaires. Une de ces cytokines en cause est la Tumor Necrosis Factor-α (Xu et al., J Immunol. 2004 Jul 15 ;173(2à :721–5). Certains considèrent qu’une réaction non régulée pourrait la cause de la tempête de cytokine, qui est une production incontrôlée de cytokines qui provoque une réaction disproportionnée ; mais beaucoup de travail reste à faire pour comprendre ce problème complexe. Les recherches actuelles vont dans le sens d’empêcher cette réponse immunopathologique en utilisant des médicaments qui la prévienne.
|