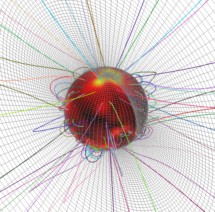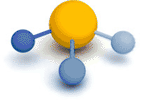|
Vers le milieu du XVIe siècle, vivait dans le voisinage de l'église Saint-Gervais 1 , un chandelier de suif nommé Simon Pajot. Ils appartenait à une famille de la bourgeoisie parisienne et avait et avait dix frères et soeurs 2 . Il était marié avec Jeanne Guerineau. Celle-ci lui a donné quatre fils et deux filles. Cependant son principal mérite, à nos yeux, fut d'avoir été l'aïeul de deux des premiers colons canadien, mais il ne s'en doutait guère lorsqu'il mourut en 1563 3 .
S'il laissait un enfant encore jeune, Jean, âgé de 13 ans environ, il avait, en père de famille avisé, eut le temps de pourvoir les autres de métiers ou d'alliances assurés. L'aîné Guillaume, marié à Marguerite de La Boissière, père de deux filles Jeanne et Marie, était, selon la tradition, chancelier de suif et bourgeois de Paris ; de même que le second Hugues, qu'on appelait Hugues le jeune pour le distingué d'un cousin germain qui avait même prénom et même métier 4 . Marié à Barbe Millardot, il allait avoir sept enfants et nous ne pouvons moins faire que de saluer l'aîné de ceux-ci Guillaume, futur notaire au Châtelet, a qui nous devons plusieurs actes intéressants. Le troisième fils, Isaac, âgé alors de 17 ans, futur chandelier de suif, devait épouser Catherine Gaude et être père de deux filles Catherine et Claude ; celle-ci, par son mariage avec Jean de Biencourt, sieur de Poutricourt, allait faire entrer sa famille dans la noblesse et dans l'histoire.
Quant aux deux filles de Simon Pajot, l'une, Jeanne, avait épousé Mathieu Bedeau qui, lui aussi, était chandelier de suif, et l'autre, Jacqueline, déjà deux fois veuve, était remariée en 1564 à Nicolas Hébert, apothicaire et épicier. Quoique son mari ne travaillât pas dans le suif, elle n'avait pas par ce troisième mariage dérogé à la tradition familiale: son oncle Etienne Pajot était apothicaire et sa tante Jeanne Pajot avait épousé un épicier.
Toute la famille semblait très unie ; à la mort du patriarche, elle se groupa autour de sa veuve Jeanne Guerineau: le partage des biens du défunt se fit sans discussion 5 ; il laissait des rentes et plusieurs maisons: celle de l'image Notre-Dame, rue de Joury ; deux maisons contiguës, l'une rue du Figuier et l'autre au coin de cette rue et de la rue de Joury, en allant vers St-Paul et enfin une maison de campagne entourée de vignes à Saint- Mandé 6 . deux lots furent faits, mais la propriété des maisons resta indivise entre la veuve et les mineurs Dune part et les majeurs d'autre part.
Une cinquième maison n'allait pas tarder à se joindre aux- autres: celle du Dieu d'Amour, sise au Vieux Cimetière Saint-Jean 7 . Jeanne Guerineau et son fils Hugues l'acquirent, le 28 janvier 1568, pour en faire leur demeure, en échange de 500 Livres tournois et d'une rente annuel de 200 Livres que leur avait cédée quelques années auparavant Jean de Peiras, audiencier au Châtelet, et Nicole Tartarin, sa femme.
C'est dans cette maison que, le 3 octobre 1572, Jeanne Guerineau "gisant au lict, malade, toutesfoyes sayne de pensée" fit venir le notaire Puthomme, son voisin, et lui dicta ses dernières volontés 8 . Après avoir choisi d'être enterrée "en l'église Sainct- Gervais, en la chapelle appelée de Carbonne 9 , prez le lieu où le defunct son mary a esté inhumé et enterré.", la testatrice pense à son plus jeune fils Jean, âgé d'environ 23 ans, qui habitait avec elle et qui, lui, exerçait la profession de marchand de bois. Pour éviter toute difficulté dans le partage qu'allait entraîner son décès elle spécifie que "le bois de chesne et de noyer estant en sond. hostel", appartient bien à ce fils.
Elle pense ensuite à ses petits-enfants, tout au moins à certains d'entre eux: c'est ainsi que les enfants d'Isaac, de Jeanne et Jacqueline se partagent la somme de 1200 Livres tournois "pour ayder à les pourveoyer en mariage ou autrement et à ce que lesd. enfants prirent Dieu pour elle." Enfin, elle donnait à son genre Hébert une grande preuve de confiance en le choisissant comme exécuteur testamentaire.
Peu après, l'aïeule mourait et, le 16 octobre, Nicolas Hébert faisait dresser l'inventaire des biens de la défunte 10 .
Quoique Jeanne Guerineau eût à la fin de son testament exhorté ses enfants "â vivre en amytié, sans discussion... ne differentz", il semble bien que dès sa mort les complications virent à surgir.
C'est d'abord Isaac Pajot, majeur depuis un an ou deux 11 , et à qui sa mère n'avait pas rendu compte de tutelle, qui proteste et désire savoir ce qui lui revient de la succession de son père. Trouvant Nicolas Hébert trop peu empressé, il porte l'affaire devant le prévôt de Paris, puis "voyant que led. compte vient à grandz frez, tellement qu'il seroit en danger de n'avoir pas grand reliqua", il se ravise et un arrangement à l'amiable intervient le 23 janvier 1573 12 entre Isaac et ses frères et beaux-frères: examen est fait des inventaires et partage dressés après la mort de Simon Pajot, des rapports de mariage des quatre aînés, considération est prise des sommes dépensées pour qu'Isaac devînt Me chandelier de suif ; après quoi, de l'avis des notaires et de deux procureurs au Châtelet appelés comme arbitres, une somme de 150 Livres tournois est donnée au requérant et chacun s'en va contant. Pas pour longtemps!
En 1575, d'un commun accord toute la famille se tourne contre Nicolas Hébert et Jacqueline Pajot, les accusant, par devant le prévôt de Paris, de leur devoir diverses sommes et objets: 289 Livres pour une rente qu'ils avaient acquise en commun avec la deffunte Guerineau et que celle-ci aurait rachetée, un millier de perches et 140 mesure de suif de boeuf et de mouton ; 450 Livres pour rapport de mariage et enfin des meubles se trouvant en la maison de campagne de Saint-Mandé. Comme pour le premier différend, afin d'éviter les frais d'un procès, l'affaire se règle à l'amiable: Nicolas Hébert prouva qu'il n'était intervenu dans l'achat de la rente que pour faire plaisir à sa belle-mère: qu'il avait fourni le suif à Hugues et Issac, qui l'avaient "en leurs boutiques mis et converty en chandelle" ; que les 450 L. dont il était question dans son rapport de mariage appartenaient à Jacqueline Pajot, du fait de ses deux premiers maris 13 ; quant aux meubles de Saint-Mandé, ils étaient échus par partage aux Hébert avec la maison qui les contenait. A la fin, on se rend aux raisons fournies par ceux-ci et pour terminer une fois pour toutes cette question de succession fils et filles mariés mettent en commun les sommes, d'importance diverse, données par leur parents au jour de leur mariage et cette somme est partagé entre les parties.
Toutes questions litigieuses réglées, il semble bien que les enfants se soient décidés à respecter les volontés maternelles et le nom de Pajot ne revient dès lors dans les minutes que pour des raisons pacifiques.
Comme nous l'avons vu, la maison de Saint-Mandé, avec les vignes, était échu en partage à Jacqueline Pajot et à son mari. La demeure familiale du Vieux-Cimetière Saint-Jean était dans la part d'Hugues le jeune, à qui elle appartenait déjà particulièrement, et c'est autour de cette maison du Dieu d'Amour que la nouvelle génération continua de se grouper. C'est là que séjournaient Claude Pajot et son mari Jean de Biencourt lors de leurs passages à Paris. C'est à deux pas de là, à la Porte Baudoyer que Guillaume, fils aîné d'Hugues, installe en 1592, son étude de notaire au Châtelet.
Par ses fonctions, Guillaume nous apparaît, à la fin du siècle, comme le pôle autour duquel gravite la famille. A toutes occasions, oncles et cousins s'adressent à lui ; de tous les points de Paris, dans lequel les enfants, puis les petits-enfants de Simon Pajot se sont dispersés, de la rue Saint-Honoré, de la rue des Vieux Augustins ou même de Picardie, où les Biencourt résident ordinairement 14 , tous viennent le voir à propos d'une vente, d'un bail ou d'un mariage.
|
Notes: -
1- Les actes qui ont servi à rédiger cet section sont les minutes des notaires parisiens de la fin du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle. Elles sont conservées actuellement au Minutier Central des Archives Nationales à Paris.
-
2- Il n'a pas été possible de déterminer où habitait exactement Simon Pajot. Aucun acte passé par lui n'a été retrouvé et d'ailleurs les notaires de cette époque n'indiquaient que rarement l'adresse des parties. Néanmoins, il était paroissien de St-Gervais et il semble bien qu'il habitait dans le voisinage de la porte Baudoyer.
-
3- Son inventaire après décès, dressé par les notaires Martin Tamart et Pierre Thuret, le 9 novembre 1563, n'est malheureusement pas conservé.
-
4- On le nommait Hugues l'aîné. Il était le fils de Guillaume Pajot, qui avait épousé en premières noces, ainsi que son frère, une demoiselle Guérineau qui se prénommait également Jeanne et qui mourut en 1557. Arch. Nat., Min. Centr., IX, 140: 1559, 9 mai.
-
5- C'est dans l'inventaire des papiers de Jeanne Guérineau que se trouve mentionné ce partage, fait en 1564 par Claude Le Clerc, commissaire au Châtelet. Arch. Nat., Min. Centr., IX, 214: 1572, 15 octobre.
-
6- Saint-Maudé, Seine, arrt de Sceaux, cant. de Vincennes.
-
7- Cette place avait été occupée par un cimetière jusqu'au XIIIe siècle et ensuite convertie en marché. Actuellement c'est la partie sud de la rue du Bourg-Tibourg.
-
8- Arch. Nat., Min. Centr., IX, 205.
-
9- Il s'agit de la chapelle de Carmone, fondée en 1500 par Christiphe de Carmone, premier marguillier de Saint-Gervais, ancien président du Parlement de Paris. Depuis 1740, cette chapelle fait partie de la sacristie. Abbé Brochard, Saint-Gervais, Paris, 1938, p. 113 et sq.
-
10- Arch. Nat., Min. Centr., IX, 214.
-
11- La majorité était à 25 ans, et Isaac Pajot, en 1572, prétend avoir "26 ans et plus".
-
12- Arch. Nat., Min. Centr., IX, 20.
-
13- Le premier n'est pas nommé, le second est Louis de Cueilly.
-
14- Ils habitaient ordinairement à Guibermesnil
|