
Point Com
| Abonnez-vous gratuitement à Point Com ! |
 |
||
Point Com |
|
|
| DOSSIER : la traduction littéraire - 2ème partie
(Novembre 2000)
|
||
| Première page Dossiers Archives Revue de presse Agenda Infos sur Point Com
|
| Entretien
avec Florence Herbulot (membre AAE-ESIT, T60) D'après des propos recueillis par Isabelle Croix et Marine de Kerros. Comment avez-vous commencé dans la traduction littéraire, car il n'y a pas vraiment de formation au métier de traducteur littéraire à l’ESIT ? Non. Il y en aura peut-être une un jour, car nous avons obtenu une habilitation de l'université, mais comme le contrat quadriennal 1996-2000 n'avait pas prévu de fonds, de crédits et d'heures complémentaires, il aurait fallu supprimer d'autres éléments pour mettre en place cette formation. Nous avons réitéré la demande pour le contrat 2001-2005 afin d'obtenir les fonds nécessaires. De toute façon, nous n'avons jamais fait de formation jusqu'ici à l'école, car le principe que nous appliquions, c'était la formation professionnelle du traducteur. Si en plus il a un peu de plume, il peut devenir traducteur pour l'édition parce que c'est un talent en plus d'une capacité. Nous enseignons une compétence, mais si cette compétence est complétée par un désir et par un peu de talent, des perspectives s'ouvrent à ce moment-là. Ce que nous cherchons avec la formation que nous souhaitons mettre en place, c'est à renforcer cette partie compétence particulière, capacité, talent. Le talent, ça ne s'acquiert pas, mais ça se forme, ça s'entraîne, ça se travaille. Le problème, c'est que le métier de traducteur littéraire n'est pas rémunérateur, on vit difficilement en tant que traducteur littéraire uniquement, à moins de travailler extrêmement vite, ce qui nuit forcément à la qualité. La rémunération unitaire est faible. Par rapport à la traduction dans les domaines financier ou juridique, c'est au mieux la moitié à la page et en général, il faut deux fois plus de temps pour faire une page, donc grosso modo c'est un quart. Autre problème : entrer dans le domaine de la traduction littéraire n'est pas commode, parce que c'est un métier où l'on rentre par relations ou par hasard, parce que l'on connaît quelqu'un ou parce que l'on était justement là ce jour-là, mais les éditeurs cherchent rarement en dehors du cercle des gens qu'ils connaissent, c'est de proche en proche, par le bouche à oreille. Ça se fait comme ça, et je ne fais pas exception à la règle. Quand j'ai commencé mon premier livre, j'étais encore à l'école. L'éditeur, une connaissance, me l'a donné non pas parce qu'il avait confiance dans mes capacités de traductrice qui, à l'époque, n'étaient pas encore prouvées, mais parce que c'était un livre de bateaux et qu'il pensait que mon père ne me laisserait pas écrire de bêtises1. Quels étaient vos interlocuteurs ? Est-ce que les auteurs vous contactaient directement ? Chez les éditeurs, ce sont les responsables du service Etranger qui me contactaient. J’ai traduit pour Artaud, Denoël, Messine, Gallimard, Larousse... Au début, pour certains, j’étais contactée par les auteurs. Par exemple, l’un de mes premiers auteurs était un ami danois qui faisait du bateau. Il savait que je faisais de la traduction et lorsqu’il a trouvé un éditeur en France, il a exigé que ce soit moi qui traduise son livre. Personnellement, je n’ai jamais envoyé de CV. Il y a des gens qui rentrent dans le domaine de la traduction littéraire en envoyant des candidatures spontanées aux éditeurs. C’est une autre approche, mais elle est beaucoup moins facile et moins courante, car c’est un milieu fermé. Moi, je suis rentrée dans ce milieu-là par ma passion, par hasard et par relations. Mon nom a été associé au mot bateau, j'ai commencé à être connue des éditeurs de livres touchant aux bateaux. Sur les 125 livres que j'ai traduits, il y a entre 65 et 70 histoires de bateaux. Et puis d'autres sujets, mais c'était essentiellement des livres techniques, comme des ouvrages sur les plastiques. A mes débuts, je travaillais dans le domaine de l'édition, mais ce n'était pas encore littéraire. Je suis rentrée dans le littéraire aussi par le domaine de la voile… Non, j'avais dû commencer un petit peu avant, par une personne que je connaissais qui traduisait un ouvrage de Virginia Woolf et qui m'a demandé de collaborer avec elle parce qu'elle ne s'en sortait pas. Elle, elle était plus littéraire que moi mais elle n'était pas traductrice, donc on l'a fait à deux. Et là, pour le littéraire, nous étions servies, Virginia Woolf, c'est vraiment de la littérature ! Même dans des essais qui étaient des critiques littéraires, c'était de l'écriture. Après ça, j'ai également traduit un roman de Conrad, pour la Pléiade, et là, il y avait une combinaison du domaine marin et du roman. Combien d'années d'expérience aviez-vous lorsque vous avez commencé à traduire des romans ? Ma traduction la plus littéraire remonte à 1967, donc pas mal de temps après avoir débuté dans la traduction. Il s'agissait d'un ouvrage sur les bateaux : Défi aux trois caps, un livre servant à financer le voyage de l’auteur. Il s'agissait d'un recueil de textes littéraires sur des gens ayant fait un voyage autour du monde, il y avait un passage d'un texte médiéval, des écrits du XVIIe, des textes de langues très différentes… En 1976, il y a eu Virginia Woolf, en 1988, c'est un roman historique et maritime (Cap sur la gloire), et en 1989, l'ouvrage de Conrad. Par ailleurs, je traduis depuis 1997 une série de romans historiques, écrits par Patrick O’Brian, à raison de trois par an environ. Je fignole actuellement le treizième, sur un total de vingt. Maintenant, ils sont passés au rythme de deux par ans, ce qui ne fait plus que 1000 pages au lieu de 1500 pages par an. Faire 1500 pages de traduction littéraire par an, c'est un travail à temps complet. Pour un traducteur, 1500 pages par an, c'est déjà beaucoup, parce qu'il y a de la recherche. J'ai la chance d'avoir de l'expérience et c'est un domaine dans lequel j'ai beaucoup de documentation, ça aide, mais ça représente tout de même beaucoup de travail. On suppose que pour traduire un auteur, il faut être sensible à son style, apprécier son environnement ? Absolument. Il n’y a qu’un seul bouquin que je n’ai pas aimé traduire, Moonfleet. C’était une histoire de contrebandiers anglais. Je n’ai pas aimé ce livre, et je n’ai pas été très heureuse de le traduire. C’est rare, mais celui-là, je n’ai pas aimé. Alors que j’adore les livres d’O’Brian : la langue est merveilleuse, il me pose des problèmes tout le temps, il introduit des jeux de mots, je me casse la tête pour essayer de trouver des équivalences. J’ai eu la chance de pouvoir rencontrer l’auteur et de lui écrire plusieurs fois pour lui poser des questions. C’était quelqu’un de très cultivé, il semait un très grand nombre de références et d’allusions dans ses livres, et j’étais souvent perdue, surtout au début. Il est également venu à Paris et je l’ai rencontré à cette occasion. Malheureusement, il s’est éteint en janvier dernier, après avoir sorti son vingtième tome. C’est très efficace, très profitable de pouvoir entrer en contact avec l’auteur, parce que souvent, on se retrouve devant une combinaison de références au deuxième ou au troisième degré qui vous échappent. On doit boucher des trous, et on peut vérifier auprès de l’auteur. Maintenant qu’il n’est plus là, je dois me débrouiller, mais j’ai progressé, je connais mieux son univers... Moi aussi j’ai dû apprendre à être traductrice littéraire. Au début, j’étais trop traductrice technique sur ces ouvrages, c’est très technique. J’avais en particulier ce réflexe, que l’on essaye d’inculquer, selon lequel quand un mot ressemble trop à l’anglais, on ne doit pas le prendre, car ce n’est pas le bon, le sens n’est plus le même, il faut trouver autre chose. En fait, je me suis aperçue assez vite que comme l’auteur écrit dans une langue non pas démodée, mais pas tellement déplacée à l’époque, il n’emploie pas les mots dans leurs acceptions modernes. Il emploie les mots anglais dans leur acception de l’époque, qui à ce moment-là est proche de celle du français. Je suis tombée plusieurs fois sur des mots dont je décalais le sens en gardant mon vieux réflexe. Je me décalais. J’ai investi dans un Oxford et j’utilise le Robert qui, heureusement, date les mots. Donc je cherche avec l’âge des mots, je donne en français des mots d’époque, j’évite tout mot trop moderne qui n’irait pas dans le contexte, afin d’éviter tout anachronisme. Un auteur construit un univers, une atmosphère, des personnages, il fait évoluer ces personnages, il établit des liens avec ses lecteurs, tous ses lecteurs potentiels. On aime un livre parce qu’on rentre dedans, parce qu’il vous correspond, qu’il s’agisse du texte original ou de la traduction. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais les gens pour lesquels on traduit, qui correspondent au lectorat du livre que l’on traduit, attendent quelque chose auquel ils puissent s’identifier. Quand on traduit, il faut respecter l’atmosphère d’un roman, pour que le lectorat s’y reconnaisse, qu’il puisse s’identifier. Le problème dans les ouvrages comme ceux-là [O’Brian], qui ont une charge technique énorme, c’est qu’il faut d’abord qu’ils soient lisibles par le technicien, car les premiers acheteurs d’un roman maritime, ce sont les gens qui aiment la voile, le bateau, et qui ont déjà entendu parler d’une misaine, d’un artimon. On n’a pas le droit de se tromper, de faire des erreurs techniques. En même temps, il ne faut pas rebuter les autres. D’ailleurs, l’auteur aide de temps en temps le lectorat, il donne des explications, même si le public anglais moyen est plus maritime que le public français, et qu’il a moins d’effort à faire. Etes-vous parfois tentée de " corriger " la source ? En traduction technique, plus qu’en traduction littéraire... En traduction technique, on est souvent amené à le faire, on est plus rigoureux. En traduction littéraire, on a plus de respect pour l’écriture, car on pense que l’auteur qui s’est donné la peine d’écrire quelque chose l’a fait avec un objectif, des idées au départ, et on cherche à rentrer dans son jeu, dans sa peau, c’est un exercice d’assimilation, d’intégration. Dans une traduction technique, on a moins cette contrainte de forme, et bien souvent, on n’a pas autant de respect pour ce qui est écrit, parce que l’on s’aperçoit qu’il y a des erreurs, et on est amené à corriger, à redresser. Je traduis actuellement un ouvrage truffé d’erreurs de dates, de noms propres, de toponymes, les légendes ne correspondent pas au texte. Je passe mon temps à tout vérifier. Je ne peux pas laisser passer d’erreurs dans le texte en français, car si je le fais, on ne dira pas que cela vient du texte source, on dira " Le traducteur n’a pas fait son boulot ". C’est inévitable. Je passe beaucoup de temps à rechercher dans d’autres livres, à appeler des collègues, à vérifier l’orthographe… Avez-vous plus de plaisir à traduire des ouvrages littéraires ou des textes techniques ? De toute façon, moi, j'aime traduire. Bien sûr, j'aime mieux traduire des choses intéressantes. Cet ouvrage sur lequel je travaille en ce moment m'intéresse, mais je n'ai pas grand plaisir à le traduire, car tout ce que je dois faire comme vérifications à côté est vraiment ennuyeux. C'est moins gratifiant. Aujourd'hui, j'ai relu et corrigé les deux premiers chapitres du prochain O'Brian, j'apporte de petites modifications, je m'efforce plus à améliorer la qualité de la langue, à travailler les nuances, à éviter une répétition… C'est du fignolage, c'est très plaisant à faire ! Justement, cela donne l'impression que le résultat est plus achevé. Mais il faut s'arrêter à un moment. Autres points caractéristiques de la traduction littéraire : c'est un travail long et mal rémunéré. Tout le monde s'imagine que n'importe qui peut le faire, donc on essaye de prendre ce qu'il y a de moins cher. On vous dira : " Vous ne voulez pas à ce prix-là ? J'ai autant de traducteurs que je veux qui pourront le faire à ce prix ". Et malheureusement, c'est vrai, il y a des tas de gens qui font n'importe quoi pour n'importe qui. Mais les résultats ne sont pas fameux, et c'est pourquoi de nombreuses traductions assez mauvaises sortent sur le marché. Le gros inconvénient, c'est que très souvent les éditeurs ne relisent pas. Cela arrive fréquemment. Cela dépend des éditeurs avec lesquels on travaille. Il est difficile de se distinguer, de se faire respecter en tant que spécialiste. C'est pourquoi il est intéressant d'avoir une spécialité, un domaine où l'on peut apporter une sécurité. Mais c'est aussi valable pour la traduction technique. Finalement, il n'y a pas beaucoup de différences entre les deux, c'est le même métier, avec une exigence de forme en plus. Si jamais cette formation se faisait à l'ESIT, quel conseil pourriez-vous donner aux étudiants ? Je pense que ce serait de mieux travailler le rendu, la forme, la qualité de la langue, et surtout, cette capacité d'assimilation, d'intégration, de savoir rentrer dans un texte. On ne peut pas rester à l'extérieur d'un ouvrage littéraire. On peut rester à l'extérieur d'un texte technique, le traduire sans s'impliquer, alors que c'est impossible pour une traduction littéraire. Si l'on ne s'implique pas, c'est que l'on n'aime pas et alors ça ne marche pas. De jeunes diplômés peuvent-ils s'orienter directement vers la traduction littéraire ? Serait-ce risqué ? Ce n'est pas une discipline dans laquelle on peut rentrer sans expérience. Cela exige du métier, la maîtrise des techniques de traduction. On ne peut pas être traducteur littéraire sans être d'abord traducteur. Les gens qui en font sans être avant tout traducteur n'obtiennent pas de bons résultats au début. Si vous saviez le mal que l'on a à trouver des traducteurs pour le Prix Pierre-François Caillé de la traduction, de la SFT ! Ce prix est destiné à couronner un traducteur jeune ou n'ayant pas atteint la notoriété, c'est-à-dire en début de carrière. Il faut des gens ayant déjà quelques livres derrière eux. Et on sent bien qu'avec un peu plus de métier, certains n'auraient pas fait d'erreurs. C'est une voie, certes, mais c'est très difficilement une voie de début, à moins d'être extrêmement doué pour l'écriture au départ, et doué pour la traduction. Mais en même temps, ce doit être un peu frustrant ! Si justement en tant que traducteur littéraire, on a l'amour de l'écriture, on est toujours contraint par l'écriture de l'auteur... C'est vrai qu'il y a un rôle de second. Mais cela n'empêche pas d'écrire par ailleurs. C'est peut-être frustrant pour certains, mais cela ne m'a jamais gênée. Vous savez, il y a de nombreux écrivains qui font de la traduction en plus ou en attendant. Cela ne m'a jamais semblé une impossibilité, cela ne m'a pas empêchée de faire du journalisme, d'écrire. J'ai toujours aimé écrire, j'avais une plume facile. Avant d'entrer à l'Ecole, j'ai cherché à savoir ce que j'aimerais faire sept jours sur sept, et je me suis dit que ce qui me tentait le plus, c'était la " bagarre avec les mots " ! Les mots sont un matériau amusant, très souple, on peut faire beaucoup de choses avec, c'est passionnant ! C'est pourquoi j'ai fait l'ESIT… Votre traduction apporte un plus. Mais il y a un côté service, finalement, car grâce à votre traduction, vous apportez quelque chose à quelqu'un. L'œuvre de départ a été créée par quelqu'un qui y a mis une certaine sensibilité. Inévitablement, en traduisant, vous y mettez aussi votre sensibilité... Vous changez forcément des choses, c'est obligatoire. J'ai une lettre écrite par O'Brian, dans laquelle il me disait " Je trouve que vos dialogues entre hommes et femmes sont encore meilleurs que les miens ". Il se trouve qu'il avait été traducteur, il lisait bien le français et avait lui-même traduit du français en anglais. C'est merveilleux quand un auteur vous dit ça. Il trouvait que ma traduction collait, qu'il n'y avait pas d'appauvrissement au passage. C'est important, c'est même idéal quand il y a une correspondance avec l'auteur. Parmi les traducteurs " heureux ", il y en a justement beaucoup qui travaillent exclusivement avec un même auteur, et qui ont établi un rapport particulier avec lui. Sous quelle forme la formation au métier de traducteur littéraire serait-elle dispensée ? Sous la forme d’une option ? Non, il s'agirait d'un DESS, accessible à partir d'une maîtrise. Il y aurait peut-être quelques cours magistraux, en commun avec les élèves de première ou deuxième année. Il y aurait 5 ou 6 séminaires dans la semaine, avec des éléments propres à la traduction littéraire, comme la façon de résoudre des problèmes culturels, de traduire de l'humour, des approximations… Cette initiative répond à des demandes et à des aspirations d'un certain nombre de gens. La traduction littéraire intéresse parce qu’elle fait rêver. Mais finalement, si l'on gratte un peu, on se rend compte que tout est traduction technique, car dans les livres, il y a des voitures, des maladies, de l'architecture, de l'histoire, de la zoologie… Il n'y a pas un livre qui ne comporte de références techniques fréquentes. Donc tous les réflexes acquis à l’ESIT serviront de toute façon ? Ils sont indispensables, oui, vraiment indispensables. Toutefois, notre formation peut apporter des éléments en plus. 1 Jean-Jacques Herbulot était un architecte naval de renom, créateur de célèbres bateaux, parmi lesquels le Vaurien, la Caravelle et le Corsaire. © Copyright 2000 - Association des Anciens Elèves de l'Ecole Supérieure d'Interprètes et de Traducteurs de l'Université de Paris - Tous droits réservés. |
Entretien avec
Florence Herbulot Traducteur littéraire : témoignage de Cécile Nelson Traducteur littéraire en France Traducteur littéraire, traducteur d'édition La promotion de la traduction littéraire La traduction littéraire en questions L'expérience d'une traductrice de polars Les modestes aventures du traducteur qui propose son manuscrit
|
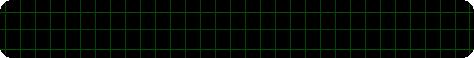 |