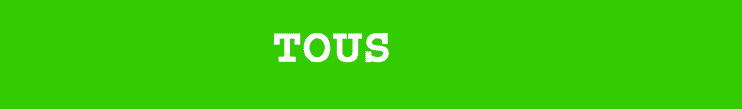
Présentation
Loi Veil, loi du 17 janvier 1975, défendue par Simone Veil, ministre de la Santé, qui a dépénalisé l’interruption volontaire de grossesse (IVG).
Un contexte favorable à la dépénalisation de l'avortement
Jusqu’en 1975, en vertu de la loi de 1920, l’avortement est considéré comme un délit correctionnel. Il est donc pratiqué clandestinement, par recours à des méthodes empiriques, lourdes de risques d’hémorragies ou d’infections. La pression de la rue et la pratique illégale — mais largement répandue — de l’avortement incitent le gouvernement Chirac à le dépénaliser pour le médicaliser sous le nom d’interruption volontaire de grossesse (IVG)
La loi que Simone Veil défend à partir du 26 novembre 1974 devant l’Assemblée nationale s’inscrit dans le sillage de la libéralisation de la contraception (loi Neuwirth de 1967). Un contexte favorable permet son adoption : évolution des mentalités, coups médiatiques, tel le Manifeste des 343 (1971), signé par des femmes, célèbres ou non, qui déclarent « Je me suis fait avorter » et pression certaine de l’opinion publique orchestrée par le Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception (MLAC), en faveur du droit des femmes à la libre disposition de leur corps et à une maîtrise totale de leur fécondité.
Les dispositions de la loi Veil
Votée pour cinq ans à titre expérimental, par 284 voix pour et 189 voix contre, la loi sur l’interruption volontaire de grossesse est adoptée définitivement le 31 décembre 1979. Toute femme « en situation de détresse » peut, dès lors, solliciter auprès d’un médecin, et dans un établissement agréé, une intervention avant la fin de la 10e semaine de sa grossesse — intervention aujourd’hui chirurgicale ou médicamenteuse.
La procédure se déroule en trois étapes : après avoir déposé sa demande auprès du médecin, la femme dispose d’un délai de réflexion de huit jours, au terme duquel sa demande devra être déposée par écrit. Entre-temps, elle doit avoir un entretien d’information avec un membre d’un centre de planning familial ou des services sociaux.
La loi Veil marque un progrès, mais elle demeure restrictive : les mineures et les femmes étrangères font l’objet de mesures spécifiques. En effet, pour recourir à l’interruption volontaire de grossesse, les mineures doivent présenter une autorisation parentale écrite. Quant aux femmes étrangères, elles doivent justifier d’au moins trois mois de séjour régulier en France au jour de l’intervention. Enfin, il faut attendre 1983 pour que l’IVG soit remboursée, partiellement seulement, par la Sécurité sociale. Une femme en situation financière difficile doit donc solliciter l’admission à l’aide médicale auprès d’un service d’aide sociale de la Direction départementale de l’action sanitaire et sociale. Du côté des médecins, la loi prévoit la possibilité pour les praticiens de refuser de procéder à des IVG, en invoquant la « clause de conscience ».
La pratique de l’interruption volontaire de grossesse a néanmoins soulevé un vif débat éthique et politique. La plus célèbre des apostrophes des opposants est due à Jacques Médecin, accusant Simone Veil, lors des débats de 1974, d’ouvrir« la porte au commerce de la mort ». Par la suite et régulièrement, les opposants à la loi Veil n’ont pas hésité à manifester leur hostilité, au sein même des hôpitaux, par des opérations spectaculaires d’occupation, passibles de lourdes amendes, voire de peines de prison depuis la loi Neiertz (1993) . Il n’en reste pas moins que la loi Veil rencontre parfois des difficultés dans son application aujourd’hui. Elle semble être principalement menacée par la non-relève médicale. En effet, l’IVG n’est pas un acte médical gratifiant pour les jeunes médecins qui, s’ils ne le pratiquent pas par militantisme, risquent de cesser de le faire.
Dial-web Conception. Tous droits réservés.