
Hébergé gratuitement par: GeoCities.
Obtenez votre propre page GRATUITE

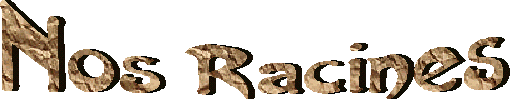
Jean-Marc Nicol [8]
Les Ancêtres de Wilfrid Nicol
Nicolas Nicole, est arrivé de Coutance en Normandie avec un titre de noblesse hérité de son père. En janvier 1629, Louis XIII anoblit Charles Nicole pour les services exceptionnels qu'il a rendu à la France. Ce héros du royaume n'était cependant pas un général ayant mené les troupes à la victoire. Il était receveur de taille, c'est à dire, responsable régional du prélèvement des impôts. Je ne sais pas si il faut en être fier, mais il faut croire qu'il était exceptionnel dans son domaine et que le roi l'appréciat beaucoup. En 1673, le roi Louis comfirme l'anoblissement pour Charles et ses enfants. Ici, Nicolas sera le Sieur Nicolas Nicol ainsi que son fils le Sieur Jacques Nicole capitaine de milice. Les générations suivantes feront sauter le Sieur et le "e" de la fin, ne sachant pas du reste écrire leur propre nom.
Sieur Jacques Nicole[2], bourgeois, maître de chaloupe et capitaine de milice, est né à Montmagny vers 1730. Il se marie en première noce avec Thérèse Couillard-Dupuis la fille du seigneur de Montmagny (il participe d'ailleurs à l'administration de la seigneurie comme co-seigneur). Il épouse en seconde noce, Marie Deboutillé. Il épousera finalement notre ancêtre, Élisabeth Thibault née à Saint-Thomas le 8 avril 1751, le 29 janvier 1770 à Saint-Thomas de Montmagny. Jacques est mort dans sa paroisse le 23 juin 1807.
Première et dernière chronique de mode féminine
Les femmes de cette époque étaient elles aussi coquettes et les habitants des seigneuries avaient en général les moyens de suivre la mode (agriculture excédentaire et droit de chasse, entre autre la tourte qu’ils capturaient par centaines, l'oie blanche et le marsouin). L'Église par contre n'approuvait pas. Je cite ici Mgr Laval dans une lettre à l'intention de ses curés. "...paraissant dans les lieux consacrés à la prière avec des habits indécents, faisant voir des nudités scandaleuses de bras, d'épaules et de poitrines, se contentant de les couvrir de toile transparente, qui ne sert bien souvent qu'à donner plus de lustre à ces nudités honteuses, la tête découverte ou qui n'est couverte que de toile transparente, et les cheveux frisés...", ou Mgr Saint-Vallier qui ordonne à ses curés de refuser l'absolution aux femmes et filles "qui portent le sein découvert". Curieusement c'est à celle-ci qu'on demande de faire la quête à la messe.
Le 18 janvier 1770, Élisabeth Thibault fait faire un inventaire notarié de ses biens, avant son mariage avec le sieur Nicole.
La valeur de ses biens se monte à 204 livres et 9 sols.
| -deux paires de
souliers français (ces souliers acheté à Québec
étaient importés, rares et chers, aussi les filles qui en
portaient coupaient, au grand malheur de Mgr Laval, leurs jupons et leurs
jupes à la mi jambe)
-un coffre fermant à clé -une paire de boucles et trois paires de menottes (bracelets) -une cape en camelot (étoffe de laine mêlé de poils de chèvre, le seul vêtement d'hiver puisque les femmes ne sortaient pratiquement jamais dehors durant cette saison) -quatre jupons; un en calmande, un fleurie, un vert et un de petit coton. (le coton est un tissus rare provenant des colonies anglaises et elles mettaient entre 2 et 6 jupons superposés selon la saison) -deux mantelets dont un en coton (corsage à encolure très dégagée portée sur la chemise et le corset) -une jupe en étoffe du pays -une jupe de petit voques (?) -six chemises en toile du pays (ce vêtement ample, au col dégagé et aux manches plissées jusqu'aux coudes, se portait directement sur le corps, sans sous-vêtement) -six coiffures garnies de dentelle -une coiffure garnie de mousseline -un mouchoir de toile fine et un de mousseline (on ne se mouche sûrement pas la dedans) -quatre paires de chaufferette (je pense qu'il s'agit de long bas de laine montant jusqu'à la mi-cuisse) -trois paires de manchettes (couvre les manches de chemise) -un collier de dentelle de soie |
6 livres
et 12 sols
8 livres 3 livres 12 livres
43 livres
10 livres 3 livres et 10 sols 5 livres
12 livres 15 livres 1 livre et 10 sols 5 livres et 4 sols
10 livres et 10 sols 4 livres et 5 sols 1 livre et 10 sols |
Notre demoiselle de 19 ans, épousant un bourgeois dans la quarantaine (un très bon parti) ne possédait pas de tabliers nécessaires à la cuisine et aux travaux domestiques, ni vêtements et souliers de boeuf pouvant convenir à une paysanne. C'était probablement la belle demoiselle du coin et notre veuf à succombé à ses charmes, faisant d'elle la mère d'une descendance exceptionnelle, nous autres.
Il n’y a pas que des listes de biens aux archives nationales, on y trouve entre autre des récits de guerre et des minutes de procès. J’ai lu le récit du siège de la ville de Québec en 1759 sans trouver de noms qui nous soient familiés. Lors de la révolte de 1837 j’ai trouvé un acte de dénonciation d’un de mes ancêtres du côté maternel, Cyprien Côté de l’Avenir, par le notaire David de Drummondville. Cyprien avait signé le serment secret des Frères Chasseurs, ce qui l’engageait dans l’organisation de la rébellion (Rapport de l’archiviste de 1925-26). J’ai trouvé aussi le nom de Jacques Nicole (pas celui de Val-Bélair, celui de Montmagny) dans un grand procès qui faisait le point sur l’aide apportée aux américains lors de l’invasion de 1775 (Rapport de l’archiviste de 1927-28). Les rebelles américains avaient envahi une partie du Québec en se faisant aider des populations. Les envahisseurs ont ensuite nommé des officiers parmi leurs sympathisants pour remplacer ceux qui étaient restés fidèles au Roi d’Angleterre. À Saint-Thomas (Montmagny), les hommes ayant participés à la rébellion (la majorité des paroissiens) ont été déclarés indignes d’occuper un emploi pour le gouvernement et le peu de sujets restés fidèles au roi furent rétablis dans leurs fonctions. Les faits reprochés aux méchants rebelles étaient l’aide aux Américains, la fourniture de nourriture à ceux-ci, la propagande, le vol de trois barriques de vin de Bordeaux chez le curé et la participation à l’échauffourée armée chez Michel Blay et à la Pointe-de-Lévy. Je vous donne un extrait d’archive :
Cy après vous avez les noms de ceux de cette paroisse qui étaient pour le Roy à l’action passée chez M Blay
Desilets Couillard, Jacques Nicole, Augustin Dominique,.....,Janot, Le petit garçon, fils de la femme de Janot, tué lors de la fusillade, Stellson un anglais mort de la picotte.
Heureusement pour nous et pour le Nicolage (car son fils Charles n’était pas encore né), notre Jacques à échappé aux balles des rebelles et à récupéré son poste de capitaine de milice.
Le Manoir Seigneurial Couillard-Dupuis de Montmagny
N.B. Le manoir seigneurial Couillard-Dupuis à Montmagny se visite et abrite un musé de l'accordéon. C'est une maison superbe datant de 1764 dans laquelle nos ancêtres ont marché. Ils habitaient sans doute dans son voisinage sur le bord de la Rivière-du-Sud qui se jette à cet endroit dans le Saint-Laurent.Charles Nicole[3] est né à Montmagny dans la paroisse de Saint-Thomas-de-la-Pointe-à-Caille le 27 novembre 1793. Il se marie à Saint-Hyacinthe le 7 février 1820 avec Éléonore Proux née à Montmagny le 25 janvier 1803. Il demeure à Saint-Hyacinthe au moins jusqu'en 1844.
Maintenant, une hypothèse sans fondement sérieux; en 1812 Charles a 19 ans et la guerre éclate entre l'Angleterre et les États-unis. La Côte-du-Sud fournira un bon nombre de soldats qui iront se battre sur le front qui s'étend du Richelieu au Haut-Canada (Ontario). Le capitaine de milice, qui n'était plus son père, tirait au sort le nom des jeunes qui partaient à la guerre. Beaucoup de jeunes gens partis pour cette guerre ne sont jamais revenus dans leurs régions d'origine. Bien qu'il ait épousé une fille de Montmagny, cela pourrait être une explication possible à l'installation de Charles à Saint-Hyacinthe. Charles ne savait ni lire ni écrire ni signer son nom.
La vie dans les Eastern Townships
Cet épisode d'histoire de famille nous raconte comment s'est peuplée la région des Eastern Townships, région encore vierge à la fin du régime français (1760) et territoire Abénakis. Les terres alors non érigées en seigneuries ont été arpentées et subdivisées en quadrilatères d'une centaine de milles carrés; les cantons. Les premiers colons à s'établir ont été des Américains (du Vermont, du New Hampshire et de l'état de New York) désirant rester fidèles au roi d'Angleterre. En 1812, à cause de la guerre avec les États-unis, le chemin Craig reliant Québec à Hyatt's Mill (Sherbrooke) en passant par Shipton (Richmond), est construit par le 49e régiment. Cette voie permettra un meilleur accès aux cantons, et dès 1835, la British American Land Company distribue des terres et débarque au port Saint-François des colons Anglais, Écossais (vers 1840) et Irlandais (vers 1846). A partir de 1850, les francophones auront le droit de s'établir dans les Townships. L'acte de Québec (suite à la conquête) permettait le libre exercice de la religion catholique, mais sur les terres déjà concédées et interdisait l'établissement ailleurs sous peine de confiscation des biens. En 1870 ils représentent déjà la moitié de la population des Townships.
L'histoire de notre famille fait partie de l'histoire des cantons et les vedettes en sont; le canton de Clifton, celui de Compton, le canton de Wotton et les cantons unis de Wendover Simpson. Les rôles secondaires sont attribués au Chemin Craig et au célèbre Chemin Hemming construit en 1815 par le colonel Hériot pour relier les cantons au port Saint-François.
La vie dans les Eastern Townships était très difficile. La lecture de documents de l'époque (rapports sur la colonisation ou notes laissées par des témoins du temps) est digne des meilleurs romans et je vous livre ici quelques exemples d'aventures qu'ont vécus nos ancêtres et leurs contemporains.
Quand le colon arrivait sur sa terre, il commençait par défricher, construire une cabane rudimentaire et brûler les déchets de bois. Avec la cendre, il fabriquait de la potasse qu'il allait vendre au port Saint-François. Quinze dollars pour cent livres de potasse transportée sur le dos, à pied, des cantons aux terres françaises par le Craig's Road et le difficile chemin du port Saint-François (Chemin Hemming). Au port, les colons pouvaient acheter une hache pour 4 chelins (80 cents), un gallon de mélasse pour 30 deniers (50 cents) ou bien une bouteille de whisky fait sur place avec des surplus de patates (et ils devaient s'arranger pour qu'il y ait surplus) pour 1 chelin 10 deniers (environ 35 cents). L'hiver, les gens préféraient voyager par la rivière; plusieurs sont morts gelés, s'étant cassé une jambe ou blessé gravement en défoncant la glace, d'autres ont été attaqués par des bêtes sauvages (loups, ours). Un prêtre de Danville raconte l'histoire d'une famille de sa paroisse se nourrissant uniquement de framboises en attendant la première récolte, ou il cite la détresse d'une autre famille qui avait dû se nourrir tout un été de feuilles de bouleaux bouillies et dans le pire des cas, les gens réduits à manger, l'hiver, les grains destinés aux prochaines semailles. Le 6, 7 et 8 juin 1816, il tombe un pied de neige et il fait froid tout le reste de l'été; les récoltes seront grandement affectées. En 1806, les loups font des ravages dans les troupeaux et sèment la terreur dans la population.
Ces histoires trouvées par hasard au cours de mes recherches, sont sans aucun doute, véridiques et nous donnent une idée de l'endurance et de la ténacité que devaient avoir ces gens pour survivre à cette époque dans les Townships. Nos ancêtres étaient de ces gens courageux, voici des traces de leurs passages laissées dans les recensements ou les registres de missions ou de paroisses.
Cliquer >>>||<<< pour une photo d'un coin de terre dans les Eastern Townships...
De Clifton à Wendover Simpson
Cette histoire est celle d'un drôle de personnage, elle vous choquera peut-être, mais il faut se placer dans le contexte décrit plus haut. Pour retracer ses bribes de vie, j'ai lu les registres de Saint-Hyacinthe, de Sainte-Hedwidge-de-Clifton, de Saint-Thomas-de-Compton, Drummondville, Saint-Cyrille, Wotton et les recensements de ces cantons pour la période couvrant 1838 à 1901. Je vous avouerai que j'ai été déçu de trouver de tels indices après tant d'heures de recherches, mais l'histoire est faite ainsi. Pour comprendre le cas Onésime, je vous donne la chronologie des événements:
-11 novembre 1838; naissance de Onésime Nichol[4], à Saint-Hugues-de-Bagot.
-21 mai 1870; mariage de Onésime avec une irlandaise, Sarah McDonell de Compton. Son père Charles Nicole[4] est décédé et sa mère habite Clifton.
-19 octobre 1871; naissance de sa première fille, Sarah Addée Nichol.
-7 février 1876; sépulture à Clifton de son épouse Sarah. Onésime est absent. Sont présents Peter Clark et James Corcoran. Ce sont probablement des voisins et ils habitent le rang 11 lot 2 et 3 , loin du village aux limites de Compton (ce qui est plausible vu qu'Onésime épouse des femmes de ce canton).
-2 mai 1876; mariage d'Onésime avec Louise Métivier[6] veuve de A. Miret de Compton.
-24 avril 1877; naissance de Wilfrid Nicol[5] à Clifton
-1881 recensement; Addée Nichol à été confiée à François Bergeron de Clifton. Celui-ci à 43 ans, pas d'enfant, sa femme a 42 ans. Habite avec eux Victoire Chatel, une enseignante célibataire de 39 ans. Sur le recensement, les parents adoptifs indiquent que Sarah Addée est d'origine irlandaise, comme sa mère. Peut-être ne parlait-elle que l'anglais (il y a très peu de francophones dans Clifton) ou que les Bergeron ne connaissaient pas l'origine d'Onésime (qui parlait aussi anglais), était-elle une élève de Mlle Chatel et pourquoi vivait-elle là, c'est un mystère.
-31 octobre 1886; décès de Addée à l'âge de 15 ans. Onésime son père est encore absent. François Bergeron, son père adoptif, est présent.
-5 avril 1889; décès de Louise Métivier[6] à l’âge de 34 ans (probablement en accouchant), dans son village d'origine, Drummondville. Onésime est absent aux obsèques.
21 mai 1889; décès vers l'âge de 2 mois du bébé James Nichol privé de la présence de sa mère. Son père est absent.
-3 juin 1889; mariage d'Onésime avec Scholastique Tancrelle de Saint-Cyrille de Wendover.
-1891 recensement; Onésime à 45 ans, il est cultivateur dans Wendover. Avec lui vivent Scolastique (42 ans), Alfred (14 ans), Marie-Louise (12 ans) et Georgiana (11 ans). Wilfrid n'est pas à la maison, je l'ai cherché sans résultat dans Wotton et Clifton pour enfin découvrir que Alfred, Fred ou Wilfrid sont le même gars.
-1901 recensement; Onésime habite le village de Saint-Cyrille et travaille comme journalier pour un salaire annuel de 150$. Avec lui habite Scholastique et Rosario (16 ans).
Beaucoup d'événements sont obscurs et je n'ai pas trouvé d'explications au comportement peu habituel, même pour l'époque, de notre ancêtre. C'est heureusement le seul cas rencontré dans toute notre ascendance. Pourquoi était-il absent lors des obsèques des membres de sa famille? Pourquoi a-t-il abandonné sa première fille? Dans quelles conditions ont vécu ses 2 premières femmes (mortes assez jeunes)? Des généalogistes rencontrés aux archives m'ont suggéré le travail aux U.S.A.; hypothèse peu probable puisqu'il était là pour se remarier peu de temps après être devenu veuf. Chose certaine, il est souvent passé, au cour de ses aller-retours, entre Drummondville et Clifton, sur les terrains de la cousine Isabelle et du cousin François. Il a peut-être chassé un lièvre sur la rue Maurice ou dans mon bois (mes arbres, le peu qui a résisté au verglas de janvier 98, sont plus anciens que cette histoire).
Depuis le début de mes recherches, quand il y a quelque chose d'étonnant, Onésime n'est pas loin. La présente histoire ne fait pas exception, mais son intérêt vient de l'ascendance de sa seconde femme. Notre grand mère à tous, Louise Métivier[6], a été baptisée dans le village de Drummondville (moins de 400 habitants) en 1855. Ses parents habitaient le Township de Wendover. Quand les Townships avaient été ouverts aux francophones, Pierre Métivier[5] avait quitté la seigneurie de Nicolet pour se marier en 1846 à Drummondville avec une fille de la place, Marie-Anne Webber[3].
Les parents de Marie-Anne s'étaient mariés à Saint-François-du-Lac en 1819 et s'étaient installés dans le nouveau Township de Grantham (Drummondville). Sa mère se nommait Marie-Anne McClure[3] née à Québec en 1779, fille de Georges McClure[2] et de Marie-Anne Duval.
Georges était le fils de Thomas McClure[1] et de Marie-Charlotte Falardeau. Les jeunes Écossais membres de l'armée britannique étaient pour la plupart restés ici, pour s'établir et fonder une famille après la conquête de 1760. D'ailleurs les autorités britanniques ne tenaient pas à rapatrier ceux-ci disant d'eux; "les Écossais font de bons soldats forts et résistants et leur mort au combat n'est pas une grande perte pour l'Angleterre".
Le père de Marie-Anne Webber[3], Nicolas Webber[2], était le fils de Michael Webber[1] et Mary Still[1], tous deux nés en Allemagne. L'armée britannique engageait des mercenaires allemands.
Nicolas Webber[2] est né à Québec vers 1772. En 1805 (Nicolas avait alors 33 ans), Napoléon Bonaparte fait appel aux étrangers des nations alliées pour grossir les rangs de sa Grande Armée. Nicolas part à l'aventure combattre les Autrichiens, les Prussiens, ou bien même les Anglais. Il s'est probablement embarqué à Boston parce que le Canada et son gouvernement britannique sont officiellement en guerre contre la France, l'Allemagne et à partir de 1812, les États-Unis.
L'Empire de Napoléon s'écroule en 1812 et notre ancêtre aventurier opposé à l'Empire Britannique est de retour au pays pour se marier en 1819, à l'âge de 47 ans, avec la fille d'un Écossais.
Dans le registre de la paroisse Saint-Frédéric du village de Drummondville dans le Township de Grantham est inscrit; Nicolas Webber Allemand et soldat du grand Napoléon est décédé le 27 avril 1872 à l'âge approximatif de 101 ans.
Wilfrid Nicol[5], père de Raoul est né à Clifton et à perdu sa mère à l'âge de 12 ans. Il s'est marié à Clifton avec Maria Gendron[9] de Wotton en 1900. Il s'est installé sur une terre de 190 acres, avec une maison construite, voisine de son beau-père.