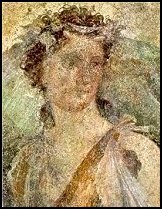![]() |
Pourquoi le retour à l'Antiquité, plus particulièrement
aux mythes antiques ?
Le mythe, écho de l'actualité et source
d'émotion tragique
Il n'est pas indifférent que ce retour des mythes antiques se
produise durant l'entre-deux-guerres et pendant l'Occupation. L'espoir
d'une paix enfin durable que soulève la victoire de 1918 s'amenuise
à mesure que s'installent en Europe des dictatures fascistes. Ainsi,
en Italie, Mussolini accède au pouvoir en 1929 et Hitler devient
le maître de l'Allemagne en 1933. L'après-guerre de 1918
ressemble alors de plus en plus à un avant-guerre.
Cette montée des périls inscrit de nouveau le tragique à
l'ordre du jour. Le mythe concentre et exprime les angoisses de l'actualité.
Les dramaturges s'en servent comme des paraboles historiques : à
travers la fable millénaire transparaissent les inquiétudes
du présent. : en dépit de ce titre, chacun sait depuis
Homère, et Giraudoux le premier, que la guerre de Troie a eu lieu.
Mais par ce titre provocateur, Giraudoux dit ses espoirs et ses appréhensions.
Il veut encore croire à la possibilité de conjurer le conflit
qui menace, mais il y croit à peine. L'avant-guerre de Troie évoque
l'avant-guerre de 1940. Le mythe fonctionne comme un signal d'alarme.
Le mythe apparaît aussi comme un moyen de déjouer la censure
lors de l'invasion et de l'occupation de la France par l'Allemagne nazie.
Le temps est à la lutte contre l'occupant. Mais comment faire quand
la publication de tout livre et la création de tout spectacle doivent
obtenir l'autorisation préalable de la censure allemande ? Le mythe
est alors considéré comme un masque, parce qu'il renvoie
par définition à des temps anciens, il semble intemporel,
désuet et sans rapport avec le présent. Quoi de commun en
effet entre le Paris des années 1943-1944 et le climat de la ville
d'Argos dépeint dans
? Rien en apparence, pourtant que de similitudes et d'analogies ! Les
habitants d'Argos sont en proie à un sentiment de culpabilité
comme les collaborateurs et le gouvernement de Vichy cherchaient à
l'inculquer aux Français, pour expier la défaite et mieux
asseoir leur pouvoir. On peut alors noter cette citation de Sartre : "
L'occupation, ce n'était pas seulement cette présence constante
des vainqueurs dans nos villes : c'était aussi sur tous les murs,
dans les journaux, cette immonde image qu'ils [les gens de Vichy] voulaient
donner de nous-mêmes " ( 1949). De plus, ce théâtre d'inspiration mythologique
est imprégné tout entier de l'émotion tragique. Le
poids du mythe et l'intangibilité de son dénouement se substituent
à la conception antique de la fatalité. Celle-ci résidait
dans une sanction divine. Le simple mortel sur lequel elle s'abattait
n'avait, par définition, aucune chance de s'y soustraire. Le sentiment
tragique qui en découlait était d'autant plus vif que l'on
croyait fermement aux dieux. Avec l'affaiblissement de ces croyances,
une autre vision de fatalité s'imposait. Les dramaturges la placent
dans le caractère implacable, parce qu'il est immuable, du mythe.
Le mythe tend naturellement vers la tragédie.
|
 |