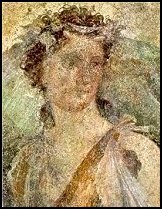![]() |
Le mythe, créateur du merveilleux
Parce qu'il fut une croyance, parce qu'il est devenu au cours des siècles
un élément constitutif de la culture, le mythe dispense
le dramaturge de toute obligation de réalisme ou de vraisemblance,
son ancienneté millénaire suffit à sa justification,
son univers est, par nature, celui de l'ailleurs, temporel ou géographique.
A ce titre, le mythe permet à l'imaginaire de se déployer
et au théâtre de se poétiser.
Ainsi, le mythe recèle d'infinis espaces de liberté. Le
dramaturge qui l'adapte à la scène peut entourer les figures
obligatoires de la légende (Créon, Antigone, Ismène,
Œdipe et Jocaste, Electre, Oreste, Egisthe et Clytemnestre) de tous
les personnages qu'il souhaite. Il peut jouer sur tous les registres,
même les plus fictifs et les moins vraisemblables. Dans , Giraudoux personnifie la paix
; la déesse Iris (divinité grecque personnifiant l'arc-en-ciel)
y surgit brièvement. Le Jardinier d'
recrée le paradis en restituant à la tranquillité
des bêtes et des plantes une parcelle de terre, redevenue pour cette
raison habitable par l'homme. Les Euménides (divinités de
la vengeance) grandissent physiquement à vue d'œil : "
petites " au début de la pièce, " âgées
de douze ou treize ans " à la fin de l'acte I, elles "
ont juste l'âge et la taille d'Electre " au dénouement.
La rapidité de cette croissance illustre l'accélération
de la marche du destin. Cet imaginaire rend possible l'incarnation d'idées
et de concepts, comme pour mieux extérioriser et concrétiser
les interrogations de l'esprit ou les drames de la conscience.
De plus, le théâtre d'inspiration mythologique échappe
à toutes les conventions réalistes et impose son univers
poétique. A la charnière des XIXe et XXe siècles,
les dramaturges avaient à leur tour tenté d'imaginer un
théâtre symboliste. Le retour des mythes au théâtre
s'inscrit dans cette ligne. Il la prolonge et l'adapte, le réel
y étant constamment dépassé. C'est pour mieux explorer
ce que l'homme porte de plus profond en lui, et donc de plus mystérieux
: ses désirs, ses craintes, ses réactions intimes devant
l'amour, la vie ou la mort, devant les grands événements
de l'histoire qu'il ne comprend pas toujours.
Le retour des mythes antiques provient donc d'une triple rencontre : entre
des raisons historiques dont la gravité appelait presque naturellement
celle des grandes légendes, des raisons éthiques, incitant
au débat d'idées, et des raisons esthétiques, qui
renouvelaient l'écriture théâtrale.
|
 |