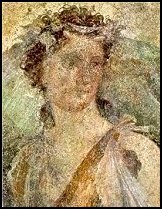 |
|
De fait, la vieille opposition Athènes/Sparte se retrouvait chez
tous les écrivains à la recherche de modèles dans les
" républiques de l'Antiquité ". Athènes,
c'était la civilisation brillante, le développement économique,
mais aussi le pouvoir sans limites du petit peuple, les excès des
démagogues qui avaient condamné Socrate à boire la
cigüe. Sparte, c'était au contraire l'ordre parfait établi
par Lycurgue, une certaine austérité de mœurs qui n'était
pas pour déplaire, mais aussi la grossièreté de la
vie intellectuelle, la manière inhumaine dont on traitait les hilotes.
On ne s'étonnera donc pas que des hommes comme Montesquieu, mais
aussi Voltaire, Diderot, D'Holbach aient préféré Athènes
à Sparte. Cette cité marchande, tolérante, " moderne
" en un mot, les attirait davantage qu'une Sparte vertueuse et rébarbative. Mais tous étaient également fascinés par ces Etats antiques qui avaient inventé la politique, et, à travers leur expérience, ils s'efforçaient de chercher, sinon des institutions applicables à la France du XVIIIe siècle, du moins un " esprit " qui pût résoudre la crise que traversait la monarchie depuis la fin du règne de Louis XIV. Les constantes références à l'Antiquité que l'on trouve chez Montesquieu ou Rousseau témoignent donc de l'intérêt suscité par l'expérience politique des Anciens. Néanmoins, les emprunts à l'Antiquité ne pouvaient qu'être limités, sur le plan des institutions. Il ne s'agissait pas d'emprunter telle ou telle institution précise à Rome ou aux cités du monde grec, mais d'évoquer l'exemple des républiques anciennes pour justifier ou au contraire dénoncer telle ou telle mesure proposée. Cela est particulièrement sensible pour l'organisation de la justice mais également pour les décisions concernant l'organisation de l'armée, décisions qui allaient prendre une importance grandissante au fur et à mesure que se précisait la menace extérieure. La République se présente alors comme étant seule à même de garantir la liberté des citoyens. L'Antiquité influence également dans l'organisation, le fonctionnement des Constitutions. La Constitution de l'an III eut son Conseil des 500 et son Conseil des Anciens ; le premier évoquait la Boulè athénienne par le nombre et le second par le respect dû au " principe d'ancienneté ". La Constitution de l'an VIII, avec ses consuls et son Tribunat, usait d'un vocabulaire manifestement romain, mais il n'était pas question que les consuls et surtout le premier d'entre eux, fussent annuels. L'Antiquité resurgit à l'époque de la Révolution française. En effet, les acteurs de la Révolution rétablissent les idées, les concepts et les fondements politiques de l'Antiquité, tels que la liberté, l'égalité voire la vertu. L'Antiquité joue donc un rôle prépondérant dans la Révolution. Non seulement elle permet de rétablir certaines idées, des notions qui ont eu un énorme succès à une époque, mais elle permet de les réactualiser. |
|||
Politique [6/7] |