| Info |
|
 |
||
Point Com |
|
|
| DOSSIER : l'interprétation en langue des signes
(Février et Mai 2001)
|
||
| Première page Dossiers Archives Revue de presse Infos sur Point Com
|
| Le
quotidien d'une interprète de LSF en province Article de Laurence Bourdon, AAE-ESIT. L’interprétation en langue des signes (L.S.F.) connaît un essor constant depuis une vingtaine d’années. Cette pratique initialement empirique s’est peu à peu professionnalisée. Le nombre d’interprètes formés n’est cependant pas pléthorique. La France n’en compte qu’une petite centaine. Si Paris est bien lotie, il en va tout autrement de la province : nous ne sommes que trois (avec des degrés divers de formation) à couvrir le Languedoc-Roussillon. Le faible nombre d’interprètes s’explique par les faits suivants :
La formation à l’interprétation en L.S.F. existe (seule l’ESIT permet d’obtenir un diplôme d’Etat), encore faut-il que les candidats aient le niveau nécessaire pour y accéder. Par ailleurs, force est de constater que la pénurie de bilingues français - L.S.F. rend a priori moins indispensable une véritable qualification. Il est par exemple fréquent que sourds et entendants se contentent de prestations pour le moins approximatives au motif que « c’est mieux que rien ». Je faisais déjà office d’interprète depuis quelques années lorsque la section langue des signes de l’ESIT a été créée. Envisager une formation ne relevait pas de l’évidence : un diplôme d’Etat représenterait certes une garantie, mais encore allait-il falloir l’obtenir. Dans la pire des hypothèses, je risquais même de ne pas être retenue lors de la sélection d’entrée. Comment y réagirait mon employeur ? Mes réflexions préalables ne concernaient pas la formation en tant que telle, mais ses enjeux pragmatiques. Ce cap passé, il m’a fallu entrer dans une démarche de formation, à savoir, accepter une forme de déconstruction pour fonder une pratique moins empirique tout en conservant mon emploi, sans donc être totalement déstabilisée. Cette dimension que j’avais initialement totalement occultée s’est révélée bien plus problématique que la quantité de travail à fournir. Deux difficultés me sont assez vite apparues :
J’ai aussi dû accepter que la formation ne soit pas immédiatement rentable dans mon travail et faire l’effort d’établir des liens entre les divers apports théoriques et ma pratique. L’interprétation consécutive n’est par exemple, pas de mise entre locuteurs utilisant des langues s’appuyant sur deux canaux compatibles simultanément. Qui plus est, prendre des notes sur un discours signé (qu’il faut donc regarder) est une réelle gageure. La première année de formation a donc consisté à s’exercer sur une modalité superflue (la consécutive) lorsqu’on travaille sur le français et la L.S.F. qui s’avérait poser des difficultés quasi insurmontables (écrire sans regarder la feuille de notes). Je n’ai mesuré la dimension propédeutique de ce type d’exercice qu’en deuxième année, laquelle s’est aussi révélée plus conforme à ma pratique. La pratique des interprètes français - langue des signes se distingue sensiblement de celle des interprètes en langues vocales. L’interdiction de la L.S.F. pendant un siècle a renforcé son statut de langue vernaculaire plus ou moins bien maîtrisée par ses locuteurs. Si les interprètes en langues véhiculaires s’adaptent au registre de langue des interlocuteurs, nous devons prendre en compte leur degré de maîtrise de la L.S.F. (ce qui est patent lorsque nous intervenons auprès de sourds isolés de villages reculés, sans contact avec les communautés sourdes urbaines). Nous sommes amenés (particulièrement en province) à intervenir dans une variété de situations que j’imagine plus disparates que celles que rencontrent nos homologues en langues vocales : interprétation de conférences, de réunions, interprétation dite pédagogique, interprétation de liaison (cadre administratif, judiciaire, médical), interprétation de cérémonies religieuses, etc. La L.S.F. n’ayant pas d’écriture, nous devons être en contact régulier avec la communauté sourde pour repérer les néologismes et évolutions langagières. Ceci peut éventuellement poser problème. En effet, nos interventions nous font parfois entrer dans la vie privée de personnes que nous rencontrons ultérieurement dans des situations moins intimes, ce qui peut être gênant pour elles malgré nos garanties de secret professionnel. Un sourd oubliant qu’il a relaté une situation vécue auprès d’un collègue et notant que cette information est relayée dans la communauté sourde risque d’incriminer l’interprète qui n’y est pourtant pour rien. Rien ne nous distingue de nos homologues en langues vocales lors de conférences, excepté notre extrême visibilité. L’interprétation dite pédagogique est spécifique et nécessiterait un article à elle seule puisqu’elle doit prendre en compte le fait que si les étudiants sourds accèdent à des cours en L.S.F., ils doivent restituer leurs connaissances en français (examens écrits). Si la déverbalisation reste la clé de voûte du processus interprétatif, nous ne pouvons totalement occulter la langue qui soutient le discours et devons régulièrement épeler certains termes techniques. Ce passage discours/langue, outre une grande concentration, requiert une excellente connaissance des enjeux de la formation. L’interprétation d’examens est parfois délicate. La loi prévoit que les candidats sourds ont droit à la présence d’un interprète pour leur passer les consignes, y compris écrites, ce qui n’est pas toujours bien accepté par les examinateurs qui ne reconnaissent pas nécessairement comme légitime le fait d’interpréter un document écrit à des sourds physiquement capables de lire. Il nous faut donc de surcroît expliquer les difficultés d’accès des sourds à la langue française, même lorsqu’ils disposent d’un support écrit. L’interprétation d’examens oraux devrait, a priori, être plus simple à gérer. Cependant, là encore, certains examinateurs méfiants nous interdisent toute intervention. Il est, le plus souvent, préférable de ne pas insister plutôt que de mettre l’examinateur dans de mauvaises dispositions vis-à-vis du candidat, quitte à ce que ce dernier fasse appel de la décision en cas d’échec. Les spécificités de l’interprétation de liaison tiennent souvent moins aux situations qu’à leur aspect inédit pour les entendants : il n’est en effet pas rare de devoir parlementer avec des policiers pour les convaincre d’ôter les menottes d’un sourd lors de son interrogatoire. Il est des situations dans lesquelles nous intervenons assez régulièrement, qui ont probablement un caractère exceptionnel pour nos collègues en langues vocales :
D’une manière générale, sauf en situation de liaison, nous travaillons beaucoup plus du français vers la langue des signes que l’inverse, ce qui est particulier, puisque, contrairement à ce qui est préconisé dans la profession, nous ne fonctionnons pas de manière privilégiée vers notre langue maternelle. Ceci ne nous pose pas de problème drastique, mais nous oblige à constamment travailler notre langue B, jusqu’à ce qu’elle devienne, non notre langue A mais quasiment une langue A’. La diversité est l’heureux lot des interprètes en L.S.F. La formation que propose l’ESIT, s’intéressant principalement à la conférence, ne peut couvrir toutes les situations (d’autant que chacune est singulière), mais offre le cadre théorique nécessaire sur lequel s’appuyer pour les appréhender sans se fourvoyer, à savoir, être passeur de sens. Le reste est affaire de pratique, d’adaptabilité, et surtout de bon sens. © Copyright 2001 - Association des Anciens Elèves de l'Ecole Supérieure d'Interprètes et de Traducteurs de l'Université de Paris - Tous droits réservés. |
Le quotidien
d'une interprète de LSF en province Tour d'Europe de la langue des signes La langue des signes française Entretien avec Jean-François Labes, Directeur de l'Ecole française de langue des signes
|
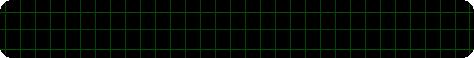 |
![]()