Les uniformes
La présente page, dont le sujet sont les
uniformes portés par les soldats et les officiers des Compagnies franches de la Marine,
est subdivisée en six chapitres:
I. L'uniforme des soldats
a) L'infanterie
Les soldats des Compagnies franches
de la Marine étaient habituellement coiffés d'un tricorne de feutre noir garni d'un
galon "d'or faux" sur le contour. Ce chapeau à trois pointes était pourvu
d'une cocarde noire. Pour les autres régiments français, la cocarde était
habituellement blanche, signe que le régiment ne dépendait pas directement du roi mais
appartenait à un quelconque seigneur. Non-obligatoire lorsque les soldats n'étaient pas
en devoir, le tricorne était souvent remplacé par un bonnet de drap.
Tous les soldats possédaient deux
chemises en toile de coton et lin. Attachée à l'aide de boutons de bois ou d'os, la
chemise servait également de chemise de nuit. Lorsqu'ils portaient le reste de leur
uniforme, les soldats attachaient une cravate autour de leur cou.
Par dessus leur chemise, les
soldats portaient une veste. Cette tenue était qualifiée de "petit
habillement". Elle fut communément portée par les soldats Adoptée par les
Compagnies franches entre 1690 et 1700, la veste était de couleur gris-blanc jusqu'en
1716. À partir de cette date, elle était de couleur bleue. Les boutons qui servaient à
l'attacher étaient en cuivre.
Le justaucorps, par sa coupe et sa
couleur, était le symbole de l'uniformité de la tenue des armées françaises. Adopté
en 1660, il était porté par tous les militaires. Son nom venait du fait qu'il était
ajusté à la taille (au corps) alors que les manches et les retroussis étaient,
généralement, assez amples. Au cours des années, il devint de plus en plus ajusté,
rencontrant un besoin constant d'adaptation aux armes nouvelles. Le justaucorps des
Compagnies franches était confectionné de drap gris-blanc. Ses parements étaient bleus
pour faciliter la différenciation entre les soldats des Compagnies franches et des autres
régiments. Le justaucorps se portait, généralement, avec ses retroussis relevés et
attachés sur les côtés. Les hommes du rang le portaient fermé avec les armes à
l'extérieur, contrairement aux officiers, qui le portaient ouvert avec l'épée à
l'intérieur.
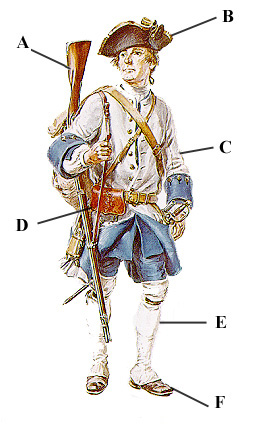 |
A. Fusil: modèle 1746. Il
mesurait 1,59 mètre de long et pesait environ 4,3 kilogrammes. B. Tricorne: fait de feutre de laine, il
avait une cocarde noire sur le côté gauche.
C. Justaucorps: fait de drap
gris-blanc, se portait par-dessus la veste bleue
D. Cartouchière: poche de cuir
contenant les cartouches préparées
E. Guêtres: protègeaient les bas
et les jambes des ronces et des cailloux .
F. Souliers à boucle: fait de
cuir noir. ils avaient une boucle de laiton. |
| Illustration par Eugène
Lelièpvre, Environnement Canada, Service Canadien des Parcs. |
Les soldats portaient aussi des bas bleus
assortis à une culotte de la même couleur. Celle-ci se fermait à l'aide d'une braguette
à boutons extérieurs et elle possédait les mêmes boutons extérieurs aux genoux. Par
dessus les bas, les soldats portaient, plus souvent qu'autrement, des guêtres. Celles-ci
offraient une protection supplémentaire contre le climat tout en empêchant les cailloux
et les morceaux de bois de pénétrer dans les souliers mal ajustés des soldats. Les
soldats recevaient habituellement deux paires de guêtres: une en toile pour l'été et
une deuxième, en laine, pour l'hiver. Les guêtres étaient retenues au genou par une
lanière tout en étant boutonnées sur toute leur longueur. L'hiver, elles étaient
remplacées par des mitasses.
Les soldats possédaient des souliers de cuir.
Ils étaient ornés de boucles carrés de cuivre jaune. Ces souliers étaient tous de la
même longueur et avaient une forme identique (le soulier gauche avait la même forme que
le soulier droit). Cet état de chose permettait une confection plus rapide et plus
rentable ainsi qu'une distribution accrue. Par ailleurs, on recommandait aux soldats de
porter leurs souliers en alternance, d'un pied à l'autre, de cette manière ils les
useraient uniformément.
Par dessus leur uniforme, les soldats portaient
une giberne, ou cartouchière, et un ceinturon. Avant 1690, la giberne, qui servait à
transporter les cartouches, se portait à la ceinture et pouvait en contenir environ une
dizaine. Après cette date, elle se portait en bandoulière et pouvait contenir une
trentaine de cartouche. Le ceinturon se portait sur la taille et était attaché par une
boucle de laiton. On y suspendait, du côté gauche, une épée et une baïonnette. La
giberne et le ceinturon étaient tous deux confectionnés de cuir de buffle.
En temps normal, les soldats recevaient un grand
habillement (justaucorps) tous les deux ans. Entre ces deux années, ils recevaient un
nouveau tricorne, des chemises, des bottines, une veste, une culotte et des bas. On doit
supposer, à voir l'état des uniformes des soldats, que cette pratique n'était pas
exécutée régulièrement.
b) La musique
Pour ce qui est des musiciens (fifres et
tambours) des Compagnies franches, ceux-ci portaient un justaucorps bleu à boutons de
cuivre, avec des parements et des retroussis rouges. Ce justaucorps était orné de la
livrée du roi (chaîne blanche sur fond rouge bordé de blanc). Les culottes et la veste
étaient de couleur rouge. Le reste de l'uniforme des musiciens était semblable à celui
des soldats d'infanterie, sauf en ce qui à trait au ceinturon. En effet, celui-ci ne
retenait qu'une épée, les musiciens ne portant ni baïonnette ni giberne. Les tambours
portaient en bandoulière une ceinture additionnelle retenant leur instrument. Celle-ci
était faite de cuir de buffle et était, elle aussi, décorée de la livrée du roi. La
caisse du tambour était de couleur bleue et était ornée de fleur de lys, symbole de la
monarchie. Les fifres portaient, pour leur part, un fourreau à la ceinture qui servait à
ranger leur instrument lorsque celui-ci n'était pas utilisé. Ce fourreau, ainsi que la
ceinture qui le retenait, était également confectionnée de cuir de buffle.
Les musiciens servaient en campagne et sur le
champs de bataille à transmettre les ordres du capitaines. En effet, l'officier
commandant transmettait ses ordres à travers ses musiciens: un certain roulement de
tambours signifiait l'attaque, un autre signifiait la marche tandis qu'un troisième
signifiait la retraite. Les fifres étaient surtout utilisés comme accompagnement durant
les heures de marche.
c) L'artillerie
Quant aux canonniers-bombardiers, ceux-ci
portaient un justaucorps bleu à boutons d'argent, avec des retroussis et des parements
rouges. La veste et les culotte étaient de la même couleur. Par ailleurs, les canonniers
étaient vêtus de rouge pour deux raisons: la première, leur officier commandant pouvait
les apercevoir de loin. La deuxième, la couleur de leur uniforme permettait de cacher une
blessure survenue sur le champs de bataille (la perte d'un bras par un canonnier pouvait
démoraliser les combattants qui se trouvaient aux alentours).
II. Les armes des soldats
Les soldats des Compagnies franches étaient
principalement armés d'un fusil à silex. Il mesurait 1,59 mètre et pesait 4,3
kilogrammes. Le fusil français était plus court et plus léger que le fusil anglais. Il
avait aussi un plus petit calibre. Ces différences permettaient une plus grande mobilité
dans les bois. D'autre part, tous s'accordaient à considérer sa fabrication comme étant
supérieure à celle du Brown Bess anglais. Quant à leur efficacité, elle était
similaire en précision et en inconstance. Le fusil à silex avait une portée mortelle de
180 mètres, mais sa portée effective était d'environ 50 mètres, étant donné
l'imprécision due au canon non-rayé. Pour pallier à ce manque de précision, les
soldats faisaient feu à la volée et par peloton. Par ailleurs, un soldat bien entraîné
pouvait charger son fusil et faire feu trois fois en une minute. Les fusils expédiés en
Nouvelle-France provenaient généralement de Tulle et de Saint-Étienne. Ces villes
étaient, à l'époque, d'importants centres de production d'armes.
Une baïonnette à cran étaient souvent
utilisée sur les fusils français de cette époque. Celle-ci se fixait au bout du canon
de manière à ne pas obstruer la bouche, contrairement à l'ancienne baïonnette à poire
qui empechait le tir. La lame était de forme triangulaire et encavée ce qui favorisait
l'effet de succion lorsqu'elle était retirée du corps d'un ennemi. Cela avait pour effet
la formation d'une plaie qui se refermait difficilement. La baïonnette était
portée à la ceinture, du côté gauche, dans un fourreau de cuir. Son nom provient de la
ville de Bayonne, où elle fut utilisée pour la première fois.
Les soldats portaient également une épée.
Celle-ci, d'une longueur d'environ 70 centimètres, possédait une lame à double
tranchant et était considérée comme étant de médiocre qualité. Elle était petite,
pas très robuste et n'offrait que peu de protection pour la main. Elle se portait du
coté gauche avec la baïonnette dans un fourreau de cuir. Par ailleurs, peu de temps
après leur arrivée, les soldats des Compagnies franches remplacèrent l'épée par une
hachette, instrument beaucoup plus pratique pour la survie dans les bois.
III. Recrutement et possibilités d'avancement des soldats
Avant 1695, les soldats des Compagnies franches
de la Marine étaient recrutés dans la métropole, en France. Par contre, à partir de
cette date, un nouveau règlement permettait aux coloniaux de s'engager et de faire
carrière dans les troupes régulières de la Nouvelle-France. Les soldats étaient
recrutés parmi le peuple.
Les recrues françaises provenaient
généralement des régions portuaires, car celles-ci entretenaient des liens commerciaux
étroits avec la colonie. Parmi celle-ci, on peut citer les régions d'Aunis, de
Saintonge, du Poitou, d'Augoumois, de Guyenne, d'Île-de-France et du Lyonnais. Par
contre, d'autres soldats étaient originaires de régions comme le Languedoc, le
Dauphiné, la Bourgogne et l'Alsace. Il faut, cependant, stipuler que leur nombre était
plutôt infime.
Les jeunes gens de l'époque avaient de
multiples raisons pour s'engager dans les Compagnies franches. Pour les recrues provenant
de France c'était surtout le goût de l'aventure, une décision impulsive, la fuite
devant la justice royale ou devant des conditions de vie précaires (épidémies, famines,
taxation excessive, etc.). D'autres quittaient le pays dans l'espoir d'améliorer leur
rang social en Nouvelle-France une fois leur engagement terminé. Quant aux recrues
coloniales, on peut supposer que les motifs étaient surtout la possibilité d'un emploi
permanent et la volonté de défendre leur patrie. Tout au long de la présence des
Compagnies franches en Nouvelle-France (1683-1760), le partage du recrutement entre la
colonie et la métropole fut sensiblement équivalent quant au nombre de soldats engagés.
Cependant, le corps des officiers était majoritairement composé de nobles canadiens.
Après un certain nombre d'années de service,
les soldats pouvaient espérer recevoir un grade supérieur. Par contre, seuls les grades
de sous-officiers leur étaient accessibles (les officiers étant tous des nobles). Dans
chaque compagnie, on comptait des caporaux (trois galons de laine jaune à la hauteur des
boutons des parements du justaucorps), des anspessades (un galon de laine jaune entourant
les parements). Les hauts sous-officiers étaient, quant à eux, les sergents et les
sergents-majors Ces derniers étaient des capitaines d'armes et étaient considérés
comme étant supérieurs aux sergents. En charge de l'entraînement des recrues, ils
portaient des galons d'or sur leurs parements et les poches de leurs justaucorps et de
leurs vestes. Il faut quand même le mentionner, les soldats et tous les sous-officiers
étaient des roturiers, il leur était donc impossible d'accéder à des grades
d'officiers.
IV. Uniforme des officiers
L'uniforme des officiers se distinguait sous
plusieurs aspects de celui des soldats et des sous-officiers. En effet, des galons d'or
embellissaient les parements et les rabats des poches de leurs vestes. Par ailleurs, les
justaucorps des officiers étaient confectionnés de tissus de meilleure qualité et se
portaient habituellement ouvert tandis que les boutons étaient dorés. En devoir, les
officiers portaient des hausse-cols dorés, l'unique marque de leur statut
d'officier. Ceux-ci rappelaient l'armure médiévale des chevaliers. Les officiers
portaient également des chemises à dentelles et des cravates de soie. La beauté, la
qualité et le soucis du détail des uniformes des officiers des Compagnies franches de la
Marine provenaient du fait que, contrairement aux soldats dont l'uniforme était fourni
par le roi, les officiers devaient le payer eux-mêmes.
V. Armes des officiers
Comme arme personnel, les officiers possédaient
une épée de gentilhomme dorée ornée d'une dragonne. Cette épée était plus belle et,
de loin, de meilleure qualité que celle des soldats. Les officiers utilisaient aussi un
esponton, ou demi-pique.Cependant, les armes blanches étaient peu utilisées en
Amérique, les officiers préférant l'emploi de fusil ou de pistolets lors des campagnes.
VI. Recrutement des officiers
Contrairement aux soldats, les officiers des
Compagnies franches étaient recrutés parmi la noblesse française et néo-française. .
La demande de commission pour les fils de Canadiens était tellement forte en
Nouvelle-France que l'on dut créer le grade de cadet-à-l'aiguillette (élève-officier
en formation, comme symbole de son grade il portait des aiguillettes sur l'épaule
droite).
Parmi les officiers on comptait: le capitaine,
le lieutenant, l'enseigne-en-pied et le cadet-à-l'aiguillette. En Nouvelle-France, les
majors et les ayde-majors, souvent des capitaines avec une grande ancienneté, occupaient
des postes administratifs importants au sein de la colonie. À leur retraite de la vie
militaire, ils pouvaient, en signe de reconnaissance royale, recevoir une seigneurie pour
l'exploiter jusqu'à la fin de leurs jours.
Bibliographie
| Conçu et réalisé par: Louis
Valiquette, Maître-Canonnier, 1993 |
| Revu et corrigé par: André
Senkara, Caporal, 1998 |
| Copyright (c) André Senkara
1997 |