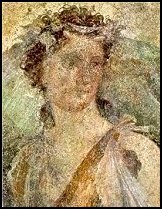![]() |
L'absurde
L'une des singularités de la réécriture de mythes
par les dramaturges modernes réside dans la disparition de leur
rôle signifiant. L'absurde y règne en maître.
Aussi bien les actes des personnes que l'existence même de l'être
humain se trouvent dépourvus de justification. Ainsi, Anouilh procède
à la démolition des valeurs morales. La désacralisation
qu'il opère enlève au geste d'Antigone son antique portée
religieuse. L'admiration que depuis son enfance elle vouait à son
frère, et qui pourrait expliquer son attitude, repose sur une illusion,
que Créon n'a aucune peine à dissiper. Polynice n'était
en réalité qu'un voyou de la pire espèce, qu' "
un petit carnassier dur et sans âme ". A supposer même
qu'Antigone veuille l'enterrer par un simple et ultime reste d'affection,
elle n'a plus aucune raison de le faire lorsque Créon lui révèle
que le cadavre n'est peut-être pas celui de Polynice. Le mythe,
revu par Anouilh, ne véhicule plus aucun idéal, religieux
ou héroïque, et Antigone, ainsi qu'elle le reconnaît
tragiquement, " ne sait plus pourquoi [elle] meurt ".
L'absurde envahit également la scène de l'histoire. Acteur
de son propre destin, l'homme en devient pourtant la victime ignorante
et impuissante, qu'il s'agisse de sa destinée collective ou de
sa destinée individuelle. L'absurde, dans , imprègne l'histoire
des peuples et des collectivités, dans , plus oedipe s'efforce d'échapper au sort
qui lui a promis l'oracle, plus il travaille à sa propre perte.
Mais l'oracle finit par se réaliser. Tout se passe, en réalité,
comme si les dieux agissaient par méchanceté. Pour qu'ils
" s'amusent beaucoup ", dit la voix, " il importe que leur
victime tombe de haut ". Cet amusement laisse un goût amer,
que renforce l'attitude même d'Oedipe. En effet, celui-ci assume
son sort sans révolte, comme si par sa soumission il voulait donner,
après coup, raison aux dieux, comme s'il voulait les disculper
de toute faute. L'absurde se confond alors avec le mystère et le
silence, car bien que l'attitude d'Oedipe soit noble, elle ne parvient
à dissimuler le malaise né de cette question laissée
sans réponse : pourquoi ?
Des mythes en partie tournés en dérision
La réécriture des mythes participe de la même façon
à leur désacralisation, notamment par l'irruption du burlesque
et, plus globalement, par le mélange du comique et du tragique.
Catégorie du comique, le burlesque en est une expression particulière.
Il repose toujours sur un contraste. Les dramaturges exploitent ce procédé.
Ainsi, lors de leur nuit de noces, Jocaste et oedipe dans , échangent des propos enfantins, se
donnent des diminutifs qui conviendraient mieux à l'atmosphère
d'une comédie : " ma petite reine ", " quel gros
bébé ! " (Le Lac - 1818). Le décalage devient
parfois grinçant, quand l'inceste va se consommer et que le dialogue
multiplie les allusions à la situation réelle des personnages.
oedipe appelle Jocaste " ma petite mère chérie ".
Dans sa bouche, la formule se veut affectueuse ; dans la réalité,
il s'agit bel et bien de sa mère. Plus généralement,
le mélange des tons est constant. Le comique transparaît
même dans ces intrigues, pourtant tragiques. On peut alors noter
la fréquence des parodies. On trouve ainsi dans , cette formule : " un
seul être vous manque, et tout est repeuplé ". La phrase
est un écho déformé et souriant d'un des vers les
plus célèbres de Lamartine : " un seul être vous
manque, et tout est dépeuplé ". On peut aussi souligner
l'abondance des jeux de mots et des plaisanteries. Ainsi, dans , le dialogue entre les soldats et leur chef
est riche en expressions familières, dont l'effet est parfois comique
: " Il est très poli votre fantôme d'après tout
ce que vous me racontez. Il apparaîtra, je suis tranquille. D'abord,
la politesse des rois, c'est l'exactitude, et la politesse des fantômes
consiste à prendre forme humaine, d'après votre ingénieuse
théorie. "
La désacralisation des mythes obéit à une double
intention. La première relève du plaisir de l'esprit. On
aurait cependant tort de n'y voir qu'un simple jeu. La désacralisation
des mythes renforce en effet paradoxalement leur puissance tragique. Celle-ci
devient le lot ordinaire et universel de l'existence. En se désacralisant,
les mythes, d'une certaine façon, s'humanisent et, en s'humanisant,
ils affirment leur vocation à exprimer les angoisses de tout un
chacun, et les tragédies dans toutes les époques.
Dans un tout autre domaine, celui de la chanson, pour compléter
cette étude sur l'actualisation des mythes, qui sont en partie
tournés en dérision, on peut citer les chansons de Georges
Brassens. Ainsi, Pénélope, évoque Ulysse, le héros
grec, époux de Pénélope. L'auteur réduit ce
roi légendaire à un Ulysse de banlieue : " En attendant
l'retour d'un Ulyss'de banlieue ". Pénélope est mise
en " épouse modèle " qui attend derrière
ses rideaux le retour de son mari.
|
 |