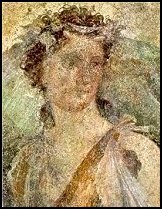 |
|
Plus tard, ZENON (-490,-425), philosophe grec, développe des paradoxes
mathématiques, dont certains sont devenus célèbres.
Un exemple connu est celui d'Achille et de la tortue : selon son raisonnement,
Achille ne pourra jamais rattraper la tortue... En effet, quand il se déplace
pour combler la distance qui les sépare, la tortue continue d'avancer
; le déplacement est donc insuffisant et il faut recommencer à
l'infini. Il démontre donc l'impossibilité du mouvement, en
raison des contradictions logiques qu'il comporte. Il forma ainsi les esprits à se méfier de ce qui apparaît comme évident ; c'est en ce sens, une introduction au doute, caractéristique de l'esprit scientifique. Quelques temps après, HIPPOCRATE DE CHIOS, mathématicien
grec du Ve siècle av.J.C, écrivit des essais d'organisation
systématique des mathématiques ; son enchaînement
consista à faire dépendre la démonstration d'un théorème
de celle d'un autre. Mais les Grecs ne se bornèrent pas aux mathématiques, ils firent également de grandes découvertes en physique et en astronomie. Vers l'an 300 avant notre ère, EUCLIDE, grand mathématicien
grec pose, sous forme organisée et systématisée,
tous les axiomes de base de la géométrie, les théorèmes
fondamentaux des carrés, des triangles, des parallélépipèdes,
des cercles, des volumes solides, une théorie des nombres entiers,
des nombres premiers, des indéfinis, des irrationnels. Bref une
exposition complète du savoir abstrait, divisée en treize
chapitres rassemblés sous le titre général : d'. |
|||
Sciences [3/8] |