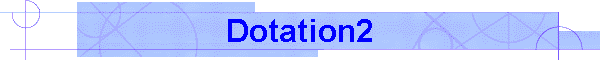|

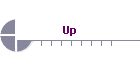
|
|
Début
de l'article
2. Nouvelle
technique de financement.
2.1. Dans un premier temps, un système appelé " financement
alternatif " fut décidé par le Ministre LUTGEN en 1990.
Les logements sociaux destinés
à la location sont réservés en priorité aux personnes disposant
de revenus peu élevés. Les loyers demandés ne peuvent couvrir le
coût réel de l'investissement et du maintien en état du patrimoine.
La Région doit donc intervenir, quel que soit le système de financement
pratiqué, pour subsidier cette opération.
On aura en mémoire, de plus,
les aides que la Région doit apporter au secteur locatif (allocations
de solidarité, plans d'assainissement) pour assurer sa sauvegarde.
Le système nouveau
de financement conjugue :
- l'utilisation
de capitaux levés sur le marché ;
- l'intervention
de la Région dans le remboursement de l'emprunt et dans la couverture
de certaines charges.
Cette intervention
est donc égale, pour une première partie, aux charges annuelles
de remboursement de l'emprunt, diminuées des recettes locatives
perçues par les sociétés.
Par ailleurs, la couverture
de certains frais pourrait être assurée pendant la durée de remboursement,
afin d'éviter des déficits de gestion.
Il s'agit des charges d'exploitation
des logements à construire, telles que :
- les rémunérations, charges
sociales et pensions du personnel administratif, technique et
social, non imputées aux locataires ;
- les frais administratifs
non imputables aux locataires, l'assurance-incendie, le précompte
immobilier ;
- la provision pour gros entretien.
Par l'intervention dans la constitution
de cette provision, la Région ne devrait plus intervenir par d'autres
subsides pour aider les sociétés à effectuer le gros entretien.
L'intervention de la Région
devrait être calculée, pour la seconde partie, en tenant compte
de ces charges d'exploitation.
2.1.1. Une
étude a été commandée à ISIS CONSULT (Initiative Support for Industry
and Service), à l'effet d'estimer les incidences économiques de
ce nouveau mode de financement pour le secteur locatif social.
2.1.2. Les objectifs de cette étude
Cette étude portait :
- sur l'implication budgétaire à long terme de
ce nouveau mode de financement ;
- sur son impact pour l'équilibre financier des
sociétés qui en seraient bénéficiaires.
2.1.3. Des projets concrets
ayant été remis par certaines sociétés, cette étude en a analysé
les données et hypothèses, d'une part, et, d'autre part, il a été
procédé à des simulations sur des projets théoriques moyens qui
tiennent compte des valeurs des indicateurs de gestion publiés dans
le cadre des plans d'assainissement des sociétés.
2.1.4. Le nouveau mode d'intervention publique
poursuivait un double objectif :
- réduire la période de financement,
laquelle s'étend actuellement sur 66 ans, même pour les travaux
de rénovation et de réparations auxquels il faut procéder avant
le terme de l'intervention relative à la construction initiale ;
- diminuer l'incertitude
quant aux incidences budgétaires à long terme de cette procédure.
Dans le mode de financement qui était alors en
vigueur, le coût de l'intervention publique pouvait être évalué
par l'écart entre le taux auquel les pouvoirs publics se finançaient
sur les marchés monétaires et le taux d'intérêt appliqué sur l'avance
en 66 ans (soit 2,5 %).
Le nouveau mode d'intervention qui allait être
mis en œuvre était basé sur une approche fondamentalement différente
: il s'agissait de couvrir l'écart entre l'annuité
(capital et intérêts) à rembourser aux organismes bancaires auprès
desquels les emprunts ont été contractés et les loyers nets susceptibles
d'être perçus.
Le loyer net à percevoir est déterminé, dans la
formule de l’époque, par le prix de revient actualisé du logement
multiplié par le coefficient "chantier" et par le coefficient-revenu
moyen des locataires.
En cas d'application d'une nouvelle formule de
calcul des loyers, les résultats de celle-ci devraient, bien entendu,
être imputés dans les estimations et, dès lors, dans les paramètres
de calcul de l'intervention régionale.
On n'a pas tenu compte du taux d'inoccupation du
bâtiment de manière à éviter des décomptes complexes et à inciter
les sociétés à mener une politique commerciale dynamique.
En ce qui concerne la liquidation de l'aide, deux
systèmes ont été imaginés :
- le premier prévoit que les versements publics
sont étalés sur l'ensemble de la période de remboursement de l'emprunt
;
- le second consiste en une dotation en capital
unique.
Le mécanisme de la dotation a plusieurs implications
importantes :
- pour les pouvoirs publics, elle requiert une mobilisation de
moyens financiers à court terme très élevée : à titre d'exemple,
la construction de 500 logements d'une valeur unitaire moyenne de
2,650 millions de FB demanderait une mise de fonds minimale de 1
milliard de FB ;
- pour ne pas mettre en péril la situation financière des sociétés
agréées, elle nécessite une projection la plus réaliste des loyers
annuels à percevoir ;
- enfin, elle doit se concevoir en prenant en compte que les emprunts
peuvent être assortis de clause de révision quinquennale : si c'est
le cas, il convient de prévoir soit des compléments ponctuels (adaptation
en fonction de l'évolution des taux), soit des dotations supplémentaires
pour risque de taux.
2.1.5. Les simulations ont pris en compte
plusieurs hypothèses.
- Coût de la construction :
trois prix de revient ont été retenus :
- 2.054.376 F
- 2.650.000 F
- 3.230.025 F ;
- ces prix de revient ont été
actualisés par application d'un taux annuel moyen de 3 % l'an ;
- le mode d'amortissement retenu
est l'amortissement linéaire ;
- une dotation de 1 % du prix
de revient a été retenue pour le gros entretien et les réparations
majeures.
L'étude considère le taux d'intérêt sur le marché
et y ajoute le coût de la rémunération des services prestés par la S.W.L.
(actuellement, un "taux de chargement" est appliqué) ainsi
que les taux créditeurs et débiteurs à appliquer sur les placements
et découverts des sociétés.
L'étude prend en compte le système actuel de calcul
du loyer social, ainsi que le coefficient-revenu moyen en Wallonie (0,72).
L'étude a, enfin, analysé et inclus les frais à
charge de la société, selon les valeurs-seuils des indicateurs de gestion,
ainsi que, pour les comptes prévisionnels de gestion, les coefficients
structurels de gestion, tels que les délais moyens de paiement, les
créances perdues, les dettes fiscales, salariales et sociales.
2.1.6. Conclusions.
Différents avantages résultaient
de ce mode d'intervention.
L'intervention publique est limitée
à une période de 20 ans au maximum.
Après cette période, le bâtiment
est assuré de son entretien pour une nouvelle période, sans intervention
régionale.
L'incertitude des incidences budgétaires
est réduite.
L'intervention publique incorpore
l'aide à l'opération immobilière et l'aide à la politique sociale du
logement.
Ce système de financement améliore la situation financière
des sociétés qui ne peuvent bénéficier en moyenne de loyers élevés.
Suite
de l'article
[ Up ]
[ Dotation ] [ Dotation2 ]
[ Dotation3 ]
|