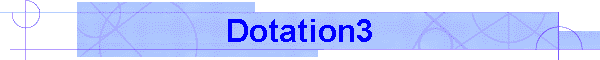
|
|
|
Toute combinaison de ces divers mécanismes peut évidemment être également envisagée. L’intervention des pouvoirs publics repose, pour sa part, sur le principe qu’il convient de couvrir le différentiel entre les taux qui prévalent sur le marché (taux de financement de l’organisme) et les taux de rendement nets dégagés par la valorisation des investissements ; en effet, pour rendre les conditions d’offre compatibles avec les contraintes financières et sociales des demandeurs, il convient que les pouvoirs publics " subventionnent " les opérations par un processus que l’on pourrait qualifier d’ajusté (les taux de prêts ou les loyers étant fonction des revenus des bénéficiaires).
Dans ce premier schéma, l’organisme emprunte sur le marché des capitaux un montant correspondant au pouvoir d’investissement de l’exercice. Le mécanisme de subsides répond strictement au principe général de l’intervention publique puisqu’il correspond à la prise en charge par la Région de l’écart entre les taux de financement et de rendement, compte tenu d’une marge d’intermédiation pour frais de gestion et d’entretien dans le secteur locatif. Le versement s’effectue annuellement ce qui signifie qu’il y a débudgétisation ; autrement dit, la Région s’engage pour une période égale à la durée des financements liés à un programme d’investissements particulier. Les risques liés au financement sont quasi exclusivement supportés par la Région, ceux liés à l’exécution des missions étant majoritairement à charge de l’organisme.
Le mécanisme de " dotation en capital intégrale " a été mis en application en Région bruxelloise pour certains organismes dans la première moitié des années 90 ; le principe retenu est le suivant : la Région couvre, par une dotation unique, la quasi-totalité du programme d’investissements réalisé par l’institution au cours d’un exercice donné. Cette mise de fonds lui permet de capitaliser, ultérieurement, les mensualités et recettes locatives perçues pour générer progressivement une capacité d’autofinancement, donc pour assurer tout ou partie du financement des programmes futurs. Il s’entend que ce processus répond aux objectifs de rebudgétisation intégrale de l’intervention publique mais requiert, à court et moyen terme, un effort extrêmement considérable pour les finances publiques. Il implique également un transfert des responsabilités et des risques (à court, moyen et surtout long terme) dans le chef de l’organisme. Ce dernier est, en effet, totalement dépendant des recettes moyennes dégagées sur les différentes opérations, du taux de capitalisation (directement lié à l’évolution des taux de placement) et de l’évolution du coût de l’immobilier et/ou de la construction (reconstitution du capital physique).
La dotation en capital partielle combine certains des principes généraux exposés aux points 2.2.1.1. et 2.2.1.2. De l’intervention publique par " subsides en intérêts ", elle reprend le principe de couverture de l’écart entre les taux de financement et de rendement, toujours compte tenu d’une marge d’intermédiation. De la dotation en capital intégrale, elle exploite le principe de rebudgétisation. La dotation en capital correspond à la somme actualisée des " subsides en intérêts " … autrement dit, elle combine dans le chef de l’organisme, emprunt souscrit sur le marché des capitaux et mise de fonds propres régionale de manière telle que :
Ce mode de financement implique, comme le précédent, un transfert des responsabilités et des risques majeurs vers l’organisme. Ce dernier doit, en effet, faire face :
|