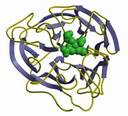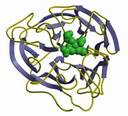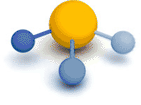|
|
|
|
|
|
|

|
| |
TRAITEMENT
| |
| |
 SECTION
SECTION
- Informations scientifiques
- Empêchement - inclut l'hygiène personnelle, les politiques de quarantaine (voyez également légal), les politiques sur des événements publics et des écoles de fermeture, les lieux de travail, etc...
- Vaccins - fondations, rationnement et priorités, approvisionnement
- Thérapie médicale - antivirals, hospitalisation
- Thérapie alternative et complémentaire - organisez par type de le praticien
- Faire face - inclut des matières telles que la gestion et les activités de peine pour des familles restant à la maison pendant des périodes prolongées
TRAITEMENT

- Buts
Le traitement de la grippe est essentiellement symptomatique. Il est aussi préventif par la vaccination.
- Moyens
Le traitement symptomatique à base de repos alité, isolement, antipyrétique, antalgique et Vitamine C.
- Sensibilité des virus H5N1 aux antiviraux
Les données reçues par le Réseau mondial de l’OMS pour la surveillance de la grippe indiquent que les virus H5N1 récents sont sensibles à l’oseltamivir, l’un des deux inhibiteurs de la neuraminidase homologués. Toutes les souches testées (4 isolats provenant de l’homme et 33 des oiseaux) ont montré in vitro une sensibilité à ce médicament.
L’oseltamivir appartient à l’une des deux classes de médicaments que l’on peut utiliser pour la prévention ou le traitement de la grippe chez l’homme. Les études menées auparavant par les laboratoires du réseau ont montré que les souches H5N1 les plus récentes sont résistantes à la deuxième classe de médicaments, ceux qui bloquent la protéine M2 (amantadine et rimantadine).
L'amantadine et la rimantadine peuvent être utilisées dans certaines conditions.
- Indications
Dans certains cas, le traitement symptomatique est de mise.
L'amantadine (Mantadix) et la rimantadine (Roflual) sont des agents antiviraux spécifiques d'une efficacité de 80% mais ne sont pas couramment utilisés. L'administration de 100 à 200mg/j pendant une dizaine de jours est débutée avant l'infection simplement sur une notion de contage, ou dans les 24h après le début. En cas d'épidémie avérée, l'administration doit être poursuivie pendant toute sa durée du fait d'une action seulement transitoire. Le mécanisme d'action est l'inhibition de la pénétration du seul virus A.
L'antibiothérapie systématique à base de Pénicilline ou de macrolide est indiquée sur terrain fragilisé, chez le nourrisson ou le vieillard.
Dans les grippes malignes, l'hospitalisation est nécessaire (en particulier chez le sujet âgé).
- Surveillance
La surveillance de la guérison complète est nécessaire surtout sur terrain fragilisé. La découverte d'une tuberculose dans les suites immédiates d'une grippe est relativement classique.
- Prévention
La meilleure prévention de la grippe reste la vaccination.
Cette vaccination repose sur l'administration sous-cutané d'un vaccin tué, mélange de souches A H1N1 et H3N2 et B (Mutagrip, Vaxigrip). La souche A est celle ayant produit les dernières épidémies. Chez l'adulte, la dose est de 0,5ml, de moitié chez l'enfant à pratiquer chaque année en automne. Il est possible de pratiquer une injection de rappel au cours de l'hiver lors de la primovaccination. L'immunité apparaît en 10 à 15 jours seulement chez 60 à 80% des sujets.
La seule contre-indication est l'allergie aux protéines de l'oeuf prouvée.
Les indications vaccinales sont le sujet âgé de plus de 70 ans, l'insuffisant respiratoire chronique (myopathie, mucoviscidose), le diabétique, l'immunodéprimé, le valvulopathe, le personnel médical et toute personne le désirant. Les femmes enceintes peuvent être vaccinées.
CONCLUSION
La grippe est une maladie le plus souvent bénigne mais du fait de sa diffusion parfois sous forme de pandémie, l'impact socio-économique est énorme. Sur certains terrains et parfois sans raison, la maladie prend une forme grave parfois mortelle. La prévention repose sur la vaccination annuelle en l'absence de traitement étiologique efficace.
|
| |
|

|