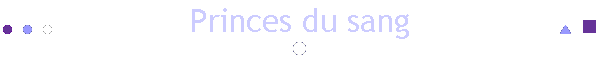
|
|
à propos de la principauté de Neuchâtel La possession de la principauté de Neuchâtel a été déjà auparavant l'occasion de grandes batailles juridiques. Saint-Simon écrit (II-XVI) : "M. le prince de Conti, ayant gagné son procès contre Mme de Nemours, songea à en tirer la meilleure pièce, qui était Neuchâtel. Pour abréger matière, il engagea le roi à envoyer M. de Torcy de sa part à Mme de Nemours lui faire diverses propositions, qui toutes aboutissaient à ne point plaider devant MM. de Neuchâtel, à l'en laisser jouir sa vie durant, et à faire avec sûreté qu'après elle cette principauté revint à M. le prince de Conti. Mme de Nemours qui avait beaucoup d'esprit et de fermeté, et qui se sentait la plus forte à Neuchâtel, vint dès le lendemain parler au roi, refusa toutes les propositions, et moyennant qu'elle promit au roi de n'employer aucune voie de fait, elle lui fit trouver bon qu'elle allât à Neuchâtel soutenir son droit. M. le prince de Conti l'y suivit, Matignon y alla aussi, et enfin les ducs de Lesdiguières et de Villeroy, qui tous y prétendaient droit après Mme de Nemours. Ces trois derniers descendaient des deux sœurs de M. de Longueville, grand père de Mme de Nemours : les deux ducs de l'aînée, mariée au fils du maréchal de Retz, et M. de Villeroy n'y prétendait que du même droit et après M. de Lesdiguières; la cadette mariée au fils du maréchal de Matignon. Le vieux Mailly et d'autres gens se firent ensuite un honneur d'y prétendre par des généalogies tirées aux cheveux. Il y a eu sur cette grande affaire des factums curieux de tous ces prétendants. Le public désintéressé jugea en faveur de M. de Lesdiguières. On les peut voir avec satisfaction. Je ne m'embarquerai pas dans le détail de cette célèbre et inutile dispute, où un tiers sans droit mangea l'huître et donna les écailles aux prétendants. Ce fut finalement Frédéric Ier de Prusse qui fut choisi par la bourgeoisie de Neuchâtel, peu soucieuse du droit féodal, pour les raisons qui lui plaisaient, des raisons religieuses. On peut lire sur le site de la République et du Canton de Neuchâtel : "Le nom de Neuchâtel apparaît pour la première fois en 1011 comme celui d’une forteresse de Rodolphe III, roi de Bourgogne. A peu près à la même époque (998), des moines clunisiens fondent l’abbaye de Bevaix. L’histoire du comté de Neuchâtel au moyen âge témoigne de la variété des influences politiques et culturelles qui s’y sont manifestées. Après la disparition du royaume de Bourgogne, Neuchâtel passe successivement aux mains des Fenis, seigneurs du Seeland (milieu XIIe siècle), qui adoptent le nom de Neuchâtel, puis des Fribourg (1395), enfin des Hochberg (milieu XVe siècle), deux familles originaires du Sud de l’Allemagne. Tout en faisant partie du Saint-Empire, le comté passe sous influence franc-comtoise, puis bourguignonne lorsque les Neuchâtel deviennent vassaux des Chalon-Arlay (1288). L’influence impériale et comtoise est présente aussi dans les franchises accordées par le comte aux bourgeois de Neuchâtel en 1214 : elles s’inspirent directement de celles de Besançon." "Après l’occupation du comté par les Douze-Cantons suisses (1512-1529), Neuchâtel devient possession de princes français, les Orléans-Longueville, qui achètent la seigneurie de Valangin et la rattachent au comté (1592). L’adoption de la réforme protestante (1530) rapproche cependant Neuchâtel de ses voisins suisses de Berne, du Pays de Vaud et de Genève. A l’extinction des Orléans-Longueville (1707), les Neuchâtelois décident de confier leur souveraineté au roi de Prusse, Frédéric Ier, qui s’engage à respecter leurs institutions politiques et leurs libertés.
Pièce d'un demi-batz de la Principauté de Neuchâtel (1648) HE.AVR.DUX LONG. D: G. PRI. NOVIC. Henry d'Orléans, duc de Longueville, par la grâce de Dieu prince de Neuchâtel Écu couronné, mi-parti d'Orléans et de Neuchâtel OCULI. DOMINI. ET. PAX. SVP. IVSTO Les yeux de l'Éternel et la paix sont sur les justes (adaptation du psaume 34-13) http://www.cgb.fr
Page 59 à propos de Jacques, comte de Thorigny, tué en duel par le comte de Bouteville. Saint-Simon écrit (VI-VIII) : M. de Luxembourg, qui combla sa fortune en épousant la fille unique du second lit, était fils unique de ce M. de Bouteville si connu par ses duels, et qui, retiré a Bruxelles pour avoir tué en duel le comte de Thorigny en 1627, hasarda de revenir à Paris se battre à la place Royale contre Bussy d'Amboise, qui était ClermontGallerande, qu'il tua. Bouteville avait pour second son cousin de Rosmadec, baron des Chapelles, qui eut affaire au baron d'Harcourt, second de l'autre, qui fut le seul qui s'en tira et qui s'en alla en Italie, se jeta dans Casal, assiégé par les Espagnols, et y fut tué en novembre 1628. Il ne fut point marié, et il était frère puîné du grand-père du marquis de Beuvron père du maréchal-duc d'Harcourt. La mère de ces deux frères était fille du maréchal de Matignon; il était cousin germain de ce comte de Thorigny, fils de la Longueville, que Bouteville avait tué, petit-fils au même maréchal de Matignon, et premier mari sans enfants de la duchesse d'Angoulême La Guiche, fille du grand maître de l'artillerie. Ce comte de Thorigny était frère aîné de l'autre comte de Thorigny qui lui succéda, lequel fut père du dernier maréchal de Matignon et du comte de Matignon, dont le fils unique a été fait duc de Valentinois, en épousant la fille aînée du dernier prince de MonacoGrimaldi. MM. Bouteville et des Chapelles furent pris se sauvant en Flandre, et eurent la tête coupée en Grève, à Paris, par arrêt du parlement, 22 juin 1627. Ce M. de Bouteville avait épousé en 1617 Élisabeth, fille de Jean Vienne, président en la chambre des comptes, et d'Élisabeth Dolu, et cette Mme de Bouteville a vu toute la fortune de son fils et les mariages de ses deux filles. Elle a passé sa longue vie toujours retirée à la campagne, et y est morte, en 1696, à quatre-vingt-neuf ans, et veuve depuis soixante-neuf ans. M. de Bouteville était de la maison de Montmorency, petit-fils d'un puîné du baron de Fosseux.
À propos de Marie-Anne Gouyon, marquise de Nevet Elle mourut à 49 ans en 1699. Saint-Simon écrivait (II-XVIII) : "MM. de Matignon perdirent en même temps une soeur très aimable, veuve sans enfants de M. de Nevet, en Bretagne où elle était allée pour des affaires: elle logeait avec eux à Paris. Ils étaient tous fort des amis de mon père et de ma mère."
à propos de Françoise Le Tellier, dame de La Luthumière Le château de La Luthumière est situé dans le Cotentin à une moins d'une lieue de Brix, entre Cherbourg et Valognes. La forêt du même nom s'étendait de Brix à Cherbourg. La seigneurie, devenue baronnie, passa en 1613 des Piquet aux Le Tellier. La filiation de la famille Le Tellier est suivie depuis le XVIème siècle, mais un Bertrand Bruce aurait épousé en 1302[1] une Le Tellier dont le père n'avait pas d'héritier mâle. Bertrand Bruce aurait repris le nom de son épouse. Les Le Tellier suivants seraient donc des Bruce. Rögnvaldr Bruceson (1012-1046) était le fils de Brusí[2], et un petit-fils de Sigurðr Ier Riki Eysteinson, frère et successeur du célèbre viking Rögnvaldr Eysteinson (†898), Jarl (comte) de Möre[3] et nommé Jarl des Orcades[4], à l'époque du roi d'Angleterre Alfred le grand[5]. Le roi norvégien Haraldr[6] avait attribué ces îles à Rögnvaldr, en même temps que les Shetland[7], en reconnaissance de la mort au combat d'Ívarr, un fils de Rögnvaldr. Celui-ci les avait cédées à son frère Sigurðr qui devint ainsi le premier jarl des Orcades. Un des fils de Rögnvaldr Eysteinson, Göngu-Hrólfr, ne serait autre, selon la tradition danoise, que Rollon[8]. L'origine de la famille de Rögnvaldr de Möre remonterait à Sigurðr-hringr, roi de Danemark et de Suède (circa 750). Rögnvaldr Bruceson épousa Ostrida, fille de Regenwald, duc de Gottland[9]. Après s'être battu contre les païens aux côtés du roi de Norvège Óláfr II Haraldson[10], après la défaite de ce roi en 1026, il s'exila à Constantinople et en Russie. à son retour en Norvège, il obtint du roi Magnús Ier Olafsson[11] le titre de jarl des Orcades. Il trouva un arrangement avec son oncle le Jarl Þorfinnr[12] qui régnait sur un vaste territoire allant des Shetland à Dublin, il combattit même avec lui, mais l'arrangement provoqua une dispute, puis une guerre et Il fut tué dans un combat sanglant en 1046 sur l'île de Papa Stronsay. Deux de ses enfants, Ulf et Eyliff, étaient alors en Normandie à la cour de Robert Ier de Normandie[13]. Ils y avaient été baptisés sous les noms de Regenwald et Robert. Ce Robert de Bruis épousa Emma, fille du duc Alan III de Bretagne (1008-1040), et serait le constructeur en 1044 du château dit d'Adam à Brix (Brusee) que feue la reine d'Angleterre visitait lors de séjours chez les Brissac. Il accompagna William à Hastings et mourut peu après. Son fils aîné resta en Normandie et le Bertrand Bruis devenu Bertrand Le Tellier serait un de ses descendants. Le fils cadet de Robert, Adelme (Adam) de Bruis (†1094), épousa une autre Emma, la fille de Sir William de Ramsay[14]. Adelme se trouvait déjà en Angleterre dès 1050 dans l'entourage de la reine Emma (circa 985-1052), épouse du roi d'Angleterre Æthelred II, the Unready[15], mère d'Édouard le Confesseur[16]. Adelme obtint de grandes quantités de terres dans le sud et dans le nord de l'Angleterre. Il avait auparavant participé à la bataille de Lumphanan[17] qui permit au Scot Malcolm Canmore[18] de reprendre le trône d'Écosse à son cousin, le Picte usurpateur Macbeth Ier[19] et, en récompense, Adelme de Bruis avait reçu des terres à Annandale[20]. Les Le Tellier, avant de se fondre dans Bruce, auraient été originaires de Touraine et issus d'un Girard Le Telonier[21] réorganisateur fiscal en Normandie sous Philippe Auguste (témoin en 1089 d'une donation à Marmoutier).[22]
[1] Arch. Cherbourg. [2] Brucius (brisk = vif, ardent). [3] Près d'Ålesund, en Norvège. [4] Orkney àrcaibh, Yn Orcaid, les îles Orkneys. [5] Ælfrēd se Grēata, circa 849 - roi de 871 au 26 octobre 899. [6] Haraldr hárfagri Hálfdanarson (circa 850-933, roi de 872 à 931). [7] Autrefois Zetland, vieux norvégien : Hjaltland; Erse : Sealtainn. [8] Av. 890-entre 925 et 933, baptisé Robert, et auquel Charles le simple (879-929) concéda la Normandie. [9] Île maintenant suédoise de la Baltique. [10] Dit le Saint ou le Gros, 995-1030, roi de 1016 à 1028. [11] Den Gode, le Bon, circa 1024-1047, roi de Norvège de 1035 à 1047 et de Danemark de 1042 à 1047. [12] Þorfinnr Sigurðarson of Orkney (circa 1009-1065). [13] Le Magnifique ou le Libéral, père du Conquérant, circa 1010-1035, duc de Normandie à partir de 1027. [14] Ancêtre de son homonyme, prix Nobel de chimie. [15] Æþelræd Unræd (circa 968 - 1016), [16] Ēadweard se Andettere (circa 1004 - 1066). [17] Mars 1057. [18] Grosse tête, Malcom III d'Écosse, Maíl Choluim mac Donnchada, 1031-1093, roi à partir de 1058. [19] 1005-1057, roi à partir de 1040. [20] Son descendant, Robert VII de Bruce (1292-1314, VIIème lord d'Annendale, Earl of Carrick) devint en 1306 Robert Ier d'Écosse (Robert the Bruce, Robert de Brus en normand, Roibert a Briuis en erse d'Écosse). [21] Тελονικos, Teleonarius, percepteur. [22] Bibliographie : Orkneyinga saga, Ed. Guŏmundson, F., Reykjavik, 1965, trad. J. Renaud, La saga des Orcadiens, Paris 1990 ; J. RENAUD, Les Vikings et les Celtes, Ouest-France Université, Rennes, 1992 ; Annals of Ulster, éd. Hennesy, W.M. et MacCarthy, B., Londres, 1887-1901 ; J.-M. ChopiN, Révolution des peuples du Nord, W. Coquebert, Paris, 1844 ; Claude Pithois, Brix ; M.E. Cumings-Bruce, The Bruce and The Cumings ; Jack Lepetit-Vattier, Les demeures de Bricquebec.
Page 68 À propos du comte de Marsan Saint-Simon écrit (VI-XXI) qu’il était le frère cadet de M. le Grand et de feu le chevalier de Lorraine, qui n’avait ni leur dignité, ni leur maintien, ni rien de l’esprit du chevalier, qui, non plus que le grand écuyer, n’en faisait aucun cas. C’était un extrêmement petit homme, trapu, qui n’avait que de la valeur, du monde, beaucoup de politesse et du jargon de femmes, aux dépens desquelles il vécut tant qu’il put. Ce qu’il tira de la maréchale d’Aumont est incroyable. … M. de Marsan était l’homme de la cour le plus bassement prostitué à la faveur et aux places, ministres, maîtresses, valets, et le plus lâchement avide de tirer de l’argent à toutes mains. Il avait eu tout le bien de la marquise d’Albret, héritière, qui le lui avait donné en l’épousant, et avec laquelle il avait fort mal vécu. Il en tira aussi beaucoup de Mme de Seignelay, sœur des Matignon, qu’il épousa ensuite ; et quoique deux fois veuf, et de deux veuves, il conserva toujours une pension de dix mille francs sur Cahors, que l’évêque La Luzerne lui disputa, et que M. de Marsan gagna contre lui au grand conseil. … Lui surtout et Matignon, son beau-frère, tirèrent des trésors des affaires qui se firent du temps de Chamillart, à tous les environs duquel il faisait une cour rampante.
Page 71 à propos de Léonor Gouyon, deuxième du nom évêque et comte de Lisieux.
Portrait de Léonor II, évêque et comte de Lisieux le 14 mars 1677 Lille, Palais des Beaux-Arts Crédit photographique : © Photo RMN - © Hervé Lewandowski
09-02-03 |