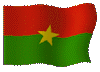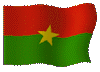La mise à jour de cette notice a été faite par M. Boubacar Issa Abdourhamane,
doctorant au CEAN, IEP-Université Montesquieu-Bordeaux IV
Processus démocratique
A la différence de plusieurs pays africains, le processus démocratique en cours au Burkina Faso comporte de profondes racines historiques. Certes, de 1960 à 1966, la Première République s'est distinguée par un régime présidentialiste dirigé par Maurice Yaméogo qui s'appuie sur un parti unique, l'Union Démocratique Voltaïque-Rassemblement Démocratique Africain (UDV-RDA) ; et de 1966 à 1970, le pays a connu un régime d'exception dirigé par le lieutenant-colonel Sangoulé Lamizana. Cependant, le 14 juin 1970 une nouvelle Constitution est adoptée par référendum. Celle-ci consacre un régime parlementaire ''rationalisé'' avec toutefois une emprise des militaires sur le pouvoir. Des élections législatives concurrentielles (7 partis en lice) sont organisées en décembre 1970, pour la première fois depuis 1959. Elles sont remportées par l'ancien parti unique qui obtient 37 sièges, les 20 sièges restant se répartissant entre trois autres formations. Mais la majorité parlementaire est profondément divisée et le travail parlementaire et gouvernemental paralysé par les luttes de factions, alors qu'une terrible sécheresse s'abat sur le pays en 1974. Prenant prétexte des divisions de la classe politique, de l'exaspération de l'opinion, du climat social et politique délétère, les militaires interrompent le processus démocratique en mettant fin au régime constitutionnel de la Deuxième République en février 1974.
Cette fois-ci, les militaires vont accentuer leur emprise sur le pouvoir, et tenter de s'y installer durablement en proposant en novembre 1975 l'idée d'un parti unique, le MNR (Mouvement National pour le Renouveau). Immédiatement on assiste à une levée de boucliers, et devant l'opposition farouche de la société civile, les militaires vont faire marche arrière et promettre le retour à une vie constitutionnelle normale. Après de nombreuses consultations avec les différentes forces sociales, un référendum constitutionnel approuve le 27 novembre 1977 une nouvelle Constitution qui jette les bases de la Troisième République. Une loi organique du 25 mai 1979 consacre la règle du tripartisme. Seuls ont obtenu la reconnaissance légale, les trois partis les mieux placés à l'issue de la compétition d'avril 1978. Il s'agit de l'ancien parti unique l'UDV-RDA, de l'UNDD (l'Union Nationale pour la Défense de la Démocratie), de l'UPV (l'Union Progressiste Voltaïque). Mais en violation de la Constitution, les partis qui ont obtenu quelques sièges mais qui ne figurent pas parmi les trois premiers, n'ont nullement été dissous. Pire, certains vont même siéger à l'Assemblée et au gouvernement. L'élection présidentielle a lieu en mai 1978. Elle est remportée par le Général Lamizana avec un score serré puisque, pour la première fois en Afrique subsaharienne, un président sortant est mis en ballottage, en l'espèce par M. Macaire Ouédraogo de l'UNDD.
La vie parlementaire restera très mouvementée en raison du quasi-équilibre des forces parlementaires entre majorité et opposition. Mais l'efflorescence de la corruption au sein de l'élite dirigeante, la violation flagrante de la Constitution, les rivalités de factions ainsi que la détérioration du climat social marqué par des grèves soutenues, vont provoquer la chute de la Troisième République le 25 novembre 1980. C'est le premier coup d'Etat militaire ouvertement putschiste en Haute Volta, qui ouvre la voie à une cascade de coups d'Etat militaires. Ce coup d'Etat militaire est dans l'ensemble bien accueilli et les premiers pas du CMRPN (Comité Militaire de Redressement pour le Progrès National) sont très appréciés. Mais la déception va bientôt s'installer. Les Voltaïques habitués au libéralisme de la période Lamizana supportent mal l'autoritarisme du nouveau régime et ses atteintes aux libertés publiques, notamment syndicales. Une coalition hétéroclite d'anciens et de jeunes officiers profite de l'impopularité du régime pour organiser un coup d'Etat militaire le 7 novembre 1982.
Le nouveau pouvoir, le CSP (Conseil du Salut du Peuple) promet de rétablir une vie constitutionnelle normale au bout de deux ans. L'institution d'un bicéphalisme débouche sur un conflit d'autorité entre d'une part le capitaine Sankara Premier ministre aux orientations révolutionnaires et le Chef de l'Etat, le médecin-commandant J. B. Ouédraogo soutenu par les forces dites conservatrices. La crise est dénouée provisoirement le 17 mai 1983 avec l'arrestation du Premier ministre. Le retour de l'armée dans les casernes et la rédaction d'une nouvelle Constitution sont décidés par le Chef de l'Etat.
Mais la faction dite progressiste du CSP évincée prend sa revanche en opérant le 4 août 1983 un coup d'Etat militaire. Un projet révolutionnaire privilégiant la paysannerie est développé par le nouveau régime, le Conseil National de la Révolution (CNR). Celui-ci, à l'inverse des pouvoirs précédents ne parle pas de rendre la pouvoir aux civil. Un coup d'Etat survient le 15 octobre 1987 qui se solde par l'assassinat de Sankara et plusieurs de ses compagnons. On assiste alors à une réorientation stratégique de la révolution burkinabé.
Celle-ci intervient au lendemain du coup d'Etat du 15 octobre 1987. Sous les dehors d'un mouvement de rectification le nouveau Président va progressivement mettre fin à la révolution et appliquer une politique d'ouverture envers la société civile et les catégories sociales naguère stigmatisées. Avec le déclassement international du référentiel marxiste et la montée des revendications démocratiques internes, le régime abandonne son orientation marxisante et concède la mise en ouvre d'un processus de démocratisation qu'il va contrôler avec succès. Une nouvelle Constitution est alors adoptée par référendum le 2 juin 1991. L'opposition réunie dans une Coordination des Forces Démocratiques (CFD) va chercher à déstabiliser le régime en place en réclamant la convocation d'une conférence nationale souveraine. Celui-ci refuse et concède cependant un forum de réconciliation dont les effets d'annonce vont conduire à la division de l'opposition. Devant l'échec du forum, celle-ci boycotte l'élection présidentielle de décembre 1991. Le Président se retrouve seul candidat en lice. Il est élu avec 86,1% des voix, avec un taux de participation de 24%. En mai 1992, sont organisées les élections législatives. L'opposition divisée en sort laminée, puisque le parti présidentiel, l'ODP-MT (Organisation pour la Démocratie et le Progrès - Mouvement du Travail) remporte 78 des 107 sièges de l'Assemblée. L'opposition se plaint de nombreuses irrégularités, mais la Cour Suprême ne prendra aucune décision d'annulation.
Au lendemain de la victoire écrasante de son parti, le président Compaoré va développer une stratégie de légitimation et asseoir sa domination politique en divisant ses adversaires et en cooptant certains d'entre eux sous les dehors d'une démocratie consensuelle. Il va en résulter une déliquescence de l'opposition burkinabé. Depuis qu'elle a boycotté l'élection présidentielle de 1991, malgré ses chances de mettre en difficulté le président sortant, l'opposition n'a cessé de connaître un processus d'involution après ses échecs aux élections législatives de 1992, municipales de 1995. Elle espérait retrouver un second souffle à la faveur des élections législatives de 1997, mais en vain. Le parti présidentiel remporte 101 des 111 sièges que compte l'Assemblée nationale. De même, l'élection présidentielle du 15 novembre 1998 a vu le président Compaoré réélu dès le premier tour d'un scrutin boycotté par une partie de l'opposition malgré la mise en place d'une Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI).
En dépit des imperfections qui les ont entachées, ces élections sont à la fois le signe d'un certain enracinement du processus démocratique en cours et celui de la grande hégémonie du régime actuel. De ce point de vue, ces élections sont profondément ambivalentes, dans la mesure où l'ampleur même du succès du parti présidentiel rend improbable à court et moyen terme l'hypothèse de l'alternance politique. En dépit de cette hégémonie, le pouvoir en place a été surpris par la vague de mécontentent politique qui a suivi l'assassinat d'un journaliste enquêtant sur le meurtre d'un employé de la présidence par la garde rapprochée du Président. Le collectif contre l'impunité composé d'organisations de la société civile, partis politiques et syndicats a exigé des mesures de libéralisation de la vie politique. En réponse à cette pression intense, un nouveau Gouvernement dirigé par Ernest Yonli a été formé en novembre 2000. Quatre partis de l'opposition, dont l'Alliance pour la Démocratie et la Fédération de Herman Yaméogo y font leur entrée. En retour, le pouvoir s'engage à réserver un traitement diligent aux dossiers judiciaires pendant devant les tribunaux. Une partie de l'opposition dite le " Groupe du 14 février " a refusé de s'engager dans ce gouvernement d'ouverture.
Institutions politiques
La Constitution promulguée le 11 juin 1991 instaure formellement un régime semi-présidentiel avec un Premier ministre responsable devant l'Assemblée Nationale qui peut être dissoute par le Président de la République. Mais en réalité, le régime est présidentialiste en raison de l'existence d'un parti dominant et dans la mesure où le chef de l'Etat peut aussi renvoyer le Premier ministre de son propre chef. Le pouvoir exécutif appartient au Président du Faso, élu au suffrage universel direct pour 5 ans, rééligible à nouveau, une seule fois depuis la modification constitutionnelle opérée par l'Assemblée nationale en avril 2000.
Le Parlement comprend deux Chambres, mais il s'agit d'un bicaméralisme très inégalitaire puisque seule l'Assemblée nationale a le monopole du pouvoir législatif. Quant à la deuxième Chambre appelée Chambre des Représentants, elle ne dispose que de pouvoirs purement consultatifs. Cependant, un débat est en cours sur la nature de ses pouvoirs. Le statut de la deuxième Chambre peut donc évoluer. Pour l'heure, elle se compose de représentants des divers groupes de la société civile (syndicats, autorités coutumières, religieuses, associations, etc.).
En matière de contrôle de constitutionnalité des lois, de contentieux électoral, c'est la chambre constitutionnelle, composée de dix membres nommés pour un mandat unique de neuf ans qui est compétente. Sa saisine s'opère par voie d'exception et n'est pas ouverte aux simples citoyens. Ses décisions ne sont pas susceptibles de recours.
Il existe également un Conseil Economique et Social composé de représentants des principales catégories socioprofessionnelles. Son rôle est d'émettre des avis consultatifs sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de lois qui lui sont soumis. Un Médiateur du Faso a été institué en mai 1996.
Système judiciaire
Le parlement Burkinabé a adopté en avril 2000 une révision constitutionnelle qui consacre l'éclatement de la Cour Suprême, initialement composée de quatre Chambres (Administrative, Constitutionnelle, Judiciaire, et des Comptes), en quatre entités : Cour de cassation, Conseil d'État, Cour des comptes et Conseil constitutionnel. Le pouvoir judiciaire est confié aux juges. Il est exercé sur tout le territoire du Burkina Faso par les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif. La Constitution consacre le principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Mais ce principe connaît de nombreuses entorses du fait notamment du militantisme de certains juges et des pressions du pouvoir. D'autre part, le conseil supérieur de la magistrature censé protéger l'indépendance des juges est présidé par le chef de l'Etat. La Constitution prévoit aussi une Haute Cour de Justice devant laquelle le Président du Faso et les membres du gouvernement peuvent répondre de leurs actes qualifiés de crimes ou délits dans l'exercice de leurs fonctions. Mais cette Cour n'a été installée complètement que le 4 juin 1998, sept ans après l'adoption de la Constitution.
Décentralisation, déconcentration
La décentralisation au Burkina procède à la fois de la Constitution et des programmes d'ajustement structurel et institutionnel de l'économie et de l'Etat, qui se contentait de déconcentrer. En juin 1993 cinq textes de loi ont redéfini l'organisation territoriale burkinabé. Ils instituent des collectivités territoriales décentralisées au niveau des provinces et des communes. En novembre 1993 a été créée la Commission nationale de la décentralisation dont la mission principale est de proposer un projet de texte d'orientation sur la décentralisation portant sur les définitions et les modalités d'implication de l'ensemble des composantes politiques, administratives, économiques et techniques de la décentralisation. Jusqu'ici, la décentralisation n'est opérationnelle qu'au niveau des communes dites de plein exercice, qui sont administrées par des maires issus des conseils municipaux élus au suffrage universel direct. Les élections municipales ont eu lieu le 15 février 1995. Elles ont connu une forte participation, de l'ordre de 70%. Vingt-six (26) des trente-trois (33) communes en jeu ont été remportés par le parti présidentiel, dont notamment ceux de la capitale Ouagadougou. En 1996, quinze nouvelles provinces ont été créées, portant le nombre de celles-ci à 45 et le nombre de communes de plein exercice à 48 puisque les chefs-lieux des provinces sont, selon la loi, des communes de plein exercice.
Les dernières élections municipales organisées le 24 septembre 2000 ont enregistré un taux de participation de 68,4% pour départager les 5145 candidats issus de 25 formations politiques. La victoire du Congrès pour la Démocratie et le Progrès(CDP), le parti au pouvoir était écrasante : il remporta 43 communes sur les 49 que compte le pays. Certains partis de l'opposition ont choisi de boycotter ce scrutin.
Deux instruments techniques ont été mis en place dans le cadre de la décentralisation avec pour objectif la création de 500 communes à l'horizon 2010 : le Service d'Appui à la Gestion et au Développement Communal (SAGEDECOM) et le Fonds de démarrage des Communes (FODECOM). Par ailleurs il existe une Association des Maires du Burkina Faso (AMBF). La décentralisation repose depuis peu sur les lois 041, 042 et 043/98/AN du 06 août 1998 portant respectivement organisation de l'administration du Territoire, organisation et fonctionnement des collectivités locales et programmation de la mise en ouvre de la décentralisation. Ces textes, notamment la loi 043, prévoient que les transferts de compétences et le transfert de ressources nécessaires seront effectives au plus tard cinq ans après l'adoption de la loi.
Partis politiques
L'article 13 de la Constitution garantit le multipartisme. Sur ce plan, le Burkina Faso connaît un nombre important de partis politiques : 67 partis ont été officiellement enregistrés en 1992. A la date du 28 janvier 1997, le nombre de partis officiellement enregistrés est passé à 46. Une importante recomposition de la scène politique est intervenue en février 1996. Le parti présidentiel l'ODP-MT a fusionné avec une dizaine de partis politiques pour former le Congrès pour la Démocratie et le Progrès (CDP), qui dispute aujourd'hui au PDP (Parti pour la Démocratie et le Progrès) la référence social-démocrate. Ce parti a accueilli en son sein quatre formations politiques non représentées à l'Assemblée et demeure la principale force politique de l'opposition. L'ADF (Alliance pour la Démocratie et la Fédération) va elle aussi recueillir l'adhésion d'une dizaine de formations politiques. Cette recomposition est intervenue quelques mois avant les élections législatives de mai 1997. Les principales forces politiques en présence étaient : le CDP qui a renforcé sa position avec 88 députés, le PDP deuxième groupe parlementaire avec 9 députés, l'ADF et le RDA, qui forment un groupe parlementaire de 9 membres.
Quatre partis ont été représentés à l'Assemblée fin 1997, contre neuf au début de la législature, sur les 27 qui ont pris part à la compétition électorale de mai 1992. Seuls 13 d'entre eux ont participé aux législatives du 11 mai 1997 et seulement 4 ont obtenu des sièges de députés. L'Assemblée nationale burkinabé ne compte plus désormais que trois groupes parlementaires aux forces très inégales : le groupe parlementaire majoritaire du CDP (101 députés), celui du PDP (6 députés) et celui de l'ADF/RDA (4 députés), deux partis qui ont fusionné en mai 1998. D'une manière générale, les partis d'opposition ont du mal à s'affirmer sur la scène politique, moins en raison des entraves du pouvoir qu'en raison de la faiblesse de leurs ressources humaines, matérielles et financières ainsi que de leur désunion.
Syndicats
Le pluralisme syndical a toujours existé dans l'Etat post-colonial burkinabé et les syndicats y ont historiquement joué un rôle politique important. Fers de lance de la société civile, ils ont constitué un réel contre-pouvoir politique. Plusieurs gouvernements des trois premières Républiques sont tombés sous leurs coups de boutoir. Ils sont toutefois sortis très affaiblis de la période révolutionnaire et s'efforcent de reconstituer leurs forces perdues, face à un régime qui cherche également à les neutraliser par d'autres moyens, notamment par la corruption. C'est ainsi que le monde syndical burkinabé connaît une bipolarisation de plus en plus nette, entre d'une part des syndicats (appelés le groupe des 13), qui préfèrent dialoguer avec le pouvoir et qui sont soupçonnés de faire son jeu, et d'autre part des syndicats dits révolutionnaires, résolument hostiles à la gestion économique et politique du pouvoir, plus enclins à recourir à la grève qu'au dialogue, et qui sont soupçonnés d'être une opposition politique qui ne dit pas son nom. La CGT-B (Confédération Générale du Travail du Burkina) la principale force syndicale du pays, est le chef de file de cette tendance radicale. Elle ne cesse de dénoncer de façon récurrente la corruption, les violations des Droits humains et des libertés publiques, l'impunité, les assassinats, les bavures, l'hégémonie du parti au pouvoir, les carences de l'appareil administratif, etc. C'est dans ce contexte que le gouvernement a fait adopter des lois très restrictives sur les conditions d'exercice du droit de grève et de manifestation sur la voie publique. On note également l'activisme syndical dans le milieu scolaire et estudiantin dirigé principalement par l'Association Nationale des Etudiants Burkinabé (ANEB). Leurs protestations contres les mesures gouvernementales en matière d'attribution des bourses a conduit à l'invalidation de l'année universitaire 2000.
Droits de l'homme
La transition démocratique a été émaillée d'intimidations et d'exactions, se traduisant par des attentats et des assassinats d'opposants. Avec l'adoption de la Constitution en 1991 et la mise en place des institutions de la Quatrième République la situation des droits humains s'est améliorée et il n'y a plus de prisonniers politiques depuis 1992. Mais les mouvements de défense des droits humains dénoncent de façon récurrente l'impunité dont bénéficient les dignitaires du régime, les bavures policières, les tortures, les disparitions et les exécutions extrajudiciaires de délinquants et de personnes ayant appartenu à la garde présidentielle. Le 13 décembre 1998, Norbert Zongo, directeur de publication de l'hebdomadaire L'Indépendant est assassiné alors qu'il menait une enquête sur une affaire de meurtre dans l'entourage du frère du chef de l'Etat. Le pays est depuis secoué par des campagnes de protestations et de dénonciation des violations des droits de l'homme. Pour désamorcer la tension, le Tribunal militaire de Ouagadougou a prononcé des peines de dix à vingt ans de prison contre des militaires appartenant au Régiment de la sécurité présidentielle. Cependant les responsables présumés de l'assassinat de Norbert Zongo désignés par une Commission d'enquête indépendante n'ont toujours pas été entendus par un juge. Ce qui continue à agiter le climat politique dans le pays et à créer la tension entre le pouvoir et les organisations de la société civile luttant contre l'impunité.
Le Mouvement Burkinabé des Droits de l'homme et des Peuples (MBDHP) est l'une des organisations phares de la société civile burkinabé qui prend position sur la situation des droits humains. Son président Halidou Ouédraogo préside également l'Union Interafricaine des Droits de l'homme (UIDH) qui regroupe de nombreuses ONG représentant la quasi-totalité des Etats africains et bénéficie d'une convention d'établissement avec le Burkina où elle a son siège. Le Mouvement se plaint cependant du manque d'aide de l'Etat, des intimidations dont font l'objet certains de ses militants.
Médias
Le code de l'information a été adopté en 1992 et révisé en 1993. Radios et presse privées sont en plein essor au Burkina depuis l'amorce du processus démocratique. L'Etat contrôle un quotidien, un hebdomadaire et un mensuel édités par les Editions Sidwaya, une station de télévision nationale, une station de radiodiffusion nationale avec des chaînes locales et régionales. La presse écrite privée comprend officiellement trois quotidiens (L'Observateur-Paalga, Le Pays, Le Journal du Soir), sept hebdomadaires (L'Indépendant, journal d'opinion critique; Le Journal du Jeudi, satirique etc.), dix mensuels et trois trimestriels. Les stations audiovisuelles privées comprennent une trentaine de stations toutes en modulation de fréquence, dont la plupart sont des radios communautaires. Radio France Internationale peut être captée à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso en modulation de fréquence. Mais faute d'accord avec l'Etat burkinabé, La Voix de l'Amérique et la B.B.C. se sont vu interdire par le Conseil Supérieur de l'Information la diffusion en modulation de fréquence par le relais des stations privées existantes. A noter la profusion des antennes paraboliques, notamment dans la capitale, permettant de capter les télévisions étrangères.
La plupart des titres et radios privés rencontrent des difficultés financières et matérielles, qui les exposent à la dépendance vis-à-vis du pouvoir politique et des puissances d'argent, ou à une disparition pure et simple. Le manque de professionnalisme des animateurs ou journalistes est aussi patent, d'autant plus que le statut de journaliste n'est pas codifié. L'information traitée par les médias est souvent dépourvue de réflexion critique. Elle est généralement institutionnelle. Il existe une mainmise du pouvoir sur les médias d'Etat. Selon la Ligue pour la défense de la liberté de la presse, la liberté de la presse est relativement assurée au Burkina, mais il existe des entraves sérieuses à son élargissement que sont notamment l'arsenal juridique répressif en matière de délit de presse, ainsi que le manque d'indépendance du Conseil Supérieur de l'Information qui a suspendu des émissions radiophoniques populaires critiques. Quant au Président de la Société des Editeurs Privés, il dénonce l'autocensure des journalistes par crainte du pouvoir.